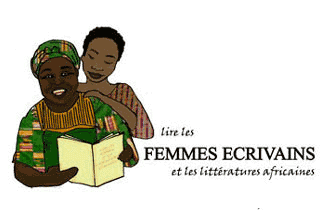
|
Une belle traversée Une nouvelle pour les jeunes de Lydie Dooh Bunya 1997 |
*
A l'école primaire, Debbie avait toujours secrètement envié ses camarades. A chaque rentrée, la plupart d'entre elles racontaient avec émulation leurs périples des vacances qui venaient de se terminer. Elles avaient quitté Douala qui pour Pongo, qui pour Ewodi, qui encore pour Abo, ou Mongo, ou Yabassi, ou Kribi ... tous ces villages du littoral et des environs de Douala que l'adolescente aurait tant aimé connaître. D'autres avaient rejoint Edéa, Eséka ou N'Kongsamba. Celles-ci avaient voyagé par chaloupes, celles-là par pirogues. D'autres enfin, quelles chanceuses, avaient pu prendre le train ! Quant à Debbie, quelle désolation, toutes ses vacances se passaient à la maison, invariablement. C'en était décourageant de monotonie.
La première fois où Debbie mit les pieds dans un train, ce fut pour se rendre au collège, à environ deux cent cinquante kilomètres de Douala. Cependant, toutes les vacances n'en ramenaient pas moins la jeune fille immanquablement dans sa famille, d'où elle ne bougeait que pour retourner au collège. La maison, le collège ; le collège, la maison ; pour Debbie qui aurait tant aimé voyager, c'était extrêmement frustrant.
Cette année-là, Debbie venait de fêter son treizième anniversaire. On commençait à chuchoter par-ci par-là qu'il fallait songer à la marier. Debbie n'aimait pas du tout ça. Elle se disait qu'on ne l'y forcerait pas. Elle ignorait comment elle s'y prendrait pour se soustraire à une telle catastrophe. Ce qu'elle savait en revanche, c'était qu'elle ne se laisserait pas faire. Pour lors en tout cas, elle préférait songer à autre chose. Il n'y avait pas encore péril en la demeure.
Depuis ses cinq ans, Debbie vivait avec sa mère, chez ses grands-parents maternels, après le divorce de ses parents, huit années plus tôt. Son père s'était remarié, sa mère non. Celle-ci, fille unique de ses parents, coulait des jours heureux auprès d'eux, avec ses enfants, Debbie, Régina et leur jeune frère Eboma. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle était en congé de corde au cou.
Quelle belle femme que la mère de Debbie ! Les camarades de l'adolescente ne tarissaient pas d'éloges à son égard : "Debbie, ta mère est d'une beauté telle qu'on te l'envie." Et comme si elles espéraient blesser leur condisciple, il arrivait qu'elles ajoutent : "Dommage que tu ne lui ressembles pas, qu'est-ce que tu aurais brisé comme coeurs !" Debbie haussait ostensiblement les épaules, ou lançait une petite pique bien sentie à la provocatrice : Pauvre amie ! quel dommage que je ne puisse pas en dire autant de la tienne !"
La mère de Debbie avait ce teint moreau, naturellement hâlé qui ne devait rien au moindre artifice. Sa volumineuse crinière couleur jais, que parfois elle répartissait en deux énormes tresses savamment entortillées, dégageait un cou interminable. Celui-ci surmontait un corps d'une sveltesse et d'une grâce à rendre jalouse Nefertiti en personne. L'harmonie, la nonchalence et la distinction de ses gestes faisaient de ses apparitions une fête pour les yeux. Tout son corps en mouvance, quel délice ! Le feu de son regard et l'éclat de ses dents n'avaient d'égale en charme que la musique de sa voix. Tout en elle suscitait éblouissement et convoitise. Dire qu'un tel corps était destiné comme n'importe quel autre à descendre un jour en terre, y pourrir et terminer en poussière, quel gâchis !
Quelques jours avant Noël, chargé d'un message, un émissaire débarqua un soir au domicile du père de Debbie. Dans le village de l'aïeule paternelle de l'adolescente, allait se dérouler une cérémonie coutumière de la plus haute importance. Le père de Debbie était l'aîné des fils vivants des tantes du chef du village. A cette cérémonie, la présence de tous s'imposait, et surtout la sienne. Le message venait le convier. Il était attendu avec sa nouvelle épouse : Tantie Eléna, et ses trois enfants : Debbie, Régina et le jeune Eboma.
Le précédent chef du village, frère de la grand-mère de Debbie, était décédé une dizaine d'années auparavant. Selon la coutume, la veuve du chef avait été confinée de longues semaines dans l'ancienne chambre conjugale, gardée par des parentes du défunt. Elle avait endossé une tenue de deuil bleu foncé pour des années. Ses habits, ses chaussures, ses sous-vêtements, ses foulards, ses mouchoirs, ses soutien-gorges étaient en bleu indigo ; mais aussi ses draps, ses couvertures, ses rideaux, ses nappes, ses napperons, son parapluie, ses sacs à main. Tout. Le grand deuil. Ce deuil dure habituellement entre quatre et sept ans. La veuve du chef l'avait porté dix ans.
A présent, le moment était venu pour elle du "retrait du deuil." C'était un grand événement. Les deux familles devaient le fêter ensemble.
Une fois prise la décision du retrait, la veuve était allée trouver le nouveau chef, son beau-fils, pour l'en informer. Ce dernier réunit les notables. "La veuve veut retirer le deuil de notre père," leur dit-il. Elle m'en a informé il y a quelques jours. A présent, elle attend vos desiderata."
"Elle les connaît, coupa le doyen, papa'Ewané. Nos traditions ne sont pas des secrets pour les veuves de notre tribu. Elles les connaissent toutes. Nos soeurs donneront la liste des victuailles. Nous préparerons nous-mêmes celle des boissons."
"Il ne faut pas qu'elle soit longue comme celle de la veuve de feu Diboto, suggéra le jeune nouveau bras droit du chef. A mon avis, nous avions exagéré."
"Lorsque je l'avais dit, répliqua son cousin germain Eboa, personne n'avait voulu m'écouter, pas même toi, Moussima ; et je n'avais pas été soutenu. Nous connaissons tous le résultat, hélas."
© Lydie Dooh Bunya, 1997.
![]()
[Retour à la page de Lydie Dooh Bunya] | [Page d'accueil du site "Lire les femmes"]
Editor: ([email protected])
Created: 25 March 1997
https://aflit.arts.uwa.edu.au/IneditDoohbunya2.html