|
Aminata TRAORE Click here for English translation |
 |
 Aminata Traoré est d'origine malienne. Née en 1947, elle arrive en Côte d'Ivoire en 1963 pour rendre visite à une de ses sœurs mariée dans ce pays. Elle y rencontre son futur mari et, après avoir obtenu un doctorat en psychologie sociale en France, s'installe en Côte d'Ivoire où elle occupe differents postes importants : « J'étais
Chercheur à l'Université d'Abidjan, de 1975 à 1988, et
détachée auprès du Ministre de la Condition
Féminine de Côte d'Ivoire, dit-elle au cours d'une interview. J'ai ensuite travaillé de 1988
à 1992 dans un programme régional du PNUD visant à
promouvoir le rôle des femmes et des communautés
défavorisées dans la gestion de l'eau et l'assainissement. Cet
itinéraire m'a appris à mieux appréhender la relation de
cause à effet entre les réalités internes à nos
pays et l'ordre du monde. J'ai occupé le poste de Ministre de la Culture
et du Tourisme au Mali de 1997 à 2000. Je suis essayiste et l'une des
animatrices du mouvement social au Mali et en Afrique. Sur le terrain, j'essaie
de vivre mon discours quant à un autre monde possible à travers
des micro-réalisations dans les domaines de la culture, la
réhabilitation des infrastructures des quartiers
défavorisés, dont le mien, ainsi que la promotion des textiles et
de l'artisanat africains. » [Source: Interview FR2 2005].
Aminata Traoré est d'origine malienne. Née en 1947, elle arrive en Côte d'Ivoire en 1963 pour rendre visite à une de ses sœurs mariée dans ce pays. Elle y rencontre son futur mari et, après avoir obtenu un doctorat en psychologie sociale en France, s'installe en Côte d'Ivoire où elle occupe differents postes importants : « J'étais
Chercheur à l'Université d'Abidjan, de 1975 à 1988, et
détachée auprès du Ministre de la Condition
Féminine de Côte d'Ivoire, dit-elle au cours d'une interview. J'ai ensuite travaillé de 1988
à 1992 dans un programme régional du PNUD visant à
promouvoir le rôle des femmes et des communautés
défavorisées dans la gestion de l'eau et l'assainissement. Cet
itinéraire m'a appris à mieux appréhender la relation de
cause à effet entre les réalités internes à nos
pays et l'ordre du monde. J'ai occupé le poste de Ministre de la Culture
et du Tourisme au Mali de 1997 à 2000. Je suis essayiste et l'une des
animatrices du mouvement social au Mali et en Afrique. Sur le terrain, j'essaie
de vivre mon discours quant à un autre monde possible à travers
des micro-réalisations dans les domaines de la culture, la
réhabilitation des infrastructures des quartiers
défavorisés, dont le mien, ainsi que la promotion des textiles et
de l'artisanat africains. » [Source: Interview FR2 2005].
Ouvrages publiés
 Mille tisserands en quête de futur. Bamako: EDIM, 1999.
Mille tisserands en quête de futur. Bamako: EDIM, 1999.
 L'étau. L'Afrique dans un monde sans frontières. Arles : Actes Sud, 1999. (190p.). ISBN 2 7427 2032 4. Essai.
L'étau. L'Afrique dans un monde sans frontières. Arles : Actes Sud, 1999. (190p.). ISBN 2 7427 2032 4. Essai.
 |  AVANT-PROPOS
Un siècle qui s'achève est un tournant d'une grande
solennité. Les rituels de fin d'année - échanges de
vœux et résolutions - restent semblables, à la
différence que l'on souhaite avec davantage de ferveur que nos voeux
s'exaucent. Le XXIe siècle annonce également un millénium.
Il est, de ce fait, doublement solennel. Les grandes puissances le
préparent activement, fébrilement. |
|
« Aminata D. Traoré, psychosociologue et femme d'entreprise, artiste
décoratrice à ses moments perdus, s'est fait connaître sur
la scène internationale par ses prises de position affirmées sur
la situation critique de l'Afrique et sur la condition de la femme africaine.
Aujourd'hui Ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, elle n'a rien
abdiqué de ses convictions. Son livre est une chronique : le regard tendre et lucide qu'elle porte sur la société dans laquelle elle vit donne aux anecdotes du quotidien toute leur portée. C'est aussi un essai, où l'analyste expose avec clarté et concision la situation dans laquelle se trouvent son pays, le Mali, et son continent, l'Afrique. Mais c'est surtout un cri d'alarme et un plaidoyer politique. Poids exorbitant de la dette, rôle ambigu du FMI, l'auteur répond par la reprise en main des décisions, par le refus d'une démocratie régulée de l'extérieur et paf la singularité culturelle africaine. Au cœur de l'action, Aminata Traoré éprouve quotidiennement l'urgence de trouver des solutions et le besoin de transformer le monde : les propositions qu'elle énonce sont courageuses et novatrices, vont à l'encontre des idées reçues et révèlent, par-delà le pragmatisme de la femme de pouvoir, la profonde humanité d'une femme de cœur, qui se trouve, pour reprendre le titre d'un de ses chapitres, "au coeur de l'être". » (Quatrième de couverture) |
 Le viol de l'imaginaire. Paris : Fayard et Actes Sud, 2002. (212p.). ISBN 2 213 61114 2. Essai.
Le viol de l'imaginaire. Paris : Fayard et Actes Sud, 2002. (212p.). ISBN 2 213 61114 2. Essai.
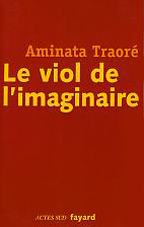 |  Prise de parole
« Tout est lié. Tout est vivant. Tout est interdépendant
», nous enseigne Amadou Hampâté Bâ en se
référant aux religions traditionnelles africaines. C'est
pourquoi, ajoute-t-il, chaque action a une répercussion qui lui est
propre sur l'ordre universel. L'homme doit assumer sa responsabilité
quant aux liens - tantôt visibles, tantôt invisibles - dont
l'ensemble confère un sens à la vie. De l'animisme, diront
certains. De la spiritualité, leur rétorquerai-je,
c'est-à-dire cette part d'humanité qui aurait pu nous mettre
à l'abri de tant de tourmentes si la marche du monde ne l'avait pas
évacuée.
|
|
« Il n'est rien de plus encombrant ni aliénant qu'une image de soi et de sa place dans le monde qui se nourrit des désirs et du discours des autres. Depuis plus de quarante ans, l'Afrique cherche sa voie, mais en vain. Elle est dans l'impasse. Les violences de l'Histoire ayant fait des vainqueurs et des vaincus, des gagnants et des perdants, les rapports entre nations riches et nations pauvres demeurent des rapports de domination qui se perpétuent à travers des mots clés, qui ne sont que mots d'ordre.
Pillée et marginalisée, l'Afrique est invitée par les maîtres du monde à se penser pauvre, à se comporter en région pauvre. Les Etats du continent, surendettés et interpellés par une demande sociale forte, se voient contraints d'adopter et d'appliquer des remèdes dont le coût social et humain est exorbitant. Or l'Afrique est la seule à détenir les remèdes à ses maux. Plus que de capitaux, de technologies et d'investisseurs étrangers, elle a besoin de retrouver cette part d'elle-même qui lui a été dérobée : son humanité. Car, contrairement à l'Homo oeconomicus, en se mondialisant, l'humain qui est en chacun de nous et que les Africains revendiquent s'enrichit mais enrichit surtout les autres et met la
planète à l'abri de bien des saccages. La grande voix africaine, ancienne ministre malienne de la Culture, signe ici un livre bouleversant sur la douleur d'une Afrique mutilée par la mondialisation libérale. » (Quatrième de couverture) Note de lecture, Dominique Gentil, 2002 (RTF) [Consulté le 16 janvier 2007].
|
 Lettre au Président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Paris : Fayard, 2005. (212p.). ISBN 2 213 62470 4. Essai.
Lettre au Président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Paris : Fayard, 2005. (212p.). ISBN 2 213 62470 4. Essai.
 |  Vivre debout
Le « Non » irait comme un gant à l'Afrique noire,
Monsieur le Président de la République française, s'il
nous était donné à nous, peuples de vos anciennes
colonies, de nous prononcer sur la nature et les desseins de l'Europe. Je sais
que le simple fait d'établir un tel lien entre l'Occident, qui a le vent
en poupe, et une Afrique en état de déliquescence peut
paraître saugrenu. |
| « Contrairement à une idée bien répandue, en France comme en Afrique, la crise qui secoue aujourd'hui la Côte d'Ivoire est loin d'être une affaire interne à ce pays. Jusqu'en septembre 2002, le pays de Félix Houphouët-Boigny était en effet avant tout le modèle le plus achevé de l'ouverture des anciennes colonies françaises d'Afrique noire au libéralisme économique. Son implosion révèle l'échec criant de ce modèle, et surtout ses conséquences dramatiques pour tous les peuples d'Afrique. Dans sa lettre ouverte à Jacques Chirac - l'homme du refus de la guerre en Irak, l'«avocat» de l'Afrique à travers la francophonie, au niveau de l'Union européenne et des instances internationales -, Aminata Traoré décrypte la politique africaine de la France, ainsi que l'ordre cynique du monde dans lequel elle s'inscrit et auquel elle participe. Elle invite surtout le président de la République française et tous ses homologues occidentaux à donner enfin les moyens à l'Afrique de vivre de ses propres richesses et de décider de ses propres orientations. » (Quatrième de couverture) |
 L'Afrique humiliée. Paris: Fayard, 2008. (296p.). ISBN: 978-2-213-63590-3. Essai. [Préface de Cheikh Hamidou Kane].
L'Afrique humiliée. Paris: Fayard, 2008. (296p.). ISBN: 978-2-213-63590-3. Essai. [Préface de Cheikh Hamidou Kane].
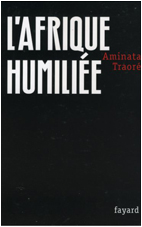 |  Chaque fois que les peuples européens ont concrètement tenté d'englober tous les peuples
Obsédante est la question du soi dans un monde bouleversé, tourmenté. Nous, peuples d'Afrique, autrefois colonisés et à présent recolonisés à la faveur du capitalisme mondialisé, ne cessons de nous demander : qui sommes-nous devenus? |
|
« ... Les pays riches ont peur de notre présence quand elle n'est pas susceptible d'ajouter à leur avoir, peur de nos différences quand elles sont trop visibles. Inutiles, les nouveaux naufragés entassés sur des embarcations de fortune, supposées les conduire vers la terre ferme de l'Europe. Invisibles, les désespérés qui traversent l'enfer du désert. Indésirables, ceux qui, menottes aux poignets, sont reconduits dans leur pays d'origine. Mais l'humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence, à laquelle l'Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. Car il n'y a pas d'un côté une Europe des valeurs et du progrès et de l'autre une Afrique des ténèbres et des malheurs. Cette vision, que certains d'entre nous ont tendance à intérioriser, vole en éclats dès l'instant où l'on touche du doigt les mécanismes de la domination, de la paupérisation et de l'exclusion. Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est d'imaginer des perspectives d'avenir centrées sur les êtres humains. Une réappropriation de nos destins qui fait appel à nos langues, à nos repères, à des valeurs de société et de culture qui nous sont familières. » (Quatrième de couverture). |
 "L'Argent des migrants. Combien ? Comment ? Pourquoi ?". In L'Argent : En avoir ou pas. Nantes : Editions Pleins Feux, 2007, pp.9-25. ISBN 978-2-84729-069-1. Conférence inaugurale des Rendez-vous de L'Histroire de Blois, octobre 2006.
"L'Argent des migrants. Combien ? Comment ? Pourquoi ?". In L'Argent : En avoir ou pas. Nantes : Editions Pleins Feux, 2007, pp.9-25. ISBN 978-2-84729-069-1. Conférence inaugurale des Rendez-vous de L'Histroire de Blois, octobre 2006.
 L'Afrique mutilée. Bamako: Taama, 2012. (48p.). ISBN 978-99952-855-0-0. Essai. En collaboration avec Nathalie M'Dela-Mounier.
L'Afrique mutilée. Bamako: Taama, 2012. (48p.). ISBN 978-99952-855-0-0. Essai. En collaboration avec Nathalie M'Dela-Mounier.
 |
« Nous, femmes africaines, ne sommes audibles que lorsque nos voix confortent le
discours misérabiliste et condescendant sur notre situation, souvent réduite à celle de femmes « pauvres, mutilées et enceintes ». Les politiques néolibérales qui saignent notre continent à blanc avec la complicité de dirigeants « démocratiquement élus » mais corruptibles et corrompus sont, elles aussi, mutilantes. En d'autres termes, une excision peut en cacher une autre. Cette réalité doit se savoir, être dite et inscrite au cœur du débat politique pour la seconde libération de l'Afrique et plus
particulièrement du Mali. » [Renseignements et diffusion 2012 - pdf file]
|
 Aminata Dramane Traoré et Boubacar Boris Diop. La Gloire des imposteurs. Lettres sur le Mali et l'Afrique. Paris: Philippe Rey, 2014. (236p.). ISBN: 978-2-84876-232-6. Correspondance.
Aminata Dramane Traoré et Boubacar Boris Diop. La Gloire des imposteurs. Lettres sur le Mali et l'Afrique. Paris: Philippe Rey, 2014. (236p.). ISBN: 978-2-84876-232-6. Correspondance.
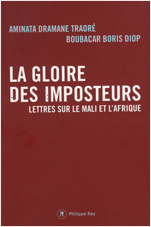 | « Le succès de l’opération Serval au Nord-Mali en janvier 2013, quarante-neuvième intervention militaire de la France dans son pré carré africain, a dépassé toutes les attentes. Ses soldats y ont été accueillis en libérateurs tandis que des intellectuels africains de renom, jusque-là peu suspects de complaisance à l’égard de la Françafrique, se sont bruyamment réjouis de son action, jugée énergique et courageuse. On peut comprendre ce soulagement, car il était impératif de mettre hors d’état de nuire la coalition des maîtres d’oeuvre du sanglant chaos malien. Mais la haine de ces derniers n’a-t-elle pas incité à ramener un conflit complexe à une banale lutte entre le Bien et le Mal ? C’est à cette question que s’efforcent de répondre Aminata Traoré et Boubacar Boris Diop dans un stimulant et franc échange de lettres… La gloire des imposteurs met en évidence une reprise en main néo-impériale de l’Afrique subsaharienne, par une violente agression militaire se présentant comme une odyssée morale, généreuse et totalement désintéressée. Mais, un an après, il y a lieu de se demander si, comme l’Amérique de Bush en Irak, la France n’a pas pavoisé un peu tôt au Nord-Mali où elle est en train de s’embourber. Au-delà du Mali, véritable cas d’école, les deux auteurs partagent leurs réflexions sur les guerres actuelles de l’Occident hors de ses frontières, ainsi que sur la Côte d’Ivoire, la Libye ou l’énigmatique printemps arabe. Et chaque conflit leur offre l’occasion de mettre à nu les mécanismes de la même triomphante imposture. » (Quatrième de couverture) |
Pour en savoir plus
Interview d'Aminata Dramane Traoré, Organisatrice du Forum pour un autre Mali. jeudi 18 mars 2004. (Interview filmée le 5/03/2004 à 15H20 à l'Hôtel Djenné). [Consulté le 15 janvier 2007].
Aminata Traoré : l'alternative africaine. Traversées Bamako - Mali, le 13 juillet 2004. [Consulté le 15 janvier 2007].
Le Forum pour l'autre Mali. [Consulté le 15 janvier 2007].
Sophie Galtier. "Aminata Traoré : une grande voix africaine". Interview FR2. 16 décembre 2005. LesOgres.Org. ["https://lesogres.org/article.php3?id_article=1118"]. [Consulté le 15 janvier 2007 - indisponible en 2012].
[Retour à la page d'accueil] | [Retour à la liste générale des auteurs]
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/French
Created: 15 January 2007
Modified: 28 November 2014
Archived: 28 November 2014
https://aflit.arts.uwa.edu.au/TraoreAminata.html