|
A (RE) LIRE "Matins de couvre-feu", un roman de Tanella BONI Paris: Editions du Rocher. Le Serpent à plumes, 2005. (320p.). ISBN 2-268-05302-4.
|

This review in English |
Matins de couvre-feu de la romancière et philosophe ivoirienne Tanella Boni propose un réquisitoire sévère contre l'élite politico-affairiste de Zamba (alias la Côte d'Ivoire) qui a entraîné le pays sur le chemin de la guerre civile. Ce roman publié en 2005 évoque un pays pris dans un tourbillon infernal qui l'entraîne vers le néant. La désagrégation sociale dont Zamba est victime n'a épargné personne : elle a divisé les familles, dressé les voisins les uns contre les autres, encouragé les violences ethniques, provoqué l'exode des forces vives du pays et tué des kyrielles d'innocents au passage. L'arbitraire fait force de loi et le pays est livré à une clique d'individus redoutables et dénués de scrupules.
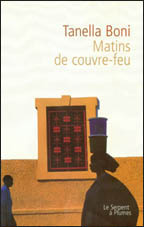 Matins de couvre-feu raconte l'histoire d'une femme dont on ne connaît pas le nom. Elle pourrait être n'importe qui : indépendante, dynamique, entreprenante, séparée de son amant depuis peu et propriétaire d'un petit restaurant qui la fait vivre. Une femme qui a la tête sur les épaules, une conscience sociale bien développée et plein de projets. Un jour, son univers bascule. Arsène Kâ – le chef des Renseignements Parallèles – l'arrête dans la rue et décide de l'assigner à résidence pendant neuf mois. La vie sociale et professionnelle de la narratrice s'arrête alors d'un coup. Son « maquis » lui échappe et hormis une ou deux visites, quelques lettres de sa belle-sœur et un bref tête-à-tête avec son frère lorsqu'il sort de prison, la narratrice se retrouve seule avec son chat et son chien.
Matins de couvre-feu raconte l'histoire d'une femme dont on ne connaît pas le nom. Elle pourrait être n'importe qui : indépendante, dynamique, entreprenante, séparée de son amant depuis peu et propriétaire d'un petit restaurant qui la fait vivre. Une femme qui a la tête sur les épaules, une conscience sociale bien développée et plein de projets. Un jour, son univers bascule. Arsène Kâ – le chef des Renseignements Parallèles – l'arrête dans la rue et décide de l'assigner à résidence pendant neuf mois. La vie sociale et professionnelle de la narratrice s'arrête alors d'un coup. Son « maquis » lui échappe et hormis une ou deux visites, quelques lettres de sa belle-sœur et un bref tête-à-tête avec son frère lorsqu'il sort de prison, la narratrice se retrouve seule avec son chat et son chien.
Prisonnière de ses quatre murs, elle laisse alors son esprit vagabonder en direction d'autres femmes, elles aussi victimes d'un abandon matériel ou affectif. Elle pense à sa mère, à sa belle-sœur et aussi à son amie Aya-Siyi dont la vie a été un long combat contre la misère et l'adversité. Elle pense aux hommes qui ont croisé son chemin et lui laissent des sentiments contradictoires: la ténacité exemplaire du juste Kanga Ba mais aussi les absences de son père, le militantisme forcené de son frère, l'amour spoliateur de son amant, sans mentionner cette armée d'individus qui, à l'instar de la clique d'Arsène Kâ et des jeunes voyous qui hantent les rues de la ville, sortent de l'ombre pour voler, violer et tuer en toute impunité. Alors qu'elle médite sur la condition humaine, elle en arrive à la conclusion que toutes les relations humaines contiennent le germe de leur destruction lorsqu'elles sont placées sous le signe de la violence et à la contrainte.
La tragédie qui a fait voler en éclats la cohésion nationale est due au fait que le pays a abandonné l'art du dialogue, du compromis et de la tolérance. On a perdu de vue que vivre en paix exige que « le citoyen, participant à l'autorité comme à l'obéissance, ait une volonté qui coïncide avec l'expansion collective, et qui fonde perpétuellement la synergie nationale » (Blondel). La Nation ne peut pas recouvrer le calme et la prospérité tant que l'attitude des individus n'aura pas changé, tant qu'elle ne sera pas l'expression d'une réciprocité de présence et non plus d'un repli identitaire. L'interdépendance des peuples et des individus héritée de l'histoire doit être mise au service de relations sociales harmonieuses. Elle ne doit pas accentuer les clivages et les inégalités au nom de hiérarchies obsolètes dont les sans-grades et les femmes, par exemple, ont souvent été les victimes.
Le fiasco de la relation de la narratrice avec son ami en fournit un exemple représentatif. Du jour où elle rencontre l'homme avec lequel elle va vivre quelque temps, elle se rend compte que l'idée que chacun se fait de sa relation avec l'autre ne joue pas à son avantage; que vivre ensemble n'est pas possible, non pas parce qu'elle est différente de son partenaire mais parce qu'il est réfractaire à l'idée de partage, qu'il n'a aucun intérêt pour sa manière d'être et de penser. Il la tient à l'écart de ses affaires et de sa vie, réduisant du même coup leur relation à une simple cohabitation. Dès lors, il n'est pas étonnant que son égocentrisme lui permette de spolier son amie de ses biens et de s'approprier sans sourciller son « maquis » lorsqu'elle est assignée à résidence.
La relation entre Enée – le frère de la narratrice – et sa femme Ida illustre elle aussi le hiatus qui s'installe entre les individus lorsque l'une des parties sacrifie l'autre à l'hôtel d'une quelconque idéologie qui ne vaut pas mieux qu'un affairisme indélicat. Enée accorde plus d'importance à son action militante qu'aux préoccupations d'Ida. Il croit œuvrer pour le bien de la communauté en sacrifiant toute son énergie à « la cause commune » (p.228) mais pour sa femme et les gens qui comptent sur lui, le résultat n'est guère différent de celui obtenu par l'amant de la narratrice : il vit des vies parallèles d'où ils sont exclus : « entre sa passion des voitures et celle pour la révolution et le bien être de la communauté, il n'y a plus de place pour une femme de chair et d'os » (p.229). Aussi Ida part-elle de chez elle, comme l'avait fait la narratrice, afin que son mari puisse « reconstruire le monde à sa guise » (p.221).
Le droit de partir des uns ne devrait pas avoir pour corollaire le devoir de rester des autres mais une tradition bien établie en a décidé autrement et c'est avec autant d'étonnement que d'incompréhension qu'Enée apprend le départ d'Ida. Enée ne s'était-il pas tout simplement donné le droit, comme son père avant lui, de quitter ceux qui lui tenaient à cœur et d'aller à l'aventure, persuadé que les femmes de son entourage assureraient les arrières le temps qu'il faudrait ? La narratrice pense à sa mère qui, comme bien des femmes d'aujourd'hui, n'a pas eu d'autres choix que de se soumettre, d'élever ses enfants et d'en assurer l'entretien en l'absence de son mari. Au nom du respect de la tradition, une relation inégale permettait à certains d'échapper à leurs responsabilités alors que leurs épouses étaient condamnées à trimer et à assurer l'avenir de leurs enfants et de leur communauté. Tout ce qui nous vient du passé n'est donc pas d'inspiration divine et il convient d'examiner cet héritage à l'aune des besoins du monde actuel. Perpétuer les inégalités du passé, les vieilles querelles de famille et un tribalisme aveugle ne peut pas ramener la paix et la prospérité. Cela ne peut qu'enfoncer le pays plus profondément dans la confusion et le chaos.
Les relations personnelles qui assurent le bon fonctionnement des échanges au niveau familial, social et économique dérapent et se durcissent lorsqu'on les soumet à l'arbitraire d'un nationalisme basé sur des mythes et une vision lacunaire du passé. Rien de bon ne peut sortir de la coutume lorsqu'on l'exhume à seule fin de diviser la population en catégories d'individus au pouvoir inégal: hommes et femmes, nobles et esclaves, autochtones et allogènes, sud et nord... Ces dichotomies, loin de permettre la résolution des problèmes, ouvrent au contraire la porte aux pires excès et permettent la désignation de boucs émissaires dont le massacre ne fait qu'accentuer la chute du pays dans l'anarchie. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Tanella Boni faisait déjà l'apologie de la tolérance dans un article fascinant publié en 1997. Elle y dénonçait de manière très vigoureuse les dangers du nationalisme teinté de xénophobie qui envahissait petit à petit son pays :
« Ceux qui, hier encore, étaient nos frères et voisins – et l'on sait toute la charge affective que recouvrent ces termes – ont pris, du jour au lendemain, sans raison apparente, le visage de l'étranger, celui qui, en période de crise économique est désigné comme bouc émissaire. L'étranger est déclaré coupable de tous les maux, est responsable de l'insécurité, empêche les "autochtones" de travailler, voilà pourquoi il est déclaré indésirable et, par décision politique, expulsé manu militari. Ces expulsions d'hommes et de femmes, par cargos entiers comme du bétail, sont devenues, en Afrique, monnaie courante. Et nous gardons tous un silence coupable, nous tolérons l'inacceptable qui se déroule sous nos yeux. Pendant que nous crions au scandale devant la montée de l'idéologie d'extrême droite en France, l'Afrique n'est-elle pas en train de devenir le continent de tous les extrémismes, de toutes les dérives identitaires ? » (https://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP497tb.html).
Matins de couvre-feu explore les conséquences tragiques de ce laissez-faire qui a permis à une petite élite mal inspirée d'encourager un repli identitaire meurtrier et de fomenter la guerre afin de conserver leurs avantages. Le paradis s'est transformé en enfer et la situation paraît sans issue. Mais Matins de couvre-feu montre aussi que toute épreuve a une fin, que les Arsène Kâ ne sont pas immortels et qu'un jour ou l'autre les victimes éparpillées par le désastre se retrouveront pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du pays. Nul ne sait le jour et l'heure de ces retrouvailles où l'on célèbrera le bonheur de vivre ensemble dans une société qui encourage la parole et le dialogue. Qui sait quand on abandonnera au passé une époque infernale où règnent l'intrigue, la trahison et le silence de ceux qui devaient « apprendre à ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire » (p.99). Ce jour tant attendu est encore loin, peut-être, mais la narratrice de Tanella Boni l'attend avec confiance. Elle échafaude déjà mille plans qui lui permettront de repartir sur de nouvelles bases avec les habitants de Zamba. Elle rêve d'un pouvoir libéré des hégémonies qui ont conduit le pays à la ruine, un pouvoir guidé par le respect de la diversité, l'intégrité, le dialogue et la tolérance.
Jean-Marie Volet
[D'autres livres] | [D'autres comptes rendus] | [Page d'accueil]
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/School of Humanities
Created: 22-Jan-2009.
https://aflit.arts.uwa.edu.au/reviewfr_boni08.html