|
A (RE)LIRE "Cabaret sous savonnier", un roman de Lucienne BONNOT-BANGUI Paris: Présence Africaine, 2009. (258p.). ISBN: 978-2-7087-0791-7.
|

This review in English |
Cet excellent roman donne une dimension humaine aux conflagrations qui déstabilisent les états et traumatisent les individus. Il souligne l'importance du monde des émotions et des sentiments, si souvent négligés dans les analyses géostratégiques. Cabaret sous savonnier raconte l'histoire de Wouarra, une jeune Française qui échappe à la vie casanière de son village natal, s'épanouit au Darna mais doit assister impuissante à l'effondrement de ses rêves lorsque des miliciens semant la terreur dans le pays où elle a élu domicile tuent son mari. Cependant, le roman ne s'attarde pas sur les manœuvres politico-militaires qui mettent le monde à feu et à sang. Il met plutôt l'accent sur les conséquences tragiques de la guerre pour les populations civiles qui font toujours les frais de la folie meurtrière des combattants. Au gré de sa mémoire qui « n'en fait qu'à sa tête » (p.77), Wouarra nous entraîne dans un voyage qui interroge le concept d'appartenance et explore avec une grande sensibilité le cortège d'espoirs, de révoltes, de bonheurs, de déceptions qui déterminent le cours des relations humaines.
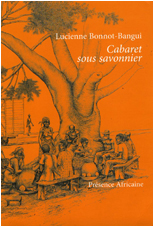 L'intrigue du roman se déroule en grande partie dans un pays imaginaire d'Afrique centrale que le lecteur associe cependant tout de suite avec un pays existant: la relation conflictuelle entre le nord et le sud du Darna, l'éruption de la violence en 1979, l'insécurité, l'assassinat de dizaines de milliers de personnes par des miliciens fanatiques, les enfants soldats, les élections truquées, la rivière coulant à travers la capitale et séparant le Darna des pays voisins, tout semble indiquer que nous nous trouvons au Tchad. Et dans ce pays, plus encore que dans d'autres, peut-être, l'ampleur des tourments infligés aux populations civiles prises en tenailles entre divers belligérants aux desseins mal définis, a été sinon ignorée, du moins largement sous-estimée. D'où l'intérêt d'un roman qui ne met pas l'accent sur les manœuvres politico-militaires des uns et des autres mais souligne les conséquences désastreuses de la guerre du point de vue de ceux et celles qui en sont les premières victimes. Un livre qui dénonce les exactions de milices avides de sexe et de sang et qui souligne le chemin de croix des individus qui tentent de remonter la pente, de renaître à la vie et d'oublier les blessures morales et physiques qui leur ont été infligées. La destinée de Wouarra, la jeune femme qui ne demandait qu'à vivre heureuse avec son mari au Tchad, montre l'impitoyable inhumanité de luttes d'influence contemporaines qui se nourrissent de violence, d'ennemis imaginaires, de haine et d'une conception déshumanisée de l'altérité.
L'intrigue du roman se déroule en grande partie dans un pays imaginaire d'Afrique centrale que le lecteur associe cependant tout de suite avec un pays existant: la relation conflictuelle entre le nord et le sud du Darna, l'éruption de la violence en 1979, l'insécurité, l'assassinat de dizaines de milliers de personnes par des miliciens fanatiques, les enfants soldats, les élections truquées, la rivière coulant à travers la capitale et séparant le Darna des pays voisins, tout semble indiquer que nous nous trouvons au Tchad. Et dans ce pays, plus encore que dans d'autres, peut-être, l'ampleur des tourments infligés aux populations civiles prises en tenailles entre divers belligérants aux desseins mal définis, a été sinon ignorée, du moins largement sous-estimée. D'où l'intérêt d'un roman qui ne met pas l'accent sur les manœuvres politico-militaires des uns et des autres mais souligne les conséquences désastreuses de la guerre du point de vue de ceux et celles qui en sont les premières victimes. Un livre qui dénonce les exactions de milices avides de sexe et de sang et qui souligne le chemin de croix des individus qui tentent de remonter la pente, de renaître à la vie et d'oublier les blessures morales et physiques qui leur ont été infligées. La destinée de Wouarra, la jeune femme qui ne demandait qu'à vivre heureuse avec son mari au Tchad, montre l'impitoyable inhumanité de luttes d'influence contemporaines qui se nourrissent de violence, d'ennemis imaginaires, de haine et d'une conception déshumanisée de l'altérité.
La destinée de Wouarra — « la fille Beaubery » (p.13) — semble être écrite d'avance. Chacun s'attend à voir cette enfant du pays suivre l'exemple de ses parents et se fondre dans la société locale. Mais la fillette solitaire, puis l'adolescente éprise de liberté, n'apprécie guère l'existence casanière de ses parents et elle monte à Paris. De là, les hasards de la vie la conduisent au Darna où elle rencontre Toussaint, l'amour et le bonheur. Elle s'intègre sans mal à un monde qui donne un sens à son existence et elle découvre d'autres valeurs, d'autres rapports avec son entourage, d'autres manières de concevoir la vie. Avec Toussaint, elle réapprend le monde. « Nourri de cette culture » dit-elle, « il croyait en ses valeurs. Il savait m'en parler et ne ratait jamais une occasion de me faire découvrir ce qu'une patiente éducation lui avait donné, de m'initier à l'essentiel des us et coutumes du pays, de m'amener à interpréter les regards et les gestes, ce qui se cache derrière les mots d'apparence anodine » (p.113). Et plus Wouarra se plonge dans l'univers de Toussaint, plus elle est séduite par la société qui l'entoure et par l'engagement de son mari. Malheureusement, Toussaint est assassiné lors d'une des nombreuses tentatives de coup d'état qui s'accompagnent toujours de tueries et de massacres. Du coup, elle doit rentrer en France mais elle s'y sent comme une étrangère et, dès qu'elle en a la possibilité, elle retourne dans son pays d'adoption pour s'y installer définitivement. Hélas, de nombreuses années plus tard, le gouvernement décide de l'expulser du pays où elle a désormais toutes ses attaches et qu'elle considère comme le sien.
L'obligation de quitter le territoire darnantais à l'automne de sa vie représente pour Wouarra une épreuve terrible, d'autant que le manque d'empathie des services consulaires français chargés d'organiser son rapatriement ne fait rien pour atténuer les effets dévastateurs d'une décision manigancée par les âmes damnées du pouvoir. Loin de compatir à la douleur d'une femme arrachée arbitrairement à son milieu et à ses amis, le consul essaie de la convaincre « qu'en France, son pays officiel, elle bénéficiera d'aides qui lui permettront de vivre bien mieux qu'ici » (p.246). Mais, on ne vit pas d'allocations, seule et perdue au cœur d'un océan d'indifférence. Pour Wouarra, frugale et satisfaite du peu qu'elle possède, ce sont ses amis et ses voisins qui donnent un sens à son existence. Boire une bière au « cabaret sous savonnier » quand le découragement la prend, partager le fruit de ses pensées avec Wongbe, prendre soin de P'tit Pim, prêter main forte à son amie Mariam et participer aux revendications des femmes du quartier, voilà ce qui compte pour elle. Comme le veut le dicton, on n'achète pas le bonheur. De son premier retour en France après la mort de son mari, elle a appris qu'elle ne se sent plus chez elle dans son pays d'origine. Certes, la magie de son premier séjour au Darna s'est envolée lorsqu'elle y retourne et le champ de ruines qu'elle y retrouve est à l'image de son âme: « Un soleil vif, le même qui m'avait accueillie lorsque j'avais débarqué ici pour la première fois, brillait d'un éclat froid sur les stigmates des combats », dit-elle. « Tout témoignait de leur violence. La fontaine du carrefour, salement amochée par un mortier retournait vers le ciel ses coupes grises implorantes que ne comblaient que du sable et des détritus. Sur les murs verdâtres des immeubles avoisinants d'innombrables impacts de mitraille. Le magasin où j'avais travaillé n'existait plus. Seul un morceau déchiqueté de façade tenait encore debout...Des étals rudimentaires s'étaient installés devant cette ruine et proposaient de beaux légumes frais: salades, haricots verts, carottes, tomates, persil. La vie se frayait un chemin au milieu des décombres de la guerre... En découvrant la tristesse de ce quartier qui tentait de guérir de ses blessures, je me disais qu'il faudrait longtemps pour que de vrais jardins refleurissent, pour que la cicatrisation se fasse, que les esprits s'apaisent, que les armes s'enrayent. Je sais maintenant que ce « longtemps » dure encore. » (p.134)
Le bon sens aurait sans doute voulu qu'elle refermât sa valise et prît le premier vol pour Paris, mais son intuition lui souffle que si elle veut retrouver son équilibre et tourner la page, ce n'est pas en France qu'elle y parviendra mais bien au Darna, quelles que soient les difficultés auxquelles elle doit faire face. Aussi, ajoute-t-elle, « ni ce jour-là, ni les suivants où j'eus tout le loisir de mesurer l'ampleur des dégâts, il ne me vint à l'esprit que je pourrais quitter cette atmosphère pesante chargée de tant de drames et de peurs. Dans mon sac, mon billet de retour, obligatoire, ne servirait jamais. Je l'avais su dès mon départ de Paris » (p.135).
Reste que même au Darna, retrouver son équilibre n'est pas facile car il est des choses qui ne s'oublient pas, même lorsqu'on est entourée d'amies qui vous comprennent et vous soutiennent. Aussi, quand la déprime la saisit et que la vie semble trop lourde à porter, elle se dirige vers les quelques bancs installés sous le grand savonnier situé en face de la chambre qu'elle loue à Wongbe et elle y rejoint les clients de Kaltouma, la vendeuse de bilibili[1]. Là, elle demande à la boisson ce que la volonté et la raison semblent incapables de lui donner et, pour un temps, la mort de Toussaint s'évanouit, alors qu'elle soliloque un verre à la main: « Ah! boire pour combler le vide de nos existence, en panser les blessures, édulcorer nos souvenirs, nous mouvoir dans un clair obscur compatissant où misères et maux se parent de toutes les diaprures de l'ivresse! Et à la fin, tourbillonner jusqu'au fond du gouffre noir de l'oubli ou s'envoler dans l'éblouissement d'un soleil brûlant... » (p.213).
Les bienfaits éphémères du bilibili dardanais ne sont bien sûr pas mieux à même de soigner les maux de l'âme qu'une illusoire sécurité matérielle vantée par le consul de France. La fin tragique d'un destin trop lourd à porter semble donc inéluctable. Mais la destinée de Wouarra l'entraîne une fois de plus dans une direction inattendue: écrire son histoire se révèle être la voie du salut.
« Pourquoi se réveille-t-on un matin avec en tête une seule idée qui revient en leitmotiv: 'Ecrire! Je dois écrire'? » (p.27) La question reste sans réponse mais, ajoute Wouarra, « cette irrépressible, absolue nécessité, je l'ai connue autrefois quand je me sentais bien, femme et heureuse ou pas assez malheureuse encore pour m'enfermer dans le total et noir silence, l'oubli de la vie... Je ne sais pas pourquoi elle m'est revenue, fébrile au bout de mes doigts et de mon crayon tout neuf... Je venais de me réveiller avec l'impression étrange de sortir d'une longue absence, une sorte de vie végétative où les gestes du quotidien se font mécaniquement dans une sorte d'irréalité [...] J'ai compris que la vie revenait en moi. Et la souffrance avec. Ça galopait dans ma tête! Un passé très ancien, assoupi au fond de ma mémoire, se rappelait brutalement à ma conscience... Ecrire pour vivre, même si la douleur à nouveau doit m'accompagner. Un exorcisme nécessaire. » (pp.27-28).
Est-ce aussi cela qui a poussé l'auteur de ce roman à témoigner à sa manière de son expérience africaine? Peut-être. Lucienne Bonnot-Bangui vécut de nombreuses années au Tchad avec son mari et elle y exerça le métier d'infirmière. Il est incontestable que son roman témoigne d'un attachement indéfectible au pays qui l'a accueillie, même s'il souligne aussi les désillusions de la narratrice face aux troubles continuels qui ont décimé les populations civiles tout au long d'une histoire agitée. Dès lors, ce n'est certainement pas par hasard que l'auteure dédie son livre « aux femmes qui luttent à travers le monde pour la vie et la survie, la liberté, le droit de s'exprimer. A celles d'Afrique, en particulier à mes sœurs du Tchad ».
Témoignage éloquent, Cabaret sous savonnier permet de découvrir le Tchad de l'intérieur, de partager les difficultés et les espoirs de ceux qui y vivent jour après jour. Il invite aussi le lecteur à se situer par rapport aux grands problèmes de notre temps: la guerre, la douleur, la mort, le sens de la vie mais aussi l'importance de l'amour, de l'amitié, de la compassion... Autant de problématiques auxquelles Wouarra essaie d'apporter une réponse personnelle qui nous interpelle tous. En résumé: un livre chaleureusement recommandé.
Jean-Marie Volet
Note
1. Bière locale.
[D'autres livres] | [D'autres comptes rendus] | [Page d'accueil]
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/School of Humanities
Created: 01-July-2011.
https://aflit.arts.uwa.edu.au/reviewfr_bonnot11.html