|
A (RE)LIRE "Mestizo", un roman d'Elisabeth DELAYGUE Paris: Présence Africaine, 1986. (144p.). ISBN: 2-7087-0466-4.
|

This review in English |
Les premières pages du roman d'Elisabeth Delaygue mettent en présence de nombreux personnages. Mais loin de dérouter le lecteur, tous ceux qui occupent l'espace narratif de Mestizo illustrent bien l'idée centrale du roman et donnent le ton de cette saga familiale: qu'on l'admette ou non, le brassage des races et des cultures héritées de nos devanciers détermine ce que nous sommes. Reste que ce métissage est difficile à assumer lorsqu'il est la source de discriminations, de racisme, de rancœurs et de préoccupations identitaires.
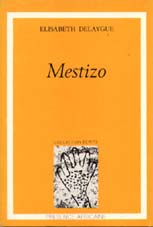 L'histoire commence dans les rues de Dakar en 1912, alors que Richard N'Diaye-Jefferson observe son père passant « dans sa Buick blanche conduite du bout des doigts par un chauffeur hilare » (p.9). Richard a quatorze ans et il est plein de ressentiment à l'endroit de cet individu qu'il exècre. Si le jeune homme à « un cœur de parricide » (p.9), c'est que ce père indigne qui a défloré sa mère alors qu'elle était à peine pubère, a aussi abandonné sa maîtresse et ses enfants à leur misère. Et pour parachever la malédiction dont ce brasseur d'affaires aux grands airs est le premier responsable, la jeune accouchée a été chassée de la concession familiale avec sa propre mère que les anciens n'ont pas hésité à accuser d'être responsable du déshonneur de sa fille et de la famille.
L'histoire commence dans les rues de Dakar en 1912, alors que Richard N'Diaye-Jefferson observe son père passant « dans sa Buick blanche conduite du bout des doigts par un chauffeur hilare » (p.9). Richard a quatorze ans et il est plein de ressentiment à l'endroit de cet individu qu'il exècre. Si le jeune homme à « un cœur de parricide » (p.9), c'est que ce père indigne qui a défloré sa mère alors qu'elle était à peine pubère, a aussi abandonné sa maîtresse et ses enfants à leur misère. Et pour parachever la malédiction dont ce brasseur d'affaires aux grands airs est le premier responsable, la jeune accouchée a été chassée de la concession familiale avec sa propre mère que les anciens n'ont pas hésité à accuser d'être responsable du déshonneur de sa fille et de la famille.
Le fait d'être le petit fils d'un noble aventurier blanc et le fils d'un riche homme d'affaire dont il a hérité la physionomie « trait pour trait, en plus foncé ! » (p.15) ne facilite bien sûr pas l'intégration de Richard dans le milieu dont est issu sa mère. Tout au contraire. Au fil des ans, cette hérédité ne fait qu'accroître sa confusion et sa rancune. Depuis le jour de sa naissance, il a été relégué à la périphérie de deux mondes qui proclament haut et fort leur indépendance alors qu'ils se mêlent sans retenue à tous les niveaux et dans tous les domaines. Dès lors, incapable de saisir la logique du comportement de ses compatriotes, Richard « se contente de haïr ». Haïr non seulement son père, mais aussi l'ensemble de l'univers colonial qui s'affirme surtout par l'exclusion, le racisme insidieux qui cherche à ignorer le brassage des races, les somptueux boubous de sa mère qui reflètent si mal le dénuement absolu de la famille et le logement minable que les maigres revenus maternels lui permettent de s'offrir.
La rencontre de Richard avec le vieux docteur Pitz – qui le prend à son service alors qu'il a seize ans – va changer la vie de l'adolescent et lui permettre de donner un sens à son existence. Pitz, dit le narrateur, était un personnage original, un peu anarchiste, dont l'intelligentsia coloniale se méfiait car il était trop fantasque pour le goût de l'époque. Le vieil homme ne tarde pas à se prendre d'amitié pour son jeune employé qui sait lui prêter une oreille attentive. Comme le relève ce dernier : « Pitz avait besoin de ma présence pour déverser le top plein de ses pensées profondes, de ses réflexions à tout propos et afin de me prendre à témoin en fonction des événements internationaux, africains ou tout bêtement domestiques. Il me dictait son courrier, il m'apprit à parler et à écrire la langue anglaise. J'imaginais volontiers qu'il était mon père. D'autant plus qu'il avait couché avec ma mère, j'en étais persuadé... Mais c'est à Jefferson que je ressemblais !» (p.16).
Quand Pitz part pour la France, puis pour l'Amérique où il désire rencontrer quelques spécialistes d'immunologie avec qui il poursuit ses recherches, il invite le jeune Jefferson à l'accompagner. Lorsque les deux voyageurs arrivent enfin à New York, Richard a quartier libre alors que son employeur se consacre entièrement à ses travaux. Maître de son temps et de ses déplacements, il ne faut pas longtemps au jeune homme pour se rendre compte que la ségrégation raciale est plus virulente encore aux Etats Unis qu'elle ne l'était au Sénégal. Ici, constate-t-il, « quatre-vingt-dix-huit pour cent d'ascendance scandinave ou anglo-saxone ne font pas de vous un blanc, tant qu'une paupière un peu lourde, un nez trop large, un cheveu de texture douteuse rappellent vos deux pour cents de sang noir » (p.26). Mais comme en Sierra Leone et en Jamaïque où vécut son père, au Sénégal, en France et partout ailleurs, l'appel de la chair est sourd aux interdits ségrégationnistes; et la très blanche et très respectable Deborah Smith tombe amoureuse de lui et accouche d'une fille qu'il ne rencontrera que bien des années plus tard.
Richard profite de sa liberté pour frayer avec la population locale et il ne tarde pas à se faire de nouveaux amis: le laitier qu'il aide du côté de l'East River, les premiers musiciens de jazz new-yorkais, les habitants de la 92e rue. Il en profite aussi pour élargir son horizon en « assistant parfois à des réunions syndicales et à d'autres franchement politisées » (p.32). Il parfait ses connaissances en puisant dans la bibliothèque de Pitz les ouvrages qui vont contribuer au développement de sa pensée et inspirer son engagement politique par la suite: Libérez les indigènes ou renoncez aux colonies de Damas; Comment la France perdra ses colonies de Tridon ou encore Pourquoi je suis un anti-colonial de Marquet.
Qui sait ce que serait devenu Richard N'Diaye Jefferson si, par « un coup décisif du destin » (p.43), Pitz n'était pas mort en lui laissant toute sa fortune. L'homme qui l'avait guidé de l'adolescence à l'âge adulte, celui qui lui avait permis d'acquérir une confiance en soi qui ne le quitterait plus, cet homme lui léguait aussi une fortune qui allait lui permettre de « mater » (p.43) le destin.
Lorsqu'il retourne à Dakar avec l'assurance d'un individu à qui la fortune a souri, il devient rapidement un homme d'affaires prospère. Doté du sens de l'aventure et des affaires de ses devanciers, il part pour la Côte d'Ivoire où il se lance dans la culture du cacao et figure rapidement parmi les planteurs les plus riches et les plus influents de la colonie. Sa réussite matérielle, toutefois, ne lui fait pas oublier ses anciennes convictions politiques, ses responsabilités et son sens de la justice. Il fraternise avec Adama Diallo, un des premiers médecins africains ayant adhéré à L'Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur à la suite de sa rencontre avec W.E.B. Du Bois au premier congrès pan-africain qui s'était tenu à Paris en 1919. Et la longue amitié qui lie les deux hommes les conduit à consacrer une bonne partie de leur énergie à combattre l'impérialisme colonial et à essayer de rendre la terre africaine aux Africains. Cette activité militante ne prendra fin que beaucoup plus tard, lorsqu'une tentative de rébellion avortée contre l'occupant français se solde par la mort d'Adama et l'emprisonnement de Richard.
Si Richard a hérité des traits de son géniteur, si la fortune, les performances et l'influence sociale du fils n'ont rien à envier à celles du père, les facultés proprement humaines des deux hommes n'ont rien de commun. L'attitude de Richard vis-à-vis de ses enfants en témoigne. A l'inverse du désintérêt de son père pour les enfants nés de ses amours prédatrices, Richard non seulement assume la paternité des enfants nés de ses relations successives mais il leur témoigne un amour sans faille, quels que soient leur sexe et leur complexion. Il regarde avec la même bienveillance Laureta, la fille qu'il a eue avec Deborah Smith lors de son passage aux Etats Unis – et que cette dernière lui amène à Dakar pour l'y abandonner quand elle atteint l'âge de huit ans –; Samuel, le fils de sa seconde femme, Awa, épousée en Côte d'Ivoire; Kémi, Nazaré et Jorge, les enfants issus de son union avec la Brésilienne Auréa. Tous ces enfants enrichissent la diversité culturelle de la famille et contribuent à leur tour au brassage incessant des cultures et des races. Samuel, par exemple, épouse successivement une Française née au Brésil d'un père italien, une diva noire américaine et une chanteuse sud-africaine.
Certains enfants souffrent de cet héritage lourd à porter parce qu'il se heurte sans cesse au racisme et aux chimères coloniales. Loreta, par exemple, tombe en dépression et finit par se suicider car elle se sent rejetée de tous et n'a pas la chance de rencontrer « le bon Dr Pitz » qui lui aurait permis de remonter la pente. D'autres finissent par s'accommoder des effets délétères d'une « tradition raciale » (p.78) discriminatoire à l'endroit des étrangers en général et des noirs en particulier. En digne héritière de son grand-père, la fille de Samuel, Kémi, est peut être la personne qui partage le mieux l'attitude de Richard face à la riche multiplicité de ses origines: « Moi, Kémi J. de Lourès, écrit la jeune femme, j'ai failli hériter de tes angoisses, Laureta mais ... j'aime être ce que je suis, j'aime mon vieux grand-père et les souches brésiliennes et françaises qui m'ont faites autre. Non pas "autre" comme Auréa de Lourès, notre indigne grand-mère, se figurait devenir en méprisant une parcelle d'elle même. Non, simplement différente de tous ceux justement qui n'arrivent qu'à se nourrir de la fierté mesquine, imbécile, d'être venus d'un petit coin de terre où l'on ne se mélangeait pas, pure race repliée sur elle-même. » (pp.81-82)
Si l'attitude de grand-mère Auréa – qui reniait la goutte de sang noir qui coulait dans ses veines – illustre bien le racisme omniprésent auquel Kémi a été confrontée depuis son plus jeune âge, ce n'est pourtant pas cette aïeule retranchée derrière ses préjugés racistes qui a eu le plus grand effet sur son enfance, mais bien les doutes et les angoisses de sa propre mère, blanche et française: « En 60 », écrit cette dernière dans une lettre adressée à sa fille, « et particulièrement en province, nous vivions entourés de solides préjugés et j'étais assez jeune pour en souffrir ... Lorsqu'une femme a voulu savoir si je t'avais adoptée, je me suis demandée brusquement si tu n'allais pas être l'enfant la plus malheureuse du monde, qui ne pourrait s'identifier racialement ni à sa mère ni à son père ... Enfant marginale pour toujours ! J'ai eu peur. Tu sais ? ... Pourtant j'étais fière de toi. Depuis ta naissance, une vraie beauté ! Tu étais admirée, quelle que soit la nuance raciste et jalouse des compliments des autres. » (p.106) Cette ambiguïté où se mêle l'admiration et le rejet, Kémi la retrouvera aussi tout au long de ses études et, plus tard, chez les hommes dont elle tombe amoureuse, tel Ghafar, ce jeune Libanais qui s'exclame : « Tu es trop jolie pour une Africaine ! » (p.126) et n'arrive pas à concevoir qu'en dépit de la couleur de sa peau, Kémi se considère « parfaitement africaine au fond de son cœur ». Les propos racistes de ce jeune médecin, sots et ignorants en dépit de son éducation, « suffoquent » (p.126) la jeune femme qui entend assumer pleinement la diversité de ses origines et ils soulignent toute la difficulté d'être soi-même dans un univers socio-culturel solidement attaché à un concept de pureté raciale absurde et fallacieux.
Comme son grand-père avant elle, Kémi réussit finalement à se débarrasser de l'image débilitante qui lui colle à la peau, à accepter avec dignité la multiplicité de son ascendance et à ignorer les images stéréotypées d'elle-même qu'elle retrouve dans le regard de certains de ses contemporains. Elle se rend compte que « les peuples différents qui se rejoignent dans nos veines nous ont laissés très forts ... C'est l'apanage des métis » (p.139). Dès lors, sûre d'elle-même, elle est prête, comme son grand-père, à conquérir le monde et elle prend l'habitude de circuler d'un endroit à l'autre au gré des expositions qu'elle organise « à New York chez Samuel, à Genève avec Maman, enfin à Paris et Abidjan chez ses grands-parents » (p.111). « Tu sais, je suis bien partout, je ne pourrai jamais choisir » ajoute-t-elle. Et quand le jeune Carlos l'invite à l'accompagner au Nicaragua, elle n'hésite guère car tout l'avenir du monde semble pouvoir se résumer à cette nouvelle union: « celui qui posait son regard sur le couple Carlos-Kémi faisait en un clin d'œil le tour du monde » (p.140), affirme-t-elle. Et le petit « Mestizo » nimbé de paix à qui elle donne le jour ne fait que confirmer que « le temps des métis à la couleur universelle » est arrivé.
Un quart de siècle après sa publication, Mestizo est un ouvrage qui n'a rien perdu de son actualité. « L'aventure à laquelle nous convie N'Diaye Jefferson », peut-on lire au dos du livre, « est celle de l'abolition mentale et concrètement réalisable de frontières artificielles que les hommes érigent entre eux pour se prémunir contre l'"impureté" raciale... Le récit entremêle des réseaux à la fois politiques, familiaux, ethniques et l'on atteint ce no man's land où existent des possibilités d'échanges multiples ». La profusion de personnages qui évoquent la diversité raciale et culturelle des familles N'Diaye, Jefferson, de Lourès et bien d'autres, dénonce les clichés derrière lesquels se réfugient le racisme, la peur d'autrui et le refus de la différence. D'où l'importance de reconnaître la diversité constitutive de l'humain et de rendre hommage à la multiplicité des origines de chacun plutôt que de s'enfermer dans l'univers étroit et stérile d'une pureté raciale illusoire.
Jean-Marie Volet
[D'autres livres] | [D'autres comptes rendus] | [Page d'accueil]
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/School of Humanities
Created: 01-November-2010.
https://aflit.arts.uwa.edu.au/reviewfr_delaygue10.html