|
A (RE)LIRE "Mademba", un roman de Khadi FALL Paris: L'Harmattan, 1989. (176p.). ISBN: 2-7384-0455-3
|

This review in English |
Un quart de siècle après la publication de Mademba, les problèmes évoqués par Khadi Fall dans son roman restent d'actualité: le dénuement des villages, les jeunes sans travail, la polygamie, les castes, la dépigmentation de la peau, la frime, la corruption, les pénuries, la sécheresse permanente, la mendicité, tout cela n'a rien d'anachronique. Ce n'est toutefois pas la réitération de ces difficultés qui fait l'intérêt de cet ouvrage mais plutôt la façon dont ces questions lancinantes sont perçues et évoquées par un jeune homme hospitalisé au Centre hospitalier de Fann où il doit subir une opération délicate de la gorge.
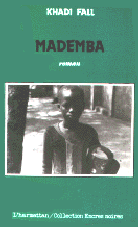 Convaincu qu'il est menacé « d'aphonie définitive » (p.11) car il a entendu le docteur parler de tumeurs et d'ulcérations tuberculeuses, Mademba décide de confier l'histoire de sa vie à un petit enregistreur que lui apporte en toute urgence sa cousine Faatim. Ainsi commence le récit de Mademba, venu au monde dans une famille de paysans misérables, arraché à l'affection de sa mère dès son plus jeune âge et confié par son père à un marabout pour y apprendre les rudiments du Coran dans une école coranique de la banlieue dakaroise.
Convaincu qu'il est menacé « d'aphonie définitive » (p.11) car il a entendu le docteur parler de tumeurs et d'ulcérations tuberculeuses, Mademba décide de confier l'histoire de sa vie à un petit enregistreur que lui apporte en toute urgence sa cousine Faatim. Ainsi commence le récit de Mademba, venu au monde dans une famille de paysans misérables, arraché à l'affection de sa mère dès son plus jeune âge et confié par son père à un marabout pour y apprendre les rudiments du Coran dans une école coranique de la banlieue dakaroise.
Comme on s'en rend compte rapidement, la vie d'un taalibé au service d'El Hadj Baabu est abominable. Les mêmes routines se répètent, jour après jour, année après année: le ressassement de quelques sourates tôt matin, puis l'égaillement de quelques quarante enfants qui, après avoir passé la nuit entassés dans une espèce de petit dortoir circulaire situé au centre de la concession, s'éparpillent dans les environs – les plus grands allant même jusqu'au centre de Dakar – pour demander l'aumône et récolter l'argent qui sera remis au Serigne le soir-même. Vêtus de haillons, privés de tout et dépossédés de leurs gains par leur maître, les taalibés ont une vie exécrable. Mais l'avenir qui les attend au sein de leur famille dans un village aux prises avec une sécheresse semi-permanente est-il vraiment meilleur ? Mademba n'a pas davantage de goût pour le travail harassant qui l'attend au village que pour la vie misérable qu'on lui impose sous couvert d'éducation religieuse, aussi décide-t-il, après quelques années au service de son maître, de reprendre sa liberté, et il s'enfuit de chez El Hadj Baabu.
Mille dangers guettent un enfant livré à lui même et leur échapper n'est pas chose facile dans les rues de Dakar. Toutefois, Mademba réussit à déjouer les pièges qui lui sont tendus et sa vie s'améliore lorsqu'il abandonne la mendicité pour devenir un petit cireur de souliers. On est certes loin des activités auxquelles un jeune enfant pourrait aspirer, et le fait qu'un gamin de moins de dix ans puisse considérer l'acquisition d'un peu de cirage et d'une brosse à reluire comme une heureuse fortune, ne fait que souligner la précarité de son existence à l'heure où il devrait être à l'école plutôt qu'à la rue. L'auteure du roman ne prétend pas le contraire mais elle ne cherche pas à dépeindre le monde tel qu'il devrait être. Le but du roman est plutôt de le présenter tel qu'il est et, surtout, de montrer que l'on peut s'en sortir avec les moyens du bord, aussi démuni que l'on puisse être. Il est toujours possible d'échapper à un déterminisme pesant et à un système économique tombé en déliquescence pour peu qu'on fasse preuve d'initiative et de volonté.
Les attitudes antinomiques des parents de Mademba face à la situation catastrophique de la famille illustrent cette proposition. Pour le père du jeune garçon, Dieu décide de tout, de la pluie qui va irriguer les champs, du nombre d'enfants qui vont voir le jour dans une famille, des épreuves qui vont marquer la vie des uns et des autres. Pour lui, quoi qu'il arrive, Dieu l'a voulu et l'on y peut rien. Il n'a donc aucune hésitation à envoyer son fils au loin. L'abandonner aux bons soins du Tout-puissant lui semble tout à fait naturel. Comme il le dit à son épouse quand elle essaie timidement de faire valoir que Mademba est trop jeune pour quitter la maison: « On dirait que tu ne crois pas en Dieu. Ce qui doit arriver en bien ou en mal à Mademba lui arrivera inévitablement, que tu sois à ses côtés ou pas. Si Dieu veut que notre fils nous revienne un jour sain, sauf et sage, il nous reviendra; mais si le Tout-puissant en décide autrement, ni toi ni moi n'y pouvons rien » (p.17).
Contrairement à ce que le père de Mademba affirme pour justifier son impuissance face aux défis que lui lance son époque, sa femme est une croyante fervente qui craint non seulement Dieu mais aussi son mari à qui elle obéit religieusement car c'est à ce prix que, pense-t-elle, elle sera admise au Paradis. Cela ne l'empêche toutefois pas de penser que placer sa confiance en Dieu ne lui interdit pas d'essayer de protéger son fils et de le préparer le mieux possible à surmonter les difficultés qu'il va devoir affronter au cours de son existence. « Aide-nous et le ciel nous aidera » (p.17) répond-elle aux propos de son mari, se reprenant d'ailleurs rapidement et lui demandant pardon d'avoir osé penser différemment de lui. Mais, au-delà de ses excuses et de la soumission requise par la coutume, on sent bien que la mère de Mademba ne considère pas l'être humain comme un simple jouet du destin. Pour elle: « tout ce qui arrivait aux membres de la famille et aux gens du village: le manque d'eau, le manque de vivres, bref, la misère, était certes l'expression de la volonté divine, mais Dieu ne bougerait pas un seul pouce pour aider les pauvres si ces derniers ne lui signifiaient pas concrètement qu'ils en avaient assez d'être pauvres, c'est-à-dire s'ils ne mettaient pas ensemble toutes leurs ressources physiques et mentales pour aller en guerre contre cette calamité » (p.69). Cette attitude volontariste est bien sûr désapprouvée par le père de Mademba dont l'attitude fataliste s'accommode très bien des habitudes et du départ de son fils vers un destin plus qu'incertain.
D'ordinaire, on ne se tourne pas vers les premières expériences d'un enfant rejeté par son père et malmené par l'existence pour remonter aux sources de la sagesse. Mais au delà du jeune taalibé asservi par un marabout exploiteur, on découvre un autre enfant qui a hérité la liberté de pensée de sa mère; un enfant qui n'a pas attendu d'atteindre l'âge adulte pour comprendre qu'il appartient à chacun de prendre en charge sa destinée. Il est intrigué par les inégalités qui l'entourent mais il se rend aussi compte qu'il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Après sa rencontre avec sa cousine Faatima, par exemple, il se pose une multitude de questions: « Je me demandais, dit-il, pourquoi mon père n'avait pas été envoyé à l'école comme mon oncle [...] pourquoi les membres de ma famille ne devraient jamais, comme oncle Ablaay Joob, jouir d'une grande richesse et connaître les avantages de la cité, pourquoi eux et les autres paysans du village devaient tout le temps subir; subir les aléas climatiques, subir la malhonnêteté des administrateurs [...], subir les conséquences des intrigues des politiciens » (p.68). La vie pose plus de questions insolubles que de réponses satisfaisantes et, l'âge venant, il se rend compte que Dieu n'a rien à voir avec cet état de choses. Comme l'avait déjà compris sa mère avant lui, il incombe au citoyen « ordinaire » d'initier le changement, mais pour d'innombrables raisons contradictoires et inavouées, chacun s'applique à faire perdurer le statut quo. En s'affranchissant de la tutelle de son père et en refusant d'être asservi par Serigne Baabu, Madamba fait un premier pas vers la liberté; et en abandonnant la mendicité pour une activité qu'il peut gérer de manière indépendante, il devient maître de sa destinée, même si la précarité de sa situation reste extrême. Matériellement, il ne gagne pas grand chose, mais en refusant le fatalisme servile que son père entendait lui léguer en héritage, il fait un grand pas vers l'indépendance et devient un être libre de ses actes et de ses pensées.
Bien qu'il ait été victime des coutumes archaïques qui perdurent dans son milieu, Mademba est plus intéressé à comprendre son entourage qu'à le juger. Dès lors, pourquoi s'emporte-t-il contre une marchande traînant derrière elle un relent de xeesal (p.22), se demande-t-il par exemple, « lui qui, pour n'avoir jamais eu d'éducateur attitré ni même de maître à penser, acceptait toutes les libertés individuelles qui ne mettaient pas trop d'entraves aux libertés du plus grand nombre ? » (p.23). C'est que la compréhension du monde qui l'entoure et la tolérance ne signifient pas que les idées, les croyances ou les comportements d'autrui ne le touchent pas. Mademba n'est pas un donneur de leçons, mais il n'en est pas moins critique de certaines pratiques dont il nie la pertinence: le système des castes, l'engouement des hommes pour la polygamie, l'importance accordée aux garçons par rapport aux filles, l'attirance obsessionnelle du xeesal et autres produits qui servent à la dépigmentation de la peau chez les Sénégalaises, sont autant de choses qu'il réprouve et entend dénoncer en s'en détournant plutôt qu'en manifestant sa désapprobation de manière bruyante et conflictuelle.
Bien que les nombreux rebondissements de la vie du jeune homme occupent une place privilégiée dans l'économie du roman, Mademba permet aussi aux lecteurs de découvrir d'innombrables personnages appartenant à tous les échelons de la société. Chacun influence à sa manière la perception des autres et de soi-même. Et la personne qui a la plus grande influence sur la manière d'être et de penser du narrateur est certainement sa cousine Faatim. Confidente intime du jeune homme, elle vient régulièrement lui rendre visite à l'hôpital et il est soucieux de parler d'elle dans ses enregistrements. Comme on le découvre rapidement, Faatim partage les valeurs de son cousin, son attitude par rapport à la vie, sa liberté. Comme lui, elle méprise les conventions, les intrigues et les faux-semblants. Mais contrairement à Mademba, l'attitude de la jeune femme ne doit rien à une enfance empreinte de misère et de discriminations car, née dans une famille aisée, aimée de son père et envoyée dans les meilleurs écoles et universités pour parfaire son éducation, elle a bénéficié de tous les avantages que la vie pouvait lui offrir. Hormis l'aïeul commun qui les lie, Mademba et Faatim semblent appartenir à deux mondes qui n'ont rien en commun; mais au-delà de leur mode de vie, de l'éducation qu'ils ont reçue et des signes extérieurs qui expriment de manière indubitable la différence de revenu de leurs familles respectives, les deux cousins sont confrontés à la même rigidité des structures coutumières et politiques, à la même tyrannie des attentes sociales et familiales.
Alors que Mademba doit faire face aux décisions arbitraires des uns et des autres dès son plus jeune âge, Faatim n'en découvre la tyrannie qu'à l'âge adulte, lorsque ses espoirs de pouvoir influencer le cours de son existence se heurtent aux projets de son père. Et le ciel s'assombrit d'un coup lorsqu'elle décide d'épouser un de ses camarades d'études qui est certes ambitieux et instruit, mais casté, ce qui en fait un prétendant tout à fait inacceptable aux yeux de la famille de Faatim qui se targue d'origines princières. Et comme si cela ne suffisait pas, le jeune homme l'abandonne lâchement, alors qu'elle est enceinte, lorsqu'il se rend compte que ses futurs beaux-parents n'accepteront jamais un griot en leur sein. Ces amours malheureuses avec un homme d'une caste inférieure lui valent le sobriquet de « Faatim la folle » lorsqu'elle rejoint le domicile paternel, blessée et humiliée. Et ses relations avec sa famille ne s'améliorent pas lorsqu'elle refuse les postes de travail rémunérateurs que son père trouve pour elle grâce à ses relations dans le monde de la finance et du pouvoir, et qu'elle décide de se lancer dans l'enseignement comme professeure d'anglais, ceci d'autant que son approche peu orthodoxe de l'éducation ne correspond guère aux méthodes en usage et qu'elle ne tarde pas à être évincée du corps enseignant par l'administration.
La solitude est au rendez-vous lorsqu'on décide de vivre en marge des conventions, et le prix payé par Faatim pour conserver sa liberté semble exorbitant. Toutefois, le vernis de respectabilité dont se pare le reste de sa famille cache aussi moult lézardes dans l'édifice familial. Respecter l'étiquette ne garantit à personne une vie heureuse et sans histoire, bien au contraire: la vanité, l'égoïsme, la jalousie et les intrigues ne sont que quelques-uns des ingrédients exacerbant la cohabitation malheureuse de la parentèle de Faatim. Les mariages successifs de son père ont souvent été responsables de crises familiales, allant de l'hostilité des co-épouses, à la répudiation de l'une d'entre elles, lorsqu'elle est prise en flagrant délit alors qu'elle cache un fétiche sous le lit de son mari. Survivre dans cette atmosphère délétère est difficile pour les mères vieillissantes comme pour les femmes sans enfant et celles qui ne donnent pas naissance à un héritier: ne pas avoir d'enfant, c'est la honte; et « avoir une fille par les temps qui courent, c'est vraiment la poisse » (p.78). La vie est aussi difficile pour les enfants, en particulier ceux qui ont été séparés de leur mère répudiée; difficile aussi pour les filles dont le rêve est de devenir des jeunes femmes indépendantes, libres de choisir leur profession, de se marier avec qui elles l'entendent, et de faire confiance à leurs compagnons quand ils jurent qu'ils ne prendront pas de nouvelle épouse.
Le pouvoir de l'argent, le poids des coutumes et l'appel à la conformité sont autant d'éléments qui empêchent les individus de briser le moule des conventions. Mais les mœurs, les traditions et les habitudes, comme les dieux, restent amorphes tant que les gens n'expriment pas concrètement ce qu'ils veulent. Un des attraits de Mademba, c'est de montrer qu'un consensus social qui se fonde sur l'immobilisme ne profite à personne. Ce sont ceux et celles qui sont prêts à agir selon leur conscience et leur sens de la justice qui font bouger les choses. Les gens qui prêchent par l'exemple. A cet égard, la détermination précoce de Mademba d'échapper au fatalisme de son père et à l'exploitation d'un Serigne sans scrupule est du même ordre que la résolution de Faatim de s'opposer aux exigences de sa famille et de refuser le script qu'on lui propose. Tout le monde peut être un agent du changement, au sommet comme à la base de l'édifice social. Il suffit d'un peu de volonté et d'un minimum de confiance en soi. Ce message simple et bien argumenté fait de ce roman non seulement un ouvrage intéressant mais aussi une source d'inspiration. Comme le suggère Anna Ridehalgh dans son étude du roman, « sur le plan esthétique comme sur le plan idéologique, Mademba constitue un projet ambitieux et original » [1]. Vivement recommandé.
Jean-Marie Volet
Note
1. Anna Ridehalgh. « Fonction de l'autobiographie fictive dans 'Mademba' de Khadi Fall » n.d. [https://www.limag.refer.org/Textes/Iti13/Anna%20%20RIDEHALGH.htm]. [Consulté le 17 mai 2013].
[D'autres livres] | [D'autres comptes rendus] | [Page d'accueil]
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/School of Humanities
Created: 1 June 2013.
https://aflit.arts.uwa.edu.au/rreviewfr_fall13.html