|
A (RE)LIRE "Juillet au pays", un témoignage de Michèle RAKOTOSON Bordeaux: Elytis, 2007. (206p.). ISBN 978-2-91-465988-8.
|

This review in English |
Madagascar rêve de paix et de prospérité mais ce sont les effets de l'esclavage, de la colonisation, de la dictature, de la répression et d'une exploitation économique sauvage qui ont surtout marqué le fil de son histoire. « Comment sort-on de ce continuum-là ? » (p.52) Telle est la question que se pose Michèle Rakotoson alors qu'elle arrive à Antananarivo pour passer Juillet au pays. La réponse n'est pas évidente, d'autant que la narratrice se rend rapidement compte que l'histoire de l'Ile qui « s'égrène au gré des dates et des morts lentes ou violentes » (p.52) laisse une place considérable au non-dit qui pèse de tout son poids sur un monde en mal de changement et empreint de vieux préjudices.
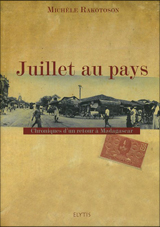 Alors que l'auteure se penche sur ses souvenirs pour les intégrer au contexte plus large de l'histoire de son pays, elle découvre des individus déterminés à s'adapter aux nouvelles valeurs imposées par le monde colonial: son arrière-grand-père se convertit au christianisme et devient missionnaire à la fin du 19ème siècle; ses deux grands-pères se lancent dans la médecine et son père apprend à jouer du piano, épouse une femme qui suit la mode de Paris et envoie sa fille au lycée français d'Antananarivo. Quant à l'auteure, elle prolonge cette longue quête du savoir occidental en conquérant les derniers vestiges de l'impérialisme occidental et en s'affirmant dans le domaine de la littérature française et des médias à Paris. Toutefois, l'exploration de cette histoire familiale riche en succès personnels laisse aussi transparaître plusieurs zones d'ombre auxquelles le folklore familial, à l'instar de l'histoire « officielle » du pays, semble avoir accordé fort peu d'importance: zones floues de la mémoire qui ont toujours été maintenues à l'écart et qui soulignent l'aspect fragmentaire d'une conscience familiale et nationale sujette à des oublis plus ou moins volontaires.
Alors que l'auteure se penche sur ses souvenirs pour les intégrer au contexte plus large de l'histoire de son pays, elle découvre des individus déterminés à s'adapter aux nouvelles valeurs imposées par le monde colonial: son arrière-grand-père se convertit au christianisme et devient missionnaire à la fin du 19ème siècle; ses deux grands-pères se lancent dans la médecine et son père apprend à jouer du piano, épouse une femme qui suit la mode de Paris et envoie sa fille au lycée français d'Antananarivo. Quant à l'auteure, elle prolonge cette longue quête du savoir occidental en conquérant les derniers vestiges de l'impérialisme occidental et en s'affirmant dans le domaine de la littérature française et des médias à Paris. Toutefois, l'exploration de cette histoire familiale riche en succès personnels laisse aussi transparaître plusieurs zones d'ombre auxquelles le folklore familial, à l'instar de l'histoire « officielle » du pays, semble avoir accordé fort peu d'importance: zones floues de la mémoire qui ont toujours été maintenues à l'écart et qui soulignent l'aspect fragmentaire d'une conscience familiale et nationale sujette à des oublis plus ou moins volontaires.
Plus la narratrice remonte le cours de ses souvenirs, plus l'image bien nette de la réalité malgache qu'elle exprime révèle ses lacunes. Une multitude de personnes ayant contribué d'une manière ou d'une autre aux activités familiales se sont évaporées sans laisser de traces et l'auteure croit voir revivre ces individus à la mémoire sacrifiée lorsqu'elle observe la population composite qui évolue dans les rues de la capitale. Elle y découvre les andevo, descendants des esclaves qui trimaient au service de la noblesse locale et qui demeurent aussi démunis qu'à l'époque de la royauté ou de l'occupation coloniale; elle y retrouve aussi des karanas, descendants des travailleurs arrachés au sous-continent indien par les Anglais pour construire les chemins de fer de l'Océan indien. Reconvertis au commerce, ils sont encore considérés comme apatrides dans un pays où ils sont pourtant installés depuis un nombre incalculable de générations, et systématiquement pillés à chaque émeute; d'une manière générale, la narratrice porte un regard neuf sur les masses laborieuses qui font avancer le pays en dépit de l'anarchie, l'incurie des élites politiques qui se succèdent et des experts en développement.
Ces rencontres qui élargissent l'horizon de la narratrice sont importantes dans la mesure où elles lui permettent d'éclairer d'un jour nouveau le passé de sa famille et celui du pays qui l'a vue naître. Elles lui permettent de prendre conscience du poids des minorités qui constituent une fraction importante de la population. Elles lui fournissent aussi l'occasion de renouer avec une part de son héritage longtemps obscurci. Ce faisant, elles lui permettent également – et, par ricochet, au lecteur – de mieux comprendre les inégalités sociales qui ont dominé la vie de l'île et expliquent, du moins en partie, les soubresauts meurtriers d'une nation marquée par un siècle de luttes fratricides. Le passé de Madagascar, comme celui de bien d'autres pays, est peuplé d'une multitude d'individus anonymes rejetés à la périphérie des grands mythes nationaux et il aurait fallu leur rendre leur dû... en lieu de quoi, il a semblé plus à-propos à certains d'écouter le chant des sirènes et de célébrer les haut-faits de quelques privilégiés occupant les plus hautes marches du savoir et pouvoir, une manière comme une autre de permettre aux inégalités sociales de perdurer et à la misère de progresser.
Alors que la narratrice se fond dans la masse de ses concitoyens, les gens qu'elle rencontre lui rappellent d'autres présences appartenant à une époque révolue, d'autres personnes sans identité propre, travailleurs de l'ombre émergeant de taudis interdits à la petite fille qu'elle était. Dada, le teenager qui habite dans la rue sous ses fenêtres, lui rappelle cette famille de dix-neuf enfants qui s'était installée dans son quartier alors qu'elle était encore toute jeune. Descendants d'esclaves libérés au début du 20ème siècle, l'indépendance du pays les avait dépossédés du peu de terre qu'ils avaient acquis et les avait plongés dans une misère noire d'où ils n'étaient plus ressortis depuis, survivant d'expédients dans une ville qui ne leur a jamais offert un avenir plus prometteur que les campagnes dont ils avaient été chassés. Dans une société qui ne s'est jamais préoccupée de leur dénuement, Dada et les siens demeurent les éternelles victimes des grandes manœuvres gouvernementales qui entendent moderniser le pays en les ignorant: « En 1900 Antananarivo s'essayait à l'électricité et les campagnes essuyaient une des pires famines de l'histoire malgache » (p.53). Rien n'a changé un siècle plus tard.
La fille de Rasoa lui fournit elle aussi l'exemple de cette misère qui réduit l'individu « à l'état de bête » (p.190). En voyant cette femme toute recroquevillée, vieillie avant l'âge et entourées d'enfants déguenillés, c'est à Rasoa-mère que pense la narratrice, Rasoa la mainty-black « qui avait passé toute sa vie devant l'âtre de Grand-mère et qui n'avait quasiment jamais quitté cet endroit, y dormant, avec ses enfants littéralement collés à elle, comme une portée de petits chiots terrorisés, du moins ceux qui avaient échappés à la mort, par Dieu sait quel miracle... Comment avait-elle atterri là ? Nous n'en savions rien, dit la narratrice, nous ne nous posions même pas la question, ignorions tout de son statut » (p.188). Tout comme des milliers d'anciens serfs et d'esclaves, Rasoa n'avait ni projets, ni histoire. Elle était là, tout simplement, un rouage ignoré qui permettait au pays d'avancer. Pour sa fille comme pour Dada, rien n'a vraiment changé à l'orée du 21ème siècle.
Pourquoi cette problématique-là n'a-t-elle jamais été évoquée ? Pourquoi n'en parle-t-on jamais à Madagascar ? » (p.52) se demande l'auteure alors que d'autres souvenirs jaillissent de sa mémoire: Elle est toute petite et entonne une chanson qu'elle a entendu quelque part: « Raha manina any ianareo e – Si vous pensez à nous, regardez le soleil », mais son arrière-grand-mère lui intime sèchement l'ordre de se taire car elle ne veut pas que sa petite-fille fredonne « une chanson d'esclaves » (p.52). A l'heure où les anciens musiciens de la Reine étaient encouragés à adapter les polkas et les marches militaires « à la sauce locale » et que le père de la narratrice apprenait à jouer du piano et emplissait la maison des rengaines de Tino Rossi, l'héritage des esclaves et leurs chants étaient délibérément exclus. Dès lors, se demande Michèle Rakotoson, à quoi bon le souvenir et la nostalgie s'ils ne représentent plus qu'une « image figée en soi et à laquelle on se raccroche comme à une bouée de sauvetage, alors qu'elle ne correspond plus à rien » (p.53).
L'enthousiasme du petit Ismael rentrant à Madagascar avec ses parents évoque lui aussi un aspect de la même problématique. Né dans une famille d'origine indienne, ce jeune garçon a été élevé avec la certitude qu'il est malgache, qu'il appartient à ce pays où il est né comme son père et son grand-père; un pays vers lequel il vole, tout excité à l'idée d'y retrouver sa maison et ses cousins mais dont il ignore les préjudices tenaces: ce pays dont il parle en disant « chez moi » n'entend pas vraiment s'ouvrir à une diversité culturelle qui ferait d'un petit homme musulman dont les ancêtres habitaient l'Inde un malgache à part entière. Comme l'avoue avec candeur la narratrice: « Malgache d'origine indienne. Moi-même, j'ai encore un peu de mal avec le concept... L'ethnocentrisme est profondément enraciné de par chez nous » (p.10); toutefois on sent bien qu'après avoir été déstabilisée un instant, la narratrice se rend à l'évidence: « Moi, je rentre chez moi. Et lui aussi » (p.11), dit-elle.
Cette prise de conscience d'une altérité malgache différente et sciemment occultée ne va pas sans interpeller la narratrice. « Combien y a-t-il de pages d'histoire de mon pays que je ne connais pas ? » se demande-t-elle. « Quand est-elle arrivée la décision de ne pas nous les enseigner ? Et si c'était ce vide-là qui nous faisait refaire tout le temps la même histoire ? Quand on n'a aucune grille d'explications, on ne fait que ressasser les mêmes histoires, sans trame et dénuées de sens. Pire que cela, quand toutes les références manquent, on intègre tous les clichés, même les plus dévalorisants » (p.188). L'origine des violences qui ont ravagé le pays à intervalles réguliers du 19ème au 21ème siècles, n'est donc pas à chercher dans les déficiences morales, politiques ou psychologiques de tel ou tel groupe d'individus mais bien dans l'absence de dialogue entre les membres d'une communauté nationale fragmentée, mal informée et privée de la diversité de son histoire. Pour sortir de ce continuum-là, point n'est besoin d'organisations charitables, d'évangélistes à la solde des églises américaines, de leurs homologues musulmans, des volontaires de la paix hantant les campagnes, des deniers du FMI, des experts internationaux mandatés par d'obscures officines ou encore de la mainmise de grandes compagnies multinationales sur les ressources du pays; pour rompre avec un cycle immuable de violence, le pays doit redécouvrir la riche diversité de ses origines, reconnaître la valeurs de ses fils et de ses filles et leur rendre leur dignité en leur rendant leur histoire si longtemps escamotée. Chacun doit réapprendre à vivre avec les autres, tous les autres, dans le respect d'autrui.
Bien que déstabilisant, le fait d'abandonner un nationalisme étroit et de chercher une réponse à ses questions au-delà des préjugés liés à des hiérarchies sociales archaïques, permet à la narratrice de découvrir la face cachée d'un monde qu'elle croyait pourtant bien connaître. Sa rencontre avec Lalona en offre une parfaite illustration. Cette jeune paysanne ne possède pour ainsi dire rien, mais elle va de l'avant, résolue, déterminée et attentive au monde qui l'entoure. Elle fait ce qu'elle peut pour ses deux enfants et ne s'embarrasse pas d'angoisses inutiles, avançant vaillamment et mettant à profit les très rares occasions qui lui sont offertes d'améliorer son sort. « Cette jeune femme m'émerveille » affirme la narratrice. « En deux jours, rien qu'en la regardant vivre, j'ai compris d'où est venue la force incroyable de ce peuple qui a résisté ... sans élever la voix, en évitant l'effusion de sang. La force tranquille » (p.180).
La jeune patronne du garage où elle conduit la voiture de son ami Noro lui fait également grande impression. Avenante fille de paysan, elle a fui sa campagne pour échapper au mariage à quinze ans, aux sept enfants à vingt-cinq ans, à la misère sans fond ... avec son mari, elle a construit un garage pièce par pièce et elle subvient au besoin de ses trois enfants, de sa belle-mère, de sa sœur, de deux neveux sans oublier les trois employés. Comme tous les gagne-petit, elle est l'innocente victime de l'effondrement du petit commerce qui accompagne les troubles politiques de 2002 mais comme les centaines de revendeuses de pièces détachées, de marchandes de textiles, de collectrices et de gargotières qui assurent la viabilité de l'économie informelle alors que la machine de l'Etat est sans arrêt en panne, elle remonte inlassablement la pente, bien déterminée à améliorer les conditions de vie de ses enfants et de ses proches. Ce n'est ni l'élite instruite dans les meilleures universités de l'Occident, ni les politiciens de haut-vol, ni les hommes d'affaires employés par de grandes compagnies internationales qui maintiennent le pays en vie mais bien plutôt les milliers d'hommes et de femmes ordinaires qui continuent à croire en l'avenir de leur pays et espèrent qu'un jour leurs enfants réussiront à échapper à la misère qui les étouffe.
La réflexion proposée par Michèle Rakotoson est à la fois perspicace, fine et lucide. L'auteure y propose une analyse personnelle et sincère des raisons qui ont entraîné son pays dans une succession de troubles sanglants et elle se demande si l'une des raisons de la malédiction qui semble poursuivre les siens, génération après génération, n'a pas pour origine la désappropriation des individus les plus démunis de leurs droits et de leur histoire. On leur doit tout et l'on s'obstine à ne rien leur donner en retour. A la lumière d'une chronique familiale riche de péripéties et de non-dits, la narratrice montre que différents groupes sociaux se croisent depuis la nuit des temps sans vraiment se rencontrer, sans se parler et sans se comprendre. En observant la face cachée d'un monde auquel elle n'avait jamais vraiment prêté attention jusqu'alors, l'auteure découvre que les choses ne sont pas toujours comme on les imagine et rarement conformes à ce qu'elles devraient être: une leçon dont la portée dépasse largement les confins de l'Ile rouge et qui fait de Juillet au pays un ouvrage que personne ne peut lire sans se sentir concerné.
Jean-Marie Volet
[D'autres livres] | [D'autres comptes rendus] | [Page d'accueil]
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/School of Humanities
Created: 16-December-2009
https://aflit.arts.uwa.edu.au/reviewfr_rakotoson09.html