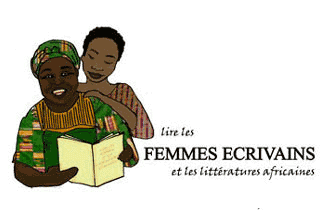
|
Le Préfet et les maquisards Une nouvelle de Marie Claire Dati 1996 |
*
Debout sur mes huit ans, je dominais Banganté et rien qu'en étendant les bras, je couvrais d'un bout à l'autre la petite bourgade fraîche et nappée de poussière ocre. A dix heures du matin, en saison sèche, la terre quittait définitivement ses accessoires de la nuit pour endosser ses atours. Le parfum du matin à cette heure-là, le parfum du village à dos de montagne était pénétrant, incomparable, céleste. La rosée chargée des senteurs de la végétation et de la poussière offrait à l'odorat une sensation profonde, somptueuse, étourdissante.
C'était l'heure de la récréation, le plaisir de courir, de jouer aux claquettes; c'était aussi le moment tant attendu de retrouver les beignets de manioc et de succomber à l'envie d'y consacrer sa fortune: "deux à cinq, deux à cinq" psalmodiait la grosse vendeuse haoussa. Dix francs étaient tout ce que j'avais, les jours où je pouvais fièrement annoncer que j'avais quelque chose. Je donnais mon argent et m'en séparais presque avec gratitude, alléchée par mes beignets préférés et complètement vaincue d'avance.
Beaux matins que les matins de Banganté.
La ville était faite de deux kilomètres de route bitumée, pas plus. D'un côté de la route étaient alignés la gendarmerie, la case de mon maître, la classe de ma petite soeur et la mienne, le terrain de football, le jardin d'enfants, la brigade militaire et un agglomérat de maisons dont celles du Sous-préfet, du Commissaire spécial et de Monsieur l'Inspecteur. De l'autre côté, en face de la gendarmerie, se trouvaient les bureaux de Monsieur l'Inspecteur et ceux du directeur de mon école, puis mon école toute entière, le Palais de Justice, la résidence de Monsieur le Préfet, la Mairie et enfin la Préfecture. Là s'arrêtait le goudron, sur la place du marché.
Nous nous sentions particulièrement à l'aise chez Monsieur l'Inspecteur. Là, nous devenions des enfants comme les autres, libres de nous asseoir par terre, de manger à pleine main et à pleine bouche les grosses boules de pilé de pommes de terre-haricot que Maman Joss nous donnait avant de nous chasser de sa cuisine. J'enviais le bonheur de ses enfants qui mangeaient sans assiette, sans table où se tenir droit et sans avoir à démontrer mille bonnes manières. Nous nous ruions hors de la cuisine de Maman Joss en riant et allions manger en jouant et en courant, sans risque de salir la nappe. Tout en sueur, sales et poussiéreux après nous être adonnés au plaisir de courir, de sauter et d'atterrir dans des sillons frais et moelleux, nous satisfaisions jusqu'à la lassitude le bonheur de creuser des cachettes et d'attraper des grillons.
Comme je n'allais nulle part sans la permission de nos parents, il arrivait aussi que certains jours de congés j'en sois réduite, pour m'étirer et me sentir vivre, à me glisser dans l'immense jardin de la résidence où, seule, je grimpais dans les manguiers et les avocatiers avant de me réfugier, lorsque la faim me surprenait, dans les plans de tomates dont la chair appétissante était à la fois pleine de jus à boire et de pulpe à mordre.
Belles journées que ces journées de Banganté.
Et puis tout bascula.
A Banganté, il n'y avait plus qu'une chose de vraie: les maquisards.
Ils mettaient le feu aux écoles en plein jour et on racontait la fuite des écoliers et des maîtres, les hôpitaux brûlés, les médecins décapités, les femmes enceintes éventrées... Les maquisards ne se reposaient pas et ne laissaient de répit à personne, surtout pas à Monsieur le préfet, mon père, qui était devenu tout maigre et tout pâle. Les lettres de menaces lui parvenaient jusque dans sa chambre sans que personne ne sût jamais comment elles arrivaient là, ma mère gardant jalousement la clé de la chambre.
Pour ma part, influencée par SIMO le prisonnier, je croyais que les maquisards possédaient un pouvoir magique si fort qu'ils pouvaient traverser les murs et entrer où ils voulaient sans être vus des militaires ou des gardes-du-corps.
Enfin, le Sous-préfet de Bazou tomba dans une embuscade ...
Ce jour-là je rentrais de l'école vers midi. Un camion militaire et quelques voitures de trop se trouvaient à l'entrée de la résidence. Les personnes qui descendaient le perron semblaient trop solennelles. Je m'étais approchée du camion. Un drapeau national recouvrait quelque chose de ... long comme ... un corps humain.
Mon coeur n'avait fait qu'un tour: 'Non! pas mon père!'
Je me figeais et restais plantée là, sciée, muette comme une carpe. Sorti on ne sait d'où, SIMO le prisonnier s'approcha de moi avec un rire affecté: 'Ah grand-mère, tu as vu, n'est-ce pas? Mais rassure-toi, ce n'est pas ton père. Viens poser ton cartable.'
Comme je ne bougeais pas, il répéta: 'Tu ne me crois pas? Viens, je vais te montrer. Viens donc voir, je te dis.
Et SIMO le prisonnier souleva un pan du drapeau.
Tout était rouge de sang et souillé de poussière, et pour moi le mystère de ce visage atrocement défiguré et non identifiable restait entier...
© Marie Claire Dati, 1996.
![]()
[Retour à la page de Marie Claire Dati] | [Page d'accueil du site "Lire les femmes"]
Editor: ([email protected])
Created: 18 October 1996
https://aflit.arts.uwa.edu.au/IneditDati.html