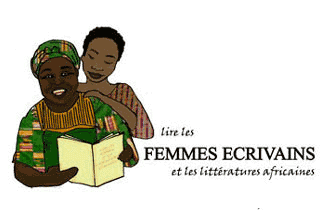
|
Cirque de Missira Une nouvelle de Nafissatou Dia Diouf 2001 |
*
| Octobre 1982 |
De sa voix rocailleuse, mais incroyablement pure, comme l'eau riante, comme le murmure d'une rivière, elle disait en montrant le ciel :
— Regarde les notes s'échapper pour arriver à la frontière du ciel, regarde, regarde ces petites bulles éclore et libérer une mélodie, jamais la même, impertinente, inattendue. L'orchestre, c'est la nature ; quand tu sais lui parler, elle comprend ta mélodie et accompagne ton chant a capella. Ecoute l'ombre qui bruisse, le vent qui chahute, le cours d'eau qui rigole, écoute les moineaux s'égailler en troupes débandées. Paradisiers, tisserins, colibris. Et les oiseaux de nuit, orpailleurs du ciel, qui vont cueillir les étoiles pour illuminer leurs nids...écoute, petite fille.
Je tendais l'oreille. La voix de Mame Soukey s'élevait vers la voûte céleste et mille bruits envahirent le cirque de Missira, l'écho des falaises nous renvoyait le chant des chutes d'eau, des gouttes qui s'entrechoquaient, dansaient, tintinnabulaient gaiement. Son chant était léger comme les ailes diaphanes des phalènes. Comme le chant sacré de Coumba Bang[2].
J'oubliais presque ma fugue. Les notes aériennes dissipaient peu à peu les cris de ma mère :
— Espèce de vaurienne, à force de suivre cette vieille folle, tu finiras comme elle...
C'était dans la case qui nous servait de cuisine africaine. J'avais maladroitement saisi une marmite et l'instant d'après, le dîner se retrouvait répandu sur le sol en terre battue. J'esquivais prestement une volée d'ustensiles et sous la pluie d'invectives, mes petits pieds nus se mirent à damer le sol irrégulier, insensibles à la brûlure de la chaleur et à la morsure des cailloux.
J'arrivai haletante à la lisière du bois puis me faufilai à travers un layon jusqu'à l'orbe où je savais qu'elle m'attendait. Le pavé d'herbes mortes crissait sous mes pas. Les lourdes feuilles de manguiers libéraient quelques larmes de pluie qui scintillaient, surprises par un rayon de soleil qui avait réussi à transpercer la canopée puis s'écrasaient en fine poussière aqueuse sur quelque pierre mousseuse. Au loin, les cascades dévalaient les façades rocheuses des falaises. Je trouvai Mame Soukey assise sur une grume d'hévéa, comme pour se nourrir de sa sève. J'arrivai par derrière et l'observai un instant. Elle semblait pensive. Son dos accusait une légère voussure.
— Tu es là, petiote ?
Je sursautai puis avançai timidement :
— Oui, Mame, je suis là.
— Assieds-toi près de moi, reprit-elle en se tournant vers moi. Elle avait un visage étonnamment lisse, parcouru de quelques fines ridules. Ses cheveux, cendres de lune comme elle se plaisait à les nommer, encadraient son visage comme une nimbe.
Je pris place en face de la vieille dame.
A travers les frondaisons des grands arbres, on apercevait un soleil strié se coucher. Et je restai là, comme chaque jour, plusieurs heures à l'écouter religieusement, fascinée par la richesse de sa science que je ne retrouvais pas dans les livres d'école. Je reprenais avec elle les chants traditionnels de notre forêt tropicale, je tapais frénétiquement sur des tiges de bambou et les racines adventices des figuiers banian pour mieux marquer la mesure.
Quand je regagnais nos habitations, la nuit était déjà tombée depuis bien longtemps.
Autour de notre concession, le linge se bousculait et dansait follement sur la corde tendue comme un archer auquel j'étais tentée de tirer deux-trois notes. J'arrivai à la dérobée de peur que mon approche fût remarquée et...la punition préparée ! J'entendais ma mère fulminer par instants :
— Cette petite ne deviendra jamais une femme, entre l'école des blancs et cette vieille à moitié folle qui veut en faire un singe, à rester le plus clair de son temps dans la forêt.
Je me mettais avec application à faire du feu dans un coin pour faire bouillir les feuilles de lalo[3] que je lui avais cueillies. M'avisant soudain, elle fulmina de plus belle feignant de ne pas me remarquer comme pour mieux me signifier son mépris.
C'était tous les soirs le même scénario.
| Janvier 1997 |
J'arrivai hors d'haleine au lieu indiqué sur l'annonce du journal. Le pavé d'herbes bruissantes était recouvert de neige. Ma tête tournait un peu. Je pris appui sur un poteau électrique que j'avais pris un instant pour un tronc d'eucalyptus. Je tirai sur mon bonnet de laine pour couvrir mes oreilles puis soufflai sur mes doigts à travers les gants, pour les réchauffer. Le vent me glaçait les côtes et faisait pleurer mes yeux. Mes larmes que je ne contenais plus, se figeaient et cristallisaient comme des stalactites.
Une queue serpentine ondoyait sur plusieurs dizaines de mètres, happée en une de ses extrémités par une porte cochère. A l'autre extrémité, moi...
Je ne sais pas si des secondes ou des heures s'écoulaient mais le monstre n'en finissait pas de coudoyer ses boyaux. Puis, je franchis à mon tour la porte cochère et une éternité après, une à une, les marches d'un escalier sombre menant à une porte sur laquelle était marqué en lettres capitales :
Du haut des marches, je fus prise d'un vertige nautique et je m'agrippai vivement à la rambarde. La jeune fille devant eut un petit sourire en coin. Quelques échos désaccordés s'échappaient de la porte mal insonorisée.
La porte soudain s'entrebâilla et un crâne chauve s'encadra dans l'espace du chambranle et du battant entrouvert.
— Suivant.
Je fus brutalement plongée dans une salle blafarde, immense et froide. Face à moi, une demi-douzaine de paires d'yeux qui me jugèrent, me jaugèrent, me déshabillèrent pendant quelques secondes. D'une voix blanche et neutre, le chauve rompit le silence :
— Vous avez une minute
Silence. La lumière des spots était crue et faisait pleurer mes yeux.
— Quarante secondes, reprit-il imperturbable, au bout d'un temps qui me paraissait être deux fractions de secondes, le bras plié en angle droit, les yeux sur sa montre. Le compteur tournait et ma gorge restait nouée.
J'étais pétrifiée. Je fermai les yeux. Le dôme du ciel surplombait l'orbe. Mame Soukey me regardait adossée aux racines échasses qui s'élevaient à quelques centimètres du fût d'un arbre aux contorsions noueuses... Je sentais la sève monter en moi en arborescence et m'irriguer jusque dans les capillarités des tréfonds de mon être, comme une poussée d'adrénaline. Ma voix puisait au fond de moi la sève tropicale qui coulait dans mes veines. L'écho des forêts afflua soudain à mes lèvres en un flot modulé. Il brisa brutalement la glace de ma gorge et des sons chauds inondèrent mes lèvres rompant les amarres du temps.
Ma frêle ossature vibrait autant que mes cordes vocales, dans un élan féerique. J'étais à nouveau dans ma forêt, frissonnant des caresses de ses feuilles, réchauffée par la moiteur et les senteurs de terre humide, sous le sourire complice de Mame Soukey.
Mes pieds s'enfonçaient dans les lichens de la moquette. J'oubliais les spots, le temps. Sous mes paupières closes, la nuit étendait le voile de son emprise et j'étais moi-même gagnée par ce doux engourdissement. Mon Marimba[4] que j'avais sorti timidement vibrait à présent du parfum de la nuit tropicale, des trilles des grillons et des insectes des ténèbres humides de fougères et d'eau. Ma voix arpentait les sentes humides du passé.
Je chantai pendant un temps si long qu'il me sembla durer des heures. A chaque instant, il me semblait mourir et renaître. Comme cette mélodie syncopée du creux de ma forêt natale, comme ma vie dans ce pays de vent, du jour où j'y ai débarqué avec une petite valise et un manteau trop grand. Je chantais ma vie, mon excitation, mon désespoir, mes larmes. Je chantais ma vie...dans un monde anesthésié de convenances où j'avais du mal à trouver ma place...
Ma voix se posa enfin et un silence ouaté envahit la pièce. Combien de minutes s'étaient-elles envolées. Le compte à rebours semblait grippé ou alors... pulvérisé. Quelques secondes s'écoulèrent sans qu'aucun membre du jury pût parler.
Sortant de sa torpeur hypnotique, rajustant la monture de ses lunettes, le chauve à la montre s'éclaircit la voix un bref instant puis fit :
Je... je vous remercie, mademoiselle.
© Nafissatou Dia Diouf
Notes:
[1] Grand-mère Soukey
[2] Déesse génie de l'eau
[3] poudre de feuilles de baobab servant de liant gluant dans la préparation de certains mets.
[4] Xylophone, dont chaque lame est prolongée par un résonateur en forme de tube.
[Retour à la page de Nafissatou Dia Diouf] | [Page d'accueil du site "Lire les femmes"]
Editor: ([email protected])
Created: 25 October 2001
Updated: 22 November 2001
https://aflit.arts.uwa.edu.au/IneditDiaDiouf.html