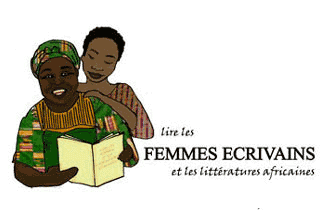
|
Les Pagnes mouillés Une nouvelle de Marie-Léontine Tsibinda 1997 |
*
Je tourne le bouton de mon poste radio pour prendre la température de la ville avant de sortir. La musique rit avec la vie. Ce rire trompeur me fait battre le coeur d'une manière accélérée. Ensuite la tristesse s'installe à la place du rire. C'est la liste des communiqués nécrologiques. Aucun nom connu. Je respire et la musique qui rit revient. J'esquisse quelques pas de danse. Le coeur suit le mouvement avec des minutes de retard. Alors, je sors de ma chambre, prends un seau, le remplis d'eau. Mon bain est rapide. A quoi bon traîner? Je prendrai tout mon temps ce soir avant de dormir, sous la caresse de l'eau chaude. Un pagne vite noué autour de ma poitrine, je regagne ma chambre. Un lit, une armoire avec une glace me renvoie mon image pulpeuse. Un nombril niché au creux de mon ventre satiné, des yeux noirs aux cils recourbés, des jambes fines et longues, un reflet assez flatteur me sourit d'un air complice.
Je gémis. Une digue se rompt en moi. J'ai refusé de penser à l'autre. Ne plus y penser. Le corps oublie-t-il jamais la main qui longtemps l'a réchauffé? Ses mains aux doigts fous sur mon dos entonnent une chanson folle. Ils sont le limkémbé et moi la danseuse.
Je ne veux pas de vous, souvenirs. Fuyez mon ciel, quittez-le. Je vous en supplie, libérez-moi. Attendez demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Je vous en supplie ne me submergez pas maintenant. Laissez-moi mes idées claires. Souvenirs, allez-vous en!
Un doigt plus fou que les autres se loge dans le creux de mon nombril et ma température monte. J'entends sa voix qui murmure des mots d'amour à mes oreilles. Je ris de ce rire insouciant qu'a le bonheur. Lentement, ma peau rencontre la sienne, ma bouche sa bouche. J'ai chaud et le corps me démange. Il me noie dans son sourire.
Je raisonne mes souvenirs. Je prends un jean, une chemise, un sac en bandoulière et je sors. Une fuite pratiquement. Dans la rue, la vie revient à la vie. Les feuilles des arbres brillent d'un éclat particulier. Les rues sont pleines de crevasses, qu'importe. Mes pas me conduisent vers la forêt au bord de l'eau. Je m'étends, ma tête repose sur sa poitrine. Les souvenirs m'attendent.
Le soleil fait son lit, l'heure du coucher approche. Sur l'eau, il bondit et sa rougeur dorée illumine les vaguellettes. Je me suis endormie sans doute. La nuit est déjà tombée quand je me réveille. La lune a sorti sa natte bleutée. Entourée de ses enfants, elle leur dit les contes du temps passé. Depuis ce jour, ma crainte s'est évanouie. Je marche dans les rues, les quartiers dévastés par la haine fébrile qui a habité les coeurs des hommes. La tristesse et l'hébêtement se lisent encore au fond des yeux des gens. Plus au fond de soi-même, la honte aussi d'avoir fait mal à son frère de sang, à sa soeur de coeur. Que de vies brisées! Que de mariages éclatés! Que de coups de canon, que de coups de fusil entendus dans la terreur des Kalachnikov! Pourquoi cette tuerie soudaine? Silence, la colonie exploite.
Ceux qui n'ont pas su tirer ont sorti des machettes, des sagaies. On a égorgé, on a scalpé, on a tranché les membres, on a sorti les intestins des corps morts, on les a portés comme colliers hideux. Femmes et enfants ont subi le même sort, le même destin sauvage, barbare et cruel.
La vie est têtue, elle revient et elle me dit que tu n'es pas près de moi. Je marche dans les quartiers dévastés. Je veux dominer ma peur coûte que coûte. J'ai l'impression qu'une personne va me dire: "Ici, j'ai vu le jour, j'ai grandi mais la haine m'a ôté la vie que Dieu donne...".
Te souviens-tu de ma panique après notre passage près de la boulangerie? Ce jour-là, à cause des tirs répétés, je n'ai pas envoyé les enfants chercher du pain. J'ai marché jusqu'à la boulangerie du quartier, la peur au ventre. Dans la rue, des enfants armés patrouillent. Ils ont l'âge des enfants de mes cousines: des gamins qui ont besoin d'affection. Ils ont les yeux dilatés par la drogue. Un faux pas, une fausse parole et tout est cuit, fini. Courir, impensable, tu te fais lyncher. Une âme de moins, qui s'en souviendra? Je pense aux parents qui ont essayé en vain de les dissuader de prendre les armes. Certains, hélas, ne sont plus de ce monde, ils ont été éliminés par leurs propres enfants brûlés par la fièvre des combats et la soif d'argent.
On leur promettait monts et merveilles: des études à l'étranger, l'intégration dans l'armée, des postes de directeur, ou de fonctionnaire international quand la victoire retentira. Les parents pleurent encore leurs gosses morts pour des causes qui leur étaient étrangères. Silence! La mère patrie le veut!
Les dalles de la route ont été enlevées. Il faut enjamber les caniveaux au risque de se casser les jambes. Les arbres aussi ont été taillés en morceaux, les ruisseaux de la ville ont vomi les vieilles carcasses qui dormaient dans leur lit.
Une foule devant la boulangerie crie: du pain! du pain!
— Eh, voisine, j'ai mouillé mes pagnes.
Je sens l'humidité de ses urines sur moi. La pauvre! Est-elle arrivée chez elle?
— J'ai six enfants dont quatre de mon mari. Mais, il n'est jamais là. Je n'ai plus d'argent en ce moment et je ne sais que faire. Ma banque est fermée depuis des lunes. Le plus jeune est malade. A cause des barricades, je ne puis me rendre à l'hôpital. Le jour où il a fait sa dernière crise, j'ai trouvé des jeunes que patrouillaient dans le quartier. Nous avons franchi les premiers barrages et aux suivants, ils m'ont abandonnée à mon propre sort. Ce n'était pas leur zone.
Une femme encore jeune que les meurtrissures de la vie n'ont pas épargnée. L'amertume se lit sur ses lèvres. Elle pleure. Elle a donc franchi les premiers barrages. Aux suivants, on lui a demandé de l'argent, on a fouillé dans son sac. Pendant que l'enfant luttait contre la mort, on lui demande un laissez-passer et puis sans laissez-passer où peut-elle aller? Les routes sont barrées. Retourne donc chez toi!
— Mon enfant est malade et il peut mourir.
— Ici, nous mourons de froid pour vous protéger et tu me parles d'un enfant! Demi-tour.
L'enfant a des convulsions. Comment l'en empêcher? Elle supplie sans succès. L'heure de grâce est passée. Les convulsions se suivent à un rythme que la mère ne contrôle plus, puis s'arrètent. Elle hurle à faire mal à un sourd. On lui intime l'ordre de la boucler. Elle a fini par enterrer son fils. Son mari n'est toujours pas là. Elle me raconte sa vie pendant que les coups de feu se répondent. Eh voisine, j'a mouillé mes pagnes. N'aie pas honte voisine, rentre à la maison, change-toi. Elle pleure. J'ai mouillé mes pagnes, mouillé mes pagnes. Ne pleure plus voisine. Ne pleure plus...
Nous étions toujours couchées. Une femme s'est avancée jusqu'à nous. Elle a peur. Elle craque elle aussi. Elle cherche notre compagnie. Elle tremble de tous ses membres. Elle claque des dents. Nous essayons de la consoler. Parle, voisine, parle, tu te sentiras moins seule.
— Je vais mourir à cause de la femme du neveu de mon père.
— Ta vie, c'est Dieu seul qui peut l'arrêter, ce n'est pas la femme du neveu de ton père.
— Un illettré qui a épousé une moundelé, c'est le monde à l'envers, je vous le dis. Malgré cela, elle veut toujours du pain. Et c'est moi qui doit l'acheter. C'est une Wandalienne qui ne parle même pas français. Mon oncle a eu trois fils. Le plus jeune est allé à Wanda pour y continuer ses études. A son retour, il a ramené une moundelé et des diplômes. Le temps aidant, sa famille s'est agrandie, la moundélé a eu six gosses: une moundélé avec six gosses de nos jours, c'est incroyable. Les enfants ont grandi comme au village: poisson salé, feuilles de manioc, viande de chasse, manioc. Ils ont appris la pêche artisanale et la chasse. Ils sont allés rarement en vacances au pays de leur mère. Mais le temps hélas, n'a pas été clément au couple. Le mari est mort d'une maladie mystérieuse. Bien avant que l'on enterre sa dépouille mortelle, le partage a déjà été fait: les biens allaient à la famille paternelle, les enfants et la femme au neveu de mon père. Scandale dans le village. Une moundélé qui épouse un mari imposé par la famille, on n'a jamais vu ça au village. Les moeurs ont bien changé! Et me voilà ici sous les balles à acheter du pain pour la moundélé.
Et l'autre, comme débloquée, me répète: "Eh! voisine, j'ai mouillé mes pagnes!".
Nous nous sommes raconté ces choses pour éviter que la peur ne nous entraîne, ne nous envahisse.
— Mon mari n'est pas de la même région que moi. Mes parents m'ont donné un ultimatum: eux ou lui. Comment lui annoncer que notre différence ethnique sera désormais notre fosse commune? Je lui ai donné la charge des enfants en attendant des jours meilleurs.
— Quand sortir de chez soi était encore possible, un soir, je suis allée chercher quelques provisions pour la famille. J'ai entendu un "qui va là" qui m'a glacée jusqu'aux os. J'ai regardé à gauche, puis à droite et je les ai vus. Ils étaient trois militaires. Mais par les temps qui courent, n'importe quel civil peut se procurer des tenues militaires. Il suffit de donner son nom aux chefs des milices dans le quartier. Ainsi, tu as en face de toi des capitaines, des colonels, des généraux. Bref, je me suis donc arrêtée. L'un d'eux a pris mon sac et l'a fouillé. Savait-il lire? Je n'avais trouvé que des boîtes de conserve. Il a pris mon bien et a jeté le sac à mes pieds. J'ai attendu qu'ils s'éloignent avant de le ramasser. Mes pauvres enfants, qu'allaient-ils manger ce jour-là?
— Tu as eu beaucoup de chance. Ils auraient pu te violer et te laisser la semence de Sidonie.
Que Dieu nous garde! C'est la misère, me suis-je dit, la misère corrosive qui gagne le coeur, le corps, l'esprit de l'homme. Eh! voisine, j'ai mouillé mes pagnes...
Après? La paix est revenue et je t'ai rencontré. Je t'ai raconté ces histoires.
Nous en avons pleuré de dépit et de honte, de colère et d'impuissance aussi. Nous ne nous sommes pas quittés jusqu'au jour où tu m'as dit:
— Je voyage, mon père est fonctionnaire international. Nous nous rendons à Vunda. Tu viendras dans mon pays?
J'ai encore pleuré. Et déjà j'étais ta prisonnière. La main dans la main, nous avons marché, ri et causé longtemps. Nous avons pris du jus de barbadine. Tu m'as bouleversée. Tu m'as dit des paroles sacrées "Je t'aime". J'ai refusé de te croire. Pourtant, j'ai senti mon coeur fondre comme miel au soleil. "Je t'aime". Et un soir, tu m'as raccompagnée, tu as découvert chez moi une maison louée. Mes parents ont péri dans la houle haineuse qui a traversé le pays. Tu as rencontré les enfants de mes cousines. Je n'ai senti aucune hostilité de la part de tes parents. Te souviens-tu? Nous avons mangé du poisson braisé et des bananes frites, bu de l'eau et nous étions saouls de bonheur. J'étais ta femme et tu étais mon homme.
J'ai longtemps pleuré après toi. Je savais que je te reverrais. Ton souvenir ne m'a jamais quittée. Moi aussi, je t'aime... Ici, la vie renaît à la vie... Je t'aime... Oh, oui, moi aussi... Eh, voisine, j'ai mouillé mes pagnes. Oui, voisine, mes pagnes mouillés...
© Marie-Léontine Tsibinda, 1997.
A quel prix! La bousculade m'entraîne tantôt à gauche, tantôt à droite. Je sors de la bâtisse en sueur, la lanière de ma sandale a cédé. Munie de mon bien, je rentre chez moi avec des compagnes de fortune. Soudain, des coups de feu éclatent. Des coups de canon aussi. Vite il nous faut un abri. Une maison délabrée nous sert de refuge. Dieu est grand, il saura nous sortir de cet enfer où nous plongent les coeurs cyniques. La séparation est inévitable. Je trouve les enfants sous le lit. Ils se jettent dans mes bras. On a encore tiré tantine.
Hélas, oui mon petit!
C'est la guerre?
Oui la guerre.
![]()
Wet Pagnes
English translation of this short story
by Kathleen McGovern, Goucher College (2005)
[Retour à la page de Marie-Léontine Tsibinda] | [Retour au journal MOTS PLURIELS]
| [Page d'accueil du site "Lire les femmes"]
Editor: ([email protected])
Created: 20 August 1997
Last updated: 22 May 2005
https://aflit.arts.uwa.edu.au/IneditTsibinda.html