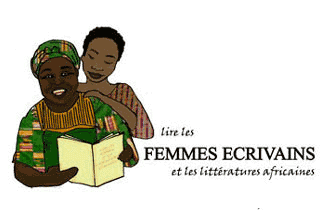
|
Le sourire de mes seize ans Une nouvelle d'Edna Marysca Merey Apinda 2016 |
*
– Edouard ! Coucou chéri !
Le sourire de ma femme me ramène sur terre. Je n'ai apparemment rien
écouté de tout ce qu'elle vient de dire.
– Tu rêves mon chéri. Que t'arrive-t-il ?
Ne sachant que lui répondre, je me lève de ce canapé sur
lequel je me sens soudainement à l'étroit. En m'approchant de la
fenêtre, je me rends compte qu'il pleut. Les gouttes de pluie caressent
le sol de l'allée qui mène au garage. Ce n'est pas un temps de
saison et je me demande pourquoi cette pluie s'invite dans une saison qui
devrait être sèche depuis bien des semaines. A ce rythme, nous
marcherons bientôt sur les mains.
– De quoi parles-tu ?
A la réflexion de ma femme, je me rends compte que j'ai parlé
tout haut.
– Si tu me disais ce qui ne va pas ce soir ? Tu as l'air
préoccupé.
Je regarde le visage de celle qui supporte mes sautes d'humeur depuis cinq ans et
je me demande si je dois répondre à sa question. Mon cœur se
serre. Quand je pense qu'hier à cette heure, je lui aurais souri en lui
répondant : « J'étais sur la lune, chérie. »
Si ce soir je lui disais cela, ce serait lui mentir. J'étais bien sur
terre, les pieds solidement retenus à cette fichue étendue de
matière qui fait de nous des humains. Et si je décide à
cette minute de me taire, le monde pourrait à jamais changer pour moi.
De même si je décide de parler. Ma sœur Camille m'a pourtant
prédit, il y a treize ans, ce que je vis maintenant. Elle me l'a dit un
soir où, lycéens, nous avons délaissé nos
révisions du bac pour faire un arrêt sur image de notre
passé.
– Je me suis retrouvé face au sourire de mes seize ans cet
après-midi.
Là, ma femme a du mal à saisir et me demande de
répéter ; mais je n'en ai pas le courage. Alors, comme pour
m'encourager, elle lance : « Je parie que ce sourire était taquin
et charmeur. »
Dieu ! Comment a-t-elle deviné cela ?
A des kilomètres de là.
– Tu rêves, mon ange. Cela fait deux minutes au moins que tu ne
m'écoutes plus.
J'aurais 40 ans que toujours maman m'appellera mon ange. Je suis l'unique
fruit de sa chair et son attention à mon égard a toujours
été celle d'une lionne envers ses petits. Je rentre juste d'un
séjour à Libreville chez ma tante Ernestine. Maman, impatiente
comme chaque fois que je reviens à la maison, attend que je
réponde à chacune de ses questions.
– Alors, raconte-moi tout, me fait-elle.
Elle est grande de taille, svelte. De mini tresses entourent son doux visage
et me donnent envie de l'embrasser, histoire de la taquiner comme je le fais
chaque fois qu'elle attend un mot de moi. Plus qu'une mère et un fils,
nous sommes amis. Elle est l'île sur laquelle je m'isole chaque fois que
je me sens mal. Je ne suis rien sans elle. Comme elle n'est rien sans moi. Je
lui souris et avec plus d'aplomb que je n'en espérais, je lui avoue :
« Je suis allé le voir. » Silence de mort. Si à cet
instant l'on demande à ma mère si elle souhaite devenir sourde,
elle dira oui. Pourtant, cette histoire, il faut que je la lui raconte.
– Je me suis retrouvé devant mon double. J'ai failli, en le voyant,
tomber en syncope. C'est l'être le plus arrogant qu'il m'ait
été donné de rencontrer.
Silence de mort. Les mouches absentes dans cette pièce, seraient les
bienvenues dans un pareil moment.
A vol d'oiseau.
– Je savais que cela arriverait un jour.
– Comment ça ? fais-je étonné.
– Oh rien ! C'est juste que Camille m'a déjà prévenue.
Camille ! Quel besoin a-t-elle eu de raconter tout cela à ma femme.
– Elle m'a dit qu'un jour je me retrouverais peut-être face à ton double. Au début j'ai pensé que, comme ta sœur ne m'aime pas tellement, elle me disait tout cela pour être désagréable. Mais, je vois que ce double, tu l'as rencontré avant moi. Dis-moi tout.
– Il est aussi robuste que je l'étais. Grand et beau, on dirait que Dieu s'est joué de moi en le faisant ainsi. Ou peut-être est-ce la vie qui a voulu me donner une claque. Je la mérite, n'est-ce pas ?
– Tu es trop dur avec toi-même, chéri.
Ma femme dirait n'importe quoi pour me remonter le moral. Pourtant, cet après-midi, je me suis rendu compte que le passé, jamais on ne l'enterre. Et si l'on pouvait tout gommer !
Je me souviens de la douceur du sable ce dimanche là. Un vent
léger taquinait nos oreilles au même rythme que la musique
qu'écoutaient mes cousins Karl, Stephen et Alex. Les filles, Camille,
Lisette et Annie avaient invité leurs amies Claudia, Alice,
Gisèle et Elisabeth. Nous avions secrètement
préparé cette sortie à la plage car nous savions que tante
Gina ne serait pas d'accord. Camille et moi étions arrivés
à Port-Gentil deux jours avant. Les cousins avaient exigé que
nous passions les vacances ensemble ; nos dernières vacances avant la
grande envolée vers l'étranger et le pensionnat qui allait nous
garder prisonniers jusqu'à notre baccalauréat. L'année
scolaire avait été parcellaire et maman craignait que notre
avenir ne soit remis en question du fait des grèves des professeurs et
les menaces d'année blanche. La démocratie était
arrivée à coups de fusil, grenades lacrymogènes et
couvre-feu. Après ces vacances, j'allais passer le reste de mon temps
à me demander comment il est possible d'oublier son premier amour.
Dès mon arrivée à Port-Gentil, ma cousine Annie m'avait
tanné en me répétant que je tomberais raide devant les
beaux yeux de son amie Stéphanie. Ce furent les yeux d'Elisabeth qui
allaient me couper le souffle. Elle était d'une timidité peu
commune et aujourd'hui encore, je me demande comment nous en sommes
arrivés deux semaines après notre rencontre, à nous
embrasser. Sur la bouche. Première fois pour elle. Moi, j'en avais
déjà embrassé deux avant elle. J'allais en classe de
3ème après deux redoublements à l'école primaire.
Ma sœur Camille, de deux ans ma cadette, était de fait dans la
même classe. Madame était et reste le cerveau dans la famille.
Elle prit Elisabeth en grippe, la trouvant trop nunuche. Pourtant, elle et moi
allions vivre une histoire d'amour peu commune.
A des kilomètres de là
– Qu'est ce qui t'a plu chez lui ? Ah ! tu me diras qu'il a dû changer depuis.
– Et si nous parlions d'autre chose, mon chéri ! Ce n'est pas comme cela que j'avais prévu notre soirée, me fit maman.
Loin de la laisser faire, je renchéris : « S'il apparaissait maintenant, que lui dirais-tu ? »
– Eh ! jeune homme, n'oublie pas que je suis ta mère. Ne me pose pas ce genre de question.
Notre différence d'âge n'a jamais été aussi ténue qu'en ce moment où son sourire me fait fondre. Enfant, il m'est arrivé de me demander si, jamais, maman ne pensait plus à lui.
– Il était doux, si tu savais. Il souriait comme tu le fais maintenant ; et nous avions beaucoup de goûts en commun. Je lisais beaucoup de bandes dessinées à l'époque ; lui aussi. Il écoutait Michael Jackson dont j'étais mordue. Et, il avait comme moi l'habitude de s'inventer des films lorsqu'il s'ennuyait. Dans les miens, j'étais une princesse ; dans les siens, il allait sur Mars ou sur la lune. Il était farfelu et cela m'a beaucoup plu en lui. Mais, si tu veux bien, arrêtons-nous là.
– D'accord, maman.
Mon arrivée annoncée, grand-père en avait fait une grippe.
Jamais il n'avait pardonné à grand-mère, qu'il jugeait
responsable d'avoir laissé leur fille unique glisser vers la mauvaise
pente. Il allait répéter des semaines et des semaines, durant la
grossesse de ma mère : « Et moi qui croyais qu'à cet
âge, vous vous contentiez de lire des Harlequin ! Dis-moi ma fille,
pourquoi t'es-tu pressée pour ce gros ventre ? Tu n'as que 16 ans.
»
Grand-mère allait devoir se taire. Chacune de ses interventions
irritaient mon grand-père au plus haut point. A mon arrivée, le
dégel s'amorça. Grand-père me baptisa Georges, comme feu
son père. Maman eut le droit d'ajouter Michael. Je porte le même
nom de famille que ma mère et parfois pour la taquiner, je l'appelle
grande sœur.
– Je ne regrette pas de t'avoir dans ma vie, je te l'ai déjà dit.
J'aurais aimé que tu aies un père comme les autres.
– Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis grand, beau et fort. Et tu sais
bien qu'avec grand-père, je n'ai manqué de rien.
– Ce vieux fou ! Je suis sûre que s'il était là ce soir,
nous n'aborderions pas ce sujet.
Grand-père, le miroir dans lequel je lisais mon avenir, s'est
brisé il y un an à peine. Grand-mère lui a survécu.
C'est à elle qu'en premier j'ai annoncé que j'ai fait une
rencontre spéciale à Libreville. « Ne me parle pas de ce
type », m'a-t-elle fait.
A des lieues de là.
– Jamais encore je ne me suis imaginé cette scène. Au plus profond de moi, je priais pour que jamais cela n'arrive. Il m'a simplement regardé ; m'a dit bonjour et est resté là à m'ausculter. J'étais franchement mal à l'aise, chérie.
– J'imagine. Et ensuite ?
Que dire. Que ce jeune homme voulait juste voir à quoi je ressemblais. Il passait par hasard dans les couloirs du ministère des finances où je travaille. Il a suivi comme une ombre ce visage dont la vue l'a foudroyé. Il a cogné à ma porte. Ma secrétaire étant absente, je me suis levé pour aller ouvrir. Et là, stupéfaction.
– J'ai été assez maladroit, je pense. Je lui ai proposé de l'argent. Sais-tu ce qu'il a répondu !?
– Non, mais tu vas me le dire.
– Il m'a dit qu'il en aurait besoin pour cirer ses chaussures.
– C'est bien ton fils.
Réplique étonnante de la part d'une femme qui jamais ne me donnera de garçon. Nous avons eu Suzanne et Stella, nos jumelles, il y a trois ans, et la malchance a voulu que ma femme subisse l'ablation de l'unique trompe qu'il lui restait.
L'anniversaire de ma cousine Annie tombait un 1er Août. Nous avions
organisé la boom du siècle. Mes cousins avaient toujours une
idée d'avance dans tout ce qui concernait la fête. Les amis
vinrent en masse. Ma cousine avait cela de particulier qu'elle connaissait tout
le quartier, la ville, ajoutait la tante Gina en riant. La soirée fut
haute en couleur. Nous avions tout préparé nous-mêmes. La
cousine Annie voulait que ses 17 ans soient mémorables. Cette date
allait me marquer.
J'allais serrer Elisabeth dans mes bras pendant toute la soirée,
refusant de la laisser danser avec quelqu'un d'autre. Les cousins me
taquinaient : « Tu es fou amoureux, ma parole. » Les premiers
amours sont d'une fulgurance inégalable. Nous avons parlé des
heures et des heures, trouvant toujours quelque chose à dire. Elle me
faisait rire et je fondais chaque fois qu'elle souriait. J'étais idiot.
Amoureux. Nous nous sommes embrassés encore et encore, à l'abri
des regards, dans un coin du jardin, sous un manguier. Je lui ai
récité un poème que j'avais lu la veille dans les livres
d'une cousine. Jeunesse !
Et nous en sommes arrivés, musique douce aidant, au flirt
poussé, comme l'on disait à l'époque. Et une semaine plus
tard, j'allais lui demander si elle voulait aller plus loin. Elle ne
répondit rien. Et deux semaines plus tard, trois jours avant mon
départ, nous nous retrouvâmes tout nus, sur le lit de ma cousine
Annie. Elle était complètement paniquée. J'étais
confiant, allez savoir comment. Et nous fîmes ce qui s'appelle l'amour,
chose qui allait laisser son visage hagard et moi, l'air bête. J'en avais
parlé avant avec mes amis et cousins. Ils m'avaient bourré le
crâne de conseils, dont j'ai oublié le plus important. Les minutes
qui suivirent le « grand moment » allaient être mortellement
silencieuses. Elisabeth s'habilla précipitamment et s'en alla de la
maison en courant.
Il lui fallut deux jours pour se remettre de ses émotions. Le matin de
mon départ, elle vint cogner à la fenêtre de ma chambre. Je
sortis la rejoindre alors qu'il n'était que quatre heures du matin. Là,
nous sommes restés des siècles dans les bras l'un de l'autre. Et
nous avons ensuite procédé à notre éternel
échange de salive. Je partais en promettant d'écrire tous les
jours, d'appeler. Sa crainte était qu'une fois en France, entouré
de filles plus belles les unes que les autres, je l'oublie. Pourtant, je
m'entendis promettre : « Nous passerons les prochaines grandes vacances
ensemble. Je reviendrai à Port-Gentil rien que pour toi. Je t'aime,
Elisa. »
De lettres, depuis mon pensionnat du Quercy, j'en écrivis trois
jusqu'à ce que le froid, l'enfermement, le désespoir et le mal du
pays qui m'habitaient, ne viennent mettre fin à mon exercice dominical.
Et jamais mes lettres n'eurent de réponse. Cinq mois plus tard, ma
mère, et le peu de délicatesse qui la caractérise, allait
me menacer de tout au téléphone.
A des kilomètres de là
– Je revois encore sa mère me traiter de putain. Elle était spécialement venue de Libreville répéter à mes parents qu'ils n'auraient rien d'elle et que l'enfant que je portais n'était pas celui de son fils. Sa tante Gina, dont je fréquentais les filles depuis la maternelle, me sortit de son vocabulaire. Elle ne voulait surtout pas que tu sois son fardeau, elle qui n'avait rien demandé. Ton père était parti. J'ai ouï dire par une amie, qu'il n'était rentré qu'il y a deux ans, à la mort de sa mère.
– Il m'a dit qu'il est marié à une Française et qu'ils ont des enfants. J'ai eu comme l'impression qu'il espérait que jamais je ne fasse intrusion dans sa vie.
– Comme dit toujours ta grand-mère, là où s'est établi le silence, il est toujours malvenu de jouer du tam-tam.
Ce que je sais des entrelacements de cette histoire, m'a été
raconté par mon grand-père alors qu'il savait qu'il allait
bientôt mourir. Il me raconta comment avec une indélicatesse
folle, la mère de mon paternel leur avait lancé au visage, une
liasse de billets de banque en leur disant que c'était tout ce qu'ils
tireraient de son mari et d'elle. Mon grand-père me dit comment il marcha
sur ses billets pour rendre à cette femme, à l'arrogance sans
borne, la monnaie de sa pièce. Lui si fier, se faire insulter par cette
femme !
« Ta grand-mère a soigneusement ramassé ces billets en
disant à cette femme qu'un jour tu en aurais besoin comme outil de
travail, car tu deviendrais cireur de chaussures. Je suis désolé
de partir si tôt, moi qui rêvais de voir le grand médecin
que tu seras », m'a fait grand-père. « J'espère que
ta réussite en bouchera un coin à toutes ces bécasses qui
ont tourné le dos à ta mère alors qu'elles étaient
amies. »
Grand-père est mort et l'une des bécasses en question m'a un
jour interpellé dans un supermarché, me disant combien je
ressemblais à mon père. C'était Annie. J'en parlai
à ma mère qui me répondit : « Elle ne m'a plus dit
bonjour depuis des lustres. C'est cela qui pour moi a été le plus
dur. »
Le ballon de foot que je reçu le jour de mes cinq ans, venait de loin.
Ce ne fut que l'an dernier, que j'ai su que ma tante, Camille,
m'écrivait chaque année à Noël et m'envoyait des
cadeaux que l'on me remettait parfois en omettant de me dire d'où ils
venaient. Elle vit aujourd'hui aux Etats-Unis d'où elle a écrit
à maman il y a deux ans maintenant.
A des années-lumière.
– J'ai écopé de dix ans d'exil forcé, grâce à ma mère. Ensuite, je t'ai rencontrée. Peut-être aurais-je dû dès le début te raconter cette histoire. Mais, parfois, j'avais l'impression que cela n'était que le fruit de mon imagination et que les nouvelles que me donnait ma sœur Camille, n'étaient que fiction. Pourtant, ce sourire dont elle me menaçait souvent est apparu à ma porte aujourd'hui. Et, excuse-moi, je suis un peu chamboulé.
– Je comprends, chéri.
Je me retourne vers ma femme et me demande comment elle peut me comprendre. J'ai eu l'opportunité pendant mon exil français de rentrer au pays trois fois. Jamais il ne m'est venu à l'idée d'aller à Port-Gentil, voir si le sable des grandes vacances de mes seize ans avait toujours la même couleur. Ensuite, je me suis marié et j'ai cherché à effacer Elisabeth de ma mémoire. Y suis-je parvenu ? Seul Dieu le sait. J'ai appris par Camille, qu'elle est devenue sage-femme et j'ai remercié le ciel de nous avoir épargné un autre échec.
Le sourire que j'ai rencontré cet après-midi n'était pas haineux et je dis tant mieux. Dieu merci. Puis-je avouer à la femme qui a uni sa vie à la mienne, que je meure d'envie de revoir ce sourire et de le photographier ? Comment le prendrait-elle ?
Maman s'est arrêté de parler depuis quelques instants. Je la regarde égoutter les pâtes, notre repas de ce soir. Il semble que son esprit s'est envolé, comme c'est le cas chaque fois qu'elle est contrariée. Je me demande si j'ai bien fait de lui parler de tout cela ; mais au fond, je sais qu'un jour ou l'autre, le sujet se serait imposé à nous. J'ai dit à cet homme que je vais en classe de 1ère – ce qui est vrai – comme si inconsciemment, j'avais besoin qu'il soit fier de moi.
© Edna Marysca Merey Apinda, 2006
[Retour à la page d'Edna Marysca Merey Apinda] | [Je suis d'elle, une nouvelle d'Edna Marysca Merey Apinda] | [Page d'accueil du site "Lire les femmes]
Editor: ([email protected])
The University of Western Australia/French
Created: 26 July 2006.
https://aflit.arts.uwa.edu.au/Ineditmerey_apinda3.html