
|
. |
Lire les femmes This article in English Femmes à l'époque coloniale Ecrivaines depuis les années 1960 |
| Vivre en marge des conventions |
| La face cachée du monde colonial africain au 20e siècle. |
La production littéraire des femmes d'origine européenne dans l'univers colonial africain du 20e siècle ne peut être comprise qu'en fonction du contexte socioculturel qui en a marqué les formes et limité la portée. Dès ses débuts, la colonisation de l'Afrique a été une affaire d'hommes et l'intervention des femmes a toujours été perçue comme une incongruité lorsque « les coloniales » ne se contentaient pas de « compléter [...] l'œuvre civilisatrice de leur compagnon »[1]. Comme le proclamait Marie-Louise Comeliau en 1945 dans son guide à l'usage des « Eves modernes » en route pour le Congo, la femme libre et indépendante n'avait pas sa place en Afrique[2], du moins officiellement.
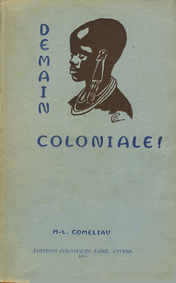 Les écrivaines de l'époque coloniale que nous avons
rencontrées au hasard de nos lectures expriment plus ou moins
ouvertement les pesanteurs de ce sexisme institutionnel. Cependant, une image
différente de celle que l'on pourrait imaginer en lisant le Guide de
Marie-Louise Comeliau est inscrite en filigrane de leurs témoignages. Les femmes
– mariées ou non – que nous y avons rencontrées ne
s'étendent guère sur leurs « incapacités » et
leurs « faiblesses » présumées mais sur leurs
réussites. Certes, notre échantillon est très lacunaire.
Il s'étend sur plus de cinquante ans, touche à toute l'Afrique
noire et dépasse le cadre des ouvrages écrits en français;
cependant, il souligne sans équivoque que « l'histoire de
l'Afrique abonde en femmes fortes et indépendantes »[3]. Leur témoignage permet de mieux connaître
notre passé et d'abandonner quelques idées reçues.
Les écrivaines de l'époque coloniale que nous avons
rencontrées au hasard de nos lectures expriment plus ou moins
ouvertement les pesanteurs de ce sexisme institutionnel. Cependant, une image
différente de celle que l'on pourrait imaginer en lisant le Guide de
Marie-Louise Comeliau est inscrite en filigrane de leurs témoignages. Les femmes
– mariées ou non – que nous y avons rencontrées ne
s'étendent guère sur leurs « incapacités » et
leurs « faiblesses » présumées mais sur leurs
réussites. Certes, notre échantillon est très lacunaire.
Il s'étend sur plus de cinquante ans, touche à toute l'Afrique
noire et dépasse le cadre des ouvrages écrits en français;
cependant, il souligne sans équivoque que « l'histoire de
l'Afrique abonde en femmes fortes et indépendantes »[3]. Leur témoignage permet de mieux connaître
notre passé et d'abandonner quelques idées reçues.
Premier exemple: un article récent de Faranirina V. Rajaonah consacré à l'étude de quelques manuels de lecture malgaches à l'usage des écoles d'aujourd'hui, analyse un petit texte de Suzanne Andriamahanina et Marcel Ratsima, qui raconte l'histoire de deux enfants, Niry et son jeune frère Nary, invités à un baptême de l'air par leur oncle qui est un pilote de la compagnie nationale. Lorsque la jeune fille émet l'idée de devenir pilote, ni son frère ni les hommes de la famille ne prennent au sérieux son ambition. Pour eux, il est évident que le métier de pilote ne peut être envisagé que pour un homme. « Pour preuve, dit Nary: [on] ne connaît aucune femme dans la carrière »[4]. C'est bien sûr une erreur de sa part ! Des femmes pilotes, il y en a eu en Afrique comme ailleurs, mais leurs exploits n'ont pas connu la faveur des livres d'histoire. Dès lors comment les hauts-faits des pionnières de l'aviation africaine auraient-ils pu influencer la manière de penser de deux jeunes Malgaches à la fin du 20e siècle ? Comment auraient-ils pu inciter ces enfants à « rompre avec des clichés qui ont la vie dure »[5] ? Comment auraient-ils pu faire évoluer « les représentations des femmes et [...] la définition de leurs rapports aux hommes »[6] ? La réponse est simple: ce n'était pas possible. Les deux enfants ne pouvaient pas deviner qu'une contemporaine de leur arrière-grand-mère avait déjà sillonné les cieux africains plusieurs décennies avant leur naissance.[*]
 Dans un univers littéraire dont les ouvrages canoniques sur l'aviation
se limitent aux exploits de quelques pionniers de l'Aéropostale,
l'autobiographie de la Kenyane Beryl Markham, Vers l'Ouest avec la
nuit[7], ne pèse pas lourd. Cette
œuvre est pourtant intéressante car elle souligne la
réussite d'une femme ayant su s'imposer dans un domaine jalousement
gardé par les hommes. Beryl Markham apprit à piloter en 1931
à Nairobi – une ville où elle était arrivée en 1906
avec son père à l'âge de quatre ans – et son autobiographie
publiée en 1942 consacre plusieurs chapitres à son
activité de pilote:
Dans un univers littéraire dont les ouvrages canoniques sur l'aviation
se limitent aux exploits de quelques pionniers de l'Aéropostale,
l'autobiographie de la Kenyane Beryl Markham, Vers l'Ouest avec la
nuit[7], ne pèse pas lourd. Cette
œuvre est pourtant intéressante car elle souligne la
réussite d'une femme ayant su s'imposer dans un domaine jalousement
gardé par les hommes. Beryl Markham apprit à piloter en 1931
à Nairobi – une ville où elle était arrivée en 1906
avec son père à l'âge de quatre ans – et son autobiographie
publiée en 1942 consacre plusieurs chapitres à son
activité de pilote:
-
Tom, dit-elle, commença mon apprentissage sur un DH Gipsy Moth, et son
hélice pulvérisait le silence de l'aube sur les plaines de
l'Athi. [...] Je vis l'alchimie de la perspective réduire le monde que
je connaissais, et tout le reste de ma vie, aux dimensions de grains de
blé dans une tasse. J'appris à observer, à mettre ma
confiance dans d'autres mains que les miennes. Et j'appris à partir
à l'aventure. J'appris ce que tout enfant imaginatif a besoin de savoir
– qu'il n'existe pas d'horizon si lointain qu'on ne puisse survoler et
dépasser[8].
Après un millier d'heures de vol, Beryl Markham obtient une licence de pilote professionnel et elle se lance dans le transport de courrier, des marchandises et des passagers. Elle s'élance jour après jour « vers le Soudan anglo-égyptien, le Tanganyika, la Rhodésie du Nord ou n'importe quelle autre destination où, dit-elle, m'appelait un contrat »[9]. Elle se rend à plusieurs reprises en Angleterre et en 1936 elle devient la première femme à traverser l'Atlantique solo d'est en ouest.
Beryl Markham montre de toute évidence que l'Afrique coloniale compte des femmes ayant conquis les airs depuis longtemps, mais il est important de souligner qu'elle n'était pas la seule femme pilote que l'on aurait pu donner en exemple à Niry, à Nary et à tous leurs camarades, à Madagascar et dans le reste du monde. On aurait aussi pu citer la Française Marie Marvingt qui fut pilote militaire pendant la première guerre mondiale ou l'Américaine Bessie Coleman qui fut la première femme noire à obtenir une licence de pilote en 1921 – en France car l'administration américaine lui refusait le droit d'apprendre à voler en raison de son sexe et de sa race[10].
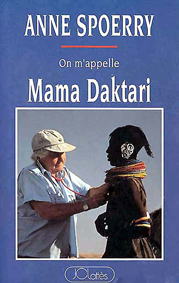 Et puis, pour revenir à l'Afrique, on aurait aussi pu mentionner Anne
Spoerry, une femme médecin dont la destinée a été
immortalisée par son autobiographie On m'appelle Mama Daktari[11]. Quelques années après sa
libération de Ravensbrück, en 1945, Anne Spoerry part pour
l'Ethiopie et se retrouve au Kenya au début des années 1950. Elle
y est fraîchement accueillie par les autorités coloniales car, pas
plus que le Congo de Marie-Louise Comeliau, le Kenya sous domination anglaise
n'échappe aux visions stéréotypées du rôle de
la femme coloniale:
Et puis, pour revenir à l'Afrique, on aurait aussi pu mentionner Anne
Spoerry, une femme médecin dont la destinée a été
immortalisée par son autobiographie On m'appelle Mama Daktari[11]. Quelques années après sa
libération de Ravensbrück, en 1945, Anne Spoerry part pour
l'Ethiopie et se retrouve au Kenya au début des années 1950. Elle
y est fraîchement accueillie par les autorités coloniales car, pas
plus que le Congo de Marie-Louise Comeliau, le Kenya sous domination anglaise
n'échappe aux visions stéréotypées du rôle de
la femme coloniale:
– Une femme médecin, jamais. Et pas mariée en plus. Sa présence risque de perturber les jeunes administrateurs de cette région.
– Il était inutile d'insister[12].
Au terme de plusieurs postulations rejetées pour les mêmes raisons, Anne Spoerry finit quand même par obtenir un poste de docteur à Ol Kalou, une petite communauté rurale du Kenya située à 2 500 m d'altitude:
-
J'avais un petit cabinet de consultation dans le village, dit-elle. J'ai
loué une maison sur une ferme proche, à un kilomètre et
demi. La propriétaire, Mary Patten, voulait tout faire au monde pour que
le nouveau docteur s'installe confortablement. Elle s'est donnée
beaucoup de peine pour mon installation. C'était agréable de se
sentir enfin désirée[13].
Il vaudrait la peine de retracer la vie de ce médecin de campagne qui parcourait le terrain au volant de sa 203, mais c'est au titre de pilote que nous l'avons convoquée et ce n'est que dix ans après son arrivée au Kenya, au moment de l'indépendance qui l'obligea à quitter Ol Kalou et à réorienter sa carrière, qu'elle décida d'apprendre à piloter un avion[14]:
-
J'ai pris ma première leçon de pilotage le 23 juin 1963,
dit-elle. J'avais toujours eu envie d'apprendre à voler, tout comme
j'aimais barrer les bateaux, monter les chevaux, ou conduire des voitures. Et
pour la même raison: apprivoiser un animal ou dominer un instrument pour
acquérir un nouvel espace de liberté. Le temps et l'occasion
m'avaient manqué jusque-là. Les changements qui bouleversaient
alors le Kenya me décidèrent à passer à l'acte.
[...]
J'étais assez déprimée, l'avion fut d'abord un exutoire à mes angoisses, et une consolation. Je n'imaginais pas encore que je rejoindrais Michael Wood et ses médecins volants, mais je sentais confusément qu'il fallait que je me lance dans une voie nouvelle, et qu'être pilote m'y aiderait[15].
La suite de l'histoire d'Anne Spoerry appartient à la légende: elle acheta son premier avion en 1964, rejoignit les « médecins volants » de L'American Medical and Research Foundation (AMREF) l'année suivante et collabora avec cette organisation pendant plus de trente ans.
Bessie Coleman, Beryl Markham, Anne Spoerry, dans un domaine différent, Anita Conti – l'océanographe française qui passa dix ans à explorer la mangrove entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour établir des cartes de pêche des côtes africaines[16] –, bien d'autres encore, firent fi des conventions sociales en s'affirmant dans des domaines alors réservés aux hommes. Toutefois, ces femmes à la forte personnalité ne furent pas les seules à favoriser une évolution des mentalités et à abandonner le rôle secondaire qui leur avait été attribué. Ainsi, la femme mariée qui avait « tout naturellement suivi ou rejoint en Afrique l'homme qu'elle aimait » – pour reprendre les termes de Marie-Louise Comeliau – se retrouvait à la même enseigne que les célibataires lorsque « l'élément fort sur lequel elle était censée s'appuyer »[17] sortait de sa vie pour une raison ou pour une autre et la laissait en charge du patrimoine familial. Quelques exemples:
Mary Patten d'abord. La propriétaire de la maison louée par Anne Spoerry s'occupe elle-même d'une partie de sa propriété et loue le reste. Elle n'a ni mari ni enfants au moment de sa mort, en 1959 (est-elle veuve ? on ne le sait, mais c'est un filleul qui hérite de ses biens). Le fait qu'elle ait été sans attaches familiales explique peut-être en partie sa liberté d'action et son attitude vis-à-vis du Dr Spoerry dans les années 1950. Elle n'a besoin de demander l'avis de personne pour apporter son soutien au nouveau docteur et agir sans s'occuper du qu'en-dira-t-on.
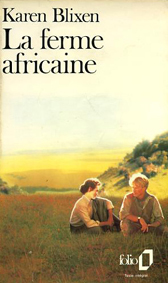 La Danoise Karen Blixen, ensuite. Sa correspondance et son
célèbre roman autobiographique La ferme africaine[18] nous permettent de quitter le domaine des
hypothèses pour entrer dans celui des témoignages. Partie au
Kenya en 1914 pour y épouser le Baron Bror von Blixen-Finecke, elle y
fut reçue en grande pompe par son futur mari, comme elle
l'écrivait à sa mère dans une lettre datée de
janvier 1914:
La Danoise Karen Blixen, ensuite. Sa correspondance et son
célèbre roman autobiographique La ferme africaine[18] nous permettent de quitter le domaine des
hypothèses pour entrer dans celui des témoignages. Partie au
Kenya en 1914 pour y épouser le Baron Bror von Blixen-Finecke, elle y
fut reçue en grande pompe par son futur mari, comme elle
l'écrivait à sa mère dans une lettre datée de
janvier 1914:
-
Bror était à Mombasa pour m'accueillir et c'était
merveilleux de retrouver quelqu'un avec qui j'avais le sentiment de devoir
partager ma vie. [...]
... à onze heures nous étions mariés, avec Sjøgren, Prince Vilhelm, Bostrøm et Lewenhaupt comme témoins. Ce fut très simple et sans complications. Cela prit au plus dix minutes. Ensuite de quoi, nous partîmes en rickshaw pour déjeûner avec Hobley qui venait de nous marier; il possède une villa vraiment magnifique sur le rivage. De là nous prîmes le train – un train spécial pour Prince Vilhelm, avec le wagon restaurant privé du Gouverneur [...]
Une surprise m'avait été réservée lors de notre arrivée à la ferme. Les mille boys avaient été alignés en rangs et après une bienvenue assourdissante, ils nous suivirent jusqu'à la maison[19].
Malheureusement, la lune de miel des époux fut de courte durée car Karen Blixen se rendit rapidement compte que son mari n'avait pas l'étoffe d'un homme d'affaires et qu'il était incapable de diriger l'immense plantation de café achetée par sa famille aux portes de Nairobi. De plus, la relation entre les époux se dégrada rapidement lorsque Karen Blixen se rendit aussi compte que son mari papillonnait, qu'elle avait contracté la syphilis et qu'elle rencontra Denys Finch Hatton dont elle tomba amoureuse. En 1921, poussée par sa famille qui avait investi des sommes considérables dans l'affaire, Karen Blixen fut obligée de reprendre officiellement la direction de la ferme et de la plantation de café des mains de son mari qui fut démis de ses fonctions. Cela précipita une séparation définitive des conjoints dont le divorce fut prononcé en 1925. En contraste avec Beryl Markham et Anne Spoerry, la décision de Karen Blixen de rompre avec son mari et de prendre la direction d'une vaste entreprise agricole au cœur de l'Afrique ne résulte ni d'un désir d'émancipation ni d'un rejet des conventions sociales mais de la situation difficile dans laquelle l'a mise un mari coureur, dépensier et incompétent. Le résultat est pourtant le même dans la mesure où il bat en brèche le mythe d'un élément masculin fort sur lequel s'appuie la faiblesse ou l'incapacité de la femme coloniale.
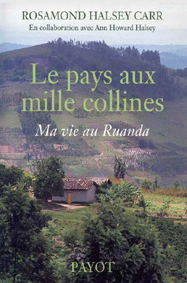 Un autre livre évoquant une trajectoire de vie similaire, une
génération après Karen Blixen, est dû à
l'Américaine Rosamond Halsey Carr qui rencontra et épousa
l'explorateur Kenneth Carr lors d'une tournée de conférences de
ce dernier aux Etats-Unis en 1942. En 1949, le couple décide de partir
pour le Rwanda/Burundi où Kenneth Carr entendait se lancer dans la
prospection minière. Cependant, faute d'obtenir les autorisations
voulues, il se retrouve au Congo, gérant d'une plantation de
pyrèthre – une plante avec laquelle on fabriquait les insecticides.
Comme ce fut le cas pour Karen Blixen, le mari de Rosamond Halsey Carr se lassa
vite de sa vie de gérant:
Un autre livre évoquant une trajectoire de vie similaire, une
génération après Karen Blixen, est dû à
l'Américaine Rosamond Halsey Carr qui rencontra et épousa
l'explorateur Kenneth Carr lors d'une tournée de conférences de
ce dernier aux Etats-Unis en 1942. En 1949, le couple décide de partir
pour le Rwanda/Burundi où Kenneth Carr entendait se lancer dans la
prospection minière. Cependant, faute d'obtenir les autorisations
voulues, il se retrouve au Congo, gérant d'une plantation de
pyrèthre – une plante avec laquelle on fabriquait les insecticides.
Comme ce fut le cas pour Karen Blixen, le mari de Rosamond Halsey Carr se lassa
vite de sa vie de gérant:
Ma curiosité initiale mêlée de réticence face à une culture si différente de la mienne avait d'ailleurs rapidement fait place à d'authentiques sentiments de respect et d'admiration. J'avais trouvé parmi les Africains quelques-uns de mes meilleurs amis.
Heureusement, car la vie de famille heureuse que je souhaitais mener s'avéra bien vite illusoire. Kenneth était toujours loin – en safari ou en quête d'aventure – et il me laissait seule des semaines entières. Effrayée, j'avais le sentiment d'être abandonnée et, inconsolable, je passais des heures à pleurer sur mon triste sort. Peu à peu, cependant, je me mis à accompagner Cléophas dans ses tournées d'inspection. J'appris bientôt à parler le swahili et compris peu à peu comment diriger une plantation[20].
Trop souvent abandonnée par son mari, Rosamond Halsey Carr commence alors à voler de ses propres ailes et lorsqu'un ami de la famille décide de partir pour sept mois en vacances en Europe, elle s'offre pour diriger sa plantation pendant son absence. Cela signifiait prendre la responsabilité d'un domaine qui comptait plus de 280 personnes employées à la culture du pyrèthre.
-
Ken, dit-elle, était stupéfait que je pusse seulement envisager
cette idée qu'il jugeait déplacée et déraisonnable.
J'étais, selon lui, totalement incapable de m'acquitter seule de cette
tâche. Pourtant, ma décision était prise. J'imaginais que,
peut-être, cette petite séparation nous ferait du bien à
tous les deux[21].
Loin de rapprocher les époux, cette expérience les sépare définitivement et, après plusieurs années difficiles, Rosamond Halsey Carr finit par acquérir sa propre plantation en 1955. Elle y vivra jusqu'aux massacres qui ensanglantèrent le Rwanda en 1994. Sa destinée illustre les difficultés, mais aussi les réussites de milliers de femmes largement ignorées par l'Histoire car leur succès dans le monde du travail cadrait mal avec une orthodoxie coloniale n'accordant aux femmes qu'une importance très secondaire dans les affaires de la colonie.
Si l'idée d'une pilote ou d'une chèfe d'entreprise était à peine tolérée car elle empiétait sur des privilèges masculins solidement ancrés, celle d'une femme partant seule à la conquête de l'Afrique, armée pour tout bagage de son courage, de son carnet de notes et de son appareil de photos, était encore plus mal comprise. La mission civilisatrice de l'Europe exigeait que les hommes travaillent et que les femmes assurent les arrières. Aussi, l'idée d'une aventurière parcourant l'Afrique en solitaire pour son bon plaisir semblait extravagante. De plus, comment une « pauvre femme » pouvait-elle imaginer pouvoir se déplacer et survivre dans un environnement hostile sans le secours d'une escorte bien armée et d'hommes rompus aux techniques de « pacification » des indigènes ? Plusieurs ouvrages quasiment oubliés montrent cependant qu'en dépit des obstacles, de nombreuses Européennes réussirent à vaincre les résistances sociales et administratives, et suivirent l'exemple de l'Anglaise Mary H. Kingsley qui, au 19e siècle, parcourut seule des milliers de kilomètres en Afrique de l'Ouest. Ces voyageuses sans « mission particulière » entendaient tout simplement découvrir les régions où elles arrivaient, sans prétention ni arrière-pensées[22]. Elles n'entendaient imposer ni leurs vues, ni leur religion, ni même leur présence si elle n'était pas désirée. Et c'est ce refus de participer au « développement » des colonies selon les règles établies par les autorités coloniales qui fait tout l'intérêt de leurs témoignages: il propose une vision alternative du rapport de l'individu au monde qui l'entoure.
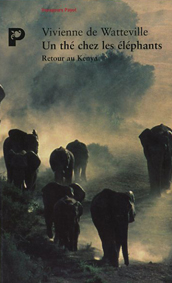 Deux ouvrages de la jeune aristocrate anglo-helvétique Vivienne de
Watteville, Un thé chez les éléphants. Retour au
Kenya et Petite musique de chambre sur le mont Kenya offrent un
exemple particulièrement intéressant à cet
égard[23]. Ces romans autobiographiques publiés au
début des années 1930 relatent le séjour de
l'auteur au Kenya – un pays où le père de la narratrice avait
été tué par un lion quatre ans auparavant. Vivienne de
Watteville est jeune, célibataire, riche, indépendante mais
plutôt que de marcher dans le sillage de feu son père en
organisant à son tour un grand safari destiné à alimenter
le marché de l'ivoire et les musées d'histoire naturelle, elle
décide de redécouvrir l'Afrique à sa manière et
sans se préoccuper des conventions:
Deux ouvrages de la jeune aristocrate anglo-helvétique Vivienne de
Watteville, Un thé chez les éléphants. Retour au
Kenya et Petite musique de chambre sur le mont Kenya offrent un
exemple particulièrement intéressant à cet
égard[23]. Ces romans autobiographiques publiés au
début des années 1930 relatent le séjour de
l'auteur au Kenya – un pays où le père de la narratrice avait
été tué par un lion quatre ans auparavant. Vivienne de
Watteville est jeune, célibataire, riche, indépendante mais
plutôt que de marcher dans le sillage de feu son père en
organisant à son tour un grand safari destiné à alimenter
le marché de l'ivoire et les musées d'histoire naturelle, elle
décide de redécouvrir l'Afrique à sa manière et
sans se préoccuper des conventions:
-
Autrefois, dit-elle, j'étais partie avec mon père, pour
réunir, à l'intention du Muséum de Berne, des
spécimens de la faune de l'Afrique Orientale. ç'avait
été son rêve [...] Mais mon rêve à moi,
ç`avait toujours été de m'en aller dans la brousse, sans
armes, et, pour ainsi dire, sans arrière-pensée, et de gagner
l'amitié des bêtes sauvages [...]
Et maintenant, je retournais en Afrique, selon mon gré[24].
Cette volonté d'établir des relations différentes avec la faune africaine allait prendre un essor considérable au cours des générations suivantes[25]. Toutefois, à l'heure où Vivienne de Watteville émettait des idées considérées comme « folles », personne n'en percevait la valeur. Hormis les encouragements de sa grand-mère qui, dit-la narratrice, « se laissait infailliblement gagner par mon enthousiasme »[26], sa décision de partir « seule »[27] pour l'Afrique afin de caresser le dos des éléphants, ne lui attire que les sarcasmes, la désapprobation et une fin de non-recevoir lorsqu'elle arrive à Nairobi. L'opposition à son projet est d'ailleurs aussi vive chez les femmes que chez les hommes: le secrétaire particulier du gouverneur lui affirme par exemple d'un ton sans équivoque qu'il fera personnellement tout son possible pour dissuader le Gouverneur de la laisser partir, même si, il est vrai, il finit par faire « amende honorable »[28]. Quant aux femmes de la colonie, elles ne se privent pas non plus d'exprimer leur désaccord à la narratrice, comme le montre le passage suivant extrait de Un thé chez les éléphants:
-
Deux femmes inconnues qui se rendaient en voiture au Tanganyika, dit-elle, me
surprirent au campement et me dirent ingénument qu'elles avaient entendu
parler de moi par quelques indigènes près du gué, et
qu'elles voulaient voir à quoi je ressemblais.
Je ne sais pourquoi il me sembla de mon devoir de les inviter à prendre le thé. Je ne tardais pas à le regretter, car leur devoir leur sembla plus urgent encore; et elles se mirent à me chapitrer sur les dangers auxquels je m'exposais, et sur le choix déplorable de mes occupations.
Cela m'eût laissée indifférente, mais quand elles manifestèrent leur antipathie à l'égard de mon rhinocéros apprivoisé, je commençais à m'irriter[29].
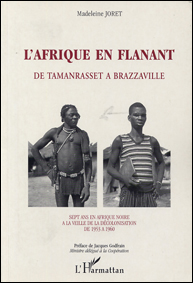 A noter que si une femme seule voyageant pour son bon plaisir était mal
vue des milieux coloniaux, elle représentait aussi un « affront
aux traditions » dans les milieux africains. Au-delà des
différences multiples qui séparaient les Africains en termes de
coutumes et de langues, personne ne semblait envisager qu'une femme puisse
vivre seule et libre de toute tutelle masculine. Dès lors les propos du
préfacier d'un des ouvrages de Madeleine Joret, une jeune
Française qui traversa le Sahara, puis toute l'Afrique, au cours des
années 1950, pourraient assez facilement être adaptés pour
convenir au reste de l'Afrique:
A noter que si une femme seule voyageant pour son bon plaisir était mal
vue des milieux coloniaux, elle représentait aussi un « affront
aux traditions » dans les milieux africains. Au-delà des
différences multiples qui séparaient les Africains en termes de
coutumes et de langues, personne ne semblait envisager qu'une femme puisse
vivre seule et libre de toute tutelle masculine. Dès lors les propos du
préfacier d'un des ouvrages de Madeleine Joret, une jeune
Française qui traversa le Sahara, puis toute l'Afrique, au cours des
années 1950, pourraient assez facilement être adaptés pour
convenir au reste de l'Afrique:
Assez vite elle comprend que le fait même d'être femme, de voyager seule, de ne dépendre d'aucun homme est, pour les Musulmans des montagnes algériennes, un scandale permanent, une bravade même, en ce sens que son attitude condamne leur propre système social, familial et religieux. L'incompréhension de ces hommes est totale [...][30].
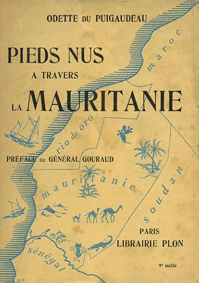 Un passage de Pieds nus à travers la Mauritanie[31] d'Odette du Puigaudeau – une autre
Française relatant sa traversée de l'Ouest du Sahara avec son
amie Marion Sénones, une génération avant Madeleine Joret
– évoquait déjà l'étonnement des chefs locaux face
à deux femmes voyageant seules:
Un passage de Pieds nus à travers la Mauritanie[31] d'Odette du Puigaudeau – une autre
Française relatant sa traversée de l'Ouest du Sahara avec son
amie Marion Sénones, une génération avant Madeleine Joret
– évoquait déjà l'étonnement des chefs locaux face
à deux femmes voyageant seules:
-
Fort peu de temps après notre arrivée, dit-elle, [le chef
religieux] Abdallahi-ould-Cheikh-Sida nous invita sous sa tente que l'on
apercevait, de la terrasse du poste, au sommet de la dune voisine. [...]
Assis à droite, selon le protocole, Abdallahi nous attendait au milieu
d'une cour respectueuse.
[...]
Abdallahi, pendant ce discours, nous regardait d'un air amusé. [...] La
France est bien forte puisqu'elle peut laisser, à présent,
voyager ses femmes à travers cette brousse qui a connu, jadis, des temps
si troublés... Et voilà que ces femmes françaises
écrivent comme des marabouts et voyagent comme des guerriers ! La
illah ill Allah !...[32]
La détermination des voyageuses solitaires ne devait bien sûr rien à une quelconque bienveillance de la France et de ses fonctionnaires coloniaux qui faisaient, au contraire, tout ce qui était en leur pouvoir pour décourager de tels projets. Leur succès relevait donc de leur seul courage, de leur ténacité et de leur certitude qu'il était possible d'établir des relations avec l'Afrique qui n'étaient pas basées sur la force, l'intimidation et la violence. Pionnières incomprises de tout le monde, elles étaient plus intéressées par l'établissement de relations basées sur le respect d'autrui que par la géographie, l'économie, le salut des âmes ou encore les conquêtes territoriales. Leur présence sur le terrain, plus encore que leur discours, remettait en question non seulement les certitudes des responsables politiques et religieux convaincus de la pérennité des conventions, mais elle ouvrait aussi la voie au changement de mentalité qui allait suivre. Leur présence signalait un mouvement irréversible vers l'égalité des sexes.
Leurs récits de voyage sont attrayants, aussi, dans la mesure où ils se démarquent des comptes rendus officiels. A priori, ces voyageuses sans patronage n'avaient jamais pour but de dénoncer ou de convaincre le lecteur pour des raisons idéologiques, financières ou politiques. Leurs témoignages entendaient simplement permettre aux lectrices et aux lecteurs de partager des expériences et des impressions personnelles. On le constate chez Odette du Puigaudeau et de Marion Sénones qui parcoururent près de 5500 km – dont 2900 km à dos de chameau – dans le désert mauritanien et notèrent l'exploitation impitoyable des populations locales. La manière dont la Métropole avait mis ses colonies en coupe réglée et les promesses brisées ne pouvaient pas leur échapper, d'autant que les propos de leurs hôtes ne faisaient que confirmer ce qui se déroulait sous leur regard. Elles découvraient que les paroles du Sage Abdallahi-ould-Cheikh-Sida n'avaient rien d'exagéré lorsqu'il affirmait avec amertume:
-
La Mauritanie est à la fois la colonie la plus pauvre et la plus
imposée [...] le commerce de la gomme et des dattes est
écrasé par l'impôt et pourtant, les Français avaient
promis, jadis, de respecter les coutumes coraniques d'après lesquelles
cet impôt ne doit pas dépasser le quarantième du capital.
[...]
Je respecte trop la France, ajoutait-il, pour penser qu'une si grande nation doive se contenter de conquérir un pays et d'y percevoir l'impôt, sans faire bénéficier de sa civilisation ceux qui ont mis tout leur espoir en elle »[33].
Odette du Puigaudeau est indéniablement marquée par ses rencontres et elle découvre l'envers du décor, mais elle n'est pas là pour prendre parti. Guidée par une curiosité de bon aloi, elle témoigne et laisse aux lecteurs le soin de juger par eux-mêmes, ce qui ne lui fait pas que des amis, comme elle le relève dans son introduction:
-
On peut éviter les pillards, dit-elle. On peut s'arranger avec les
Maures, les fauves, le soleil et le vent de sable, mais on ne peut
échapper aux civils qui reprochent à l'indiscret d'être
militariste, ni aux militaires qui lui reprochent de s'allier aux civils[34].
Souligner l'importance des voyageuses parties à l'aventure en Afrique, seules, sans idées préconçues et sans projet autre que de « découvrir » le continent de manière indépendante, ne signifie bien sûr pas qu'il faille dénigrer le témoignage des femmes ayant rejoint le continent avec un objectif précis. Pas plus les premières que les secondes ne doivent être ignorées mais toutes doivent être comprises – et leurs écrits interprétés – dans le contexte de la société qui les a incitées à agir.
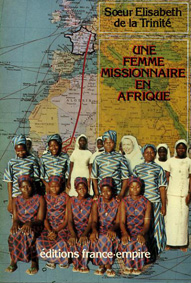 Prenons par exemple le témoignage des nombreuses sœurs
missionnaires envoyées en Afrique par leur Ordre. Dans son ensemble, ces
écrits montrent une soumission absolue aux Pères de l'Eglise, peu
de sympathie pour les croyances locales et un espoir sans cesse
renouvelé de convertir l'Afrique au christianisme. D'où la
tentation d'ignorer le zèle déployé par des milliers de
Bonnes Sœurs pour répandre la foi chrétienne en Afrique
pendant la colonisation, et de penser qu'il s'agit là d'un chapitre de
notre histoire qu'on ne perdrait pas grand chose à oublier. Ce serait
une erreur, ne serait-ce que parce que leurs témoignages nous permettent
d'accéder à une vision des « devoirs » de l'Europe
vis-à-vis de l'Afrique différente de celle qui proclamait les
vertus de la laïcité. L'intérêt de l'autobiographie de
Sœur Elisabeth de la Trinité intitulée Une femme
missionnaire en Afrique[35] n'est qu'un
exemple. Non seulement, cet ouvrage évoque une activité
missionnaire qui s'étend sur plus de 50 ans en Algérie, au Mali,
au Burkina Faso, au Rwanda, en Guinée et enfin au Congo, mais surtout,
il propose une facette de l'histoire coloniale différente de celle
émanant de l'administration coloniale et des communautés
laïques. Il ne s'agit pas bien sûr de faire l'apologie de l'action
missionnaire en Afrique mais de souligner qu'une histoire coloniale qui ignore
l'effort considérable fourni par les Sœurs pour ne retenir que les
initiatives de quelques figures emblématiques du clergé, ne
permet pas une vue nuancée du passé et nous livre pieds et poings
liés aux stéréotypes. Prenons par exemple un passage du
Guide de Marie-Louise Comeliau soulignant que « ... les pères sont
l'élément fort sur lequel pourra s'appuyer la faiblesse ou
l'incapacité des sœurs »[36].
Prenons par exemple le témoignage des nombreuses sœurs
missionnaires envoyées en Afrique par leur Ordre. Dans son ensemble, ces
écrits montrent une soumission absolue aux Pères de l'Eglise, peu
de sympathie pour les croyances locales et un espoir sans cesse
renouvelé de convertir l'Afrique au christianisme. D'où la
tentation d'ignorer le zèle déployé par des milliers de
Bonnes Sœurs pour répandre la foi chrétienne en Afrique
pendant la colonisation, et de penser qu'il s'agit là d'un chapitre de
notre histoire qu'on ne perdrait pas grand chose à oublier. Ce serait
une erreur, ne serait-ce que parce que leurs témoignages nous permettent
d'accéder à une vision des « devoirs » de l'Europe
vis-à-vis de l'Afrique différente de celle qui proclamait les
vertus de la laïcité. L'intérêt de l'autobiographie de
Sœur Elisabeth de la Trinité intitulée Une femme
missionnaire en Afrique[35] n'est qu'un
exemple. Non seulement, cet ouvrage évoque une activité
missionnaire qui s'étend sur plus de 50 ans en Algérie, au Mali,
au Burkina Faso, au Rwanda, en Guinée et enfin au Congo, mais surtout,
il propose une facette de l'histoire coloniale différente de celle
émanant de l'administration coloniale et des communautés
laïques. Il ne s'agit pas bien sûr de faire l'apologie de l'action
missionnaire en Afrique mais de souligner qu'une histoire coloniale qui ignore
l'effort considérable fourni par les Sœurs pour ne retenir que les
initiatives de quelques figures emblématiques du clergé, ne
permet pas une vue nuancée du passé et nous livre pieds et poings
liés aux stéréotypes. Prenons par exemple un passage du
Guide de Marie-Louise Comeliau soulignant que « ... les pères sont
l'élément fort sur lequel pourra s'appuyer la faiblesse ou
l'incapacité des sœurs »[36].
Quel meilleur démenti peut-on apporter à cette analyse fallacieuse de la dépendance des sœurs que l'expérience de Mère Marie-Michelle Dédié (qui fut missionnaire au Sénégal et au Congo de 1882 à 1931):
-
A la Mission, on s'en tenait strictement aux rôles attribués
à chaque sexe par l'Eglise européenne et ce répartement
était mis en pratique de manière autoritaire par Monseigneur
Augouard qui menait sa mission comme un royaume politique. Dans leur couvent
qui faisait partie de la Mission, la communauté des Sœurs
organisait ses activités avec les femmes et les filles, mais dans
certains domaines, elles devaient en référer à
l'autorité masculine. N'ayant les mains libres que dans la sphère
domestique, la nécessité de franchir les frontières
fixées par l'évêque était source de problèmes
pour Mère Marie. Ses lettres en offrent un aperçu lorsqu'elle
partage ses dilemmes avec la Mère Supérieure. Par exemple,
l'administration coloniale était un domaine purement masculin et
l'approcher directement pour demander une aide – souvent accordée –
risquait toujours d'attirer les foudres de l'évêque: en 1898,
alors qu'elle avait eu besoin d'argent pour évacuer une Sœur malade
vers la côte et avait fait appel à l'administration – après
que l'évêque lui eût refusé la somme et dit le la
trouver elle-même – elle mentionne le mécontentement d'Augouard et
la manière dont elle avait dû se traîner à genoux
devant lui, comme une petite fille, en lui demandant pardon. Deux ans plus
tard, alors qu'Augouard remontait le fleuve en croisière, elle accepta
un terrain offert par l'administration pour agrandir le Couvent. Mais à
son retour, dit-elle, l'évêque fut furieux qu'une telle
transaction ait eu lieu sans son approbation, que la parcelle ait
été enregistrée au nom des Sœurs de Cluny et que
l'administration approuvât les demandes des Sœurs alors qu'elle
refusait celles qu'il lui soumettait[37].
« La faiblesse ou l'incapacité des sœurs » évoquée par Marie-Louise Comeliau à l'appui de sa défense du statu quo, on s'en rend bien compte, n'est qu'un mythe qui permet d'absoudre l'autoritarisme de certains Pères de l'Eglise qui étaient plus prompts à tirer profit de la présence des sœurs[38] qu'à leur fournir de l'aide. Les témoignages de Mère Marie et de Sœur Elisabeth sont importants car en nous donnant accès à l'histoire anecdotique des sans-grade, ils permettent de remettre en question les récits héroïques des Pères fondateurs. Ces témoignages sont aussi essentiels en tant que révélateurs de la complexité de la société coloniale qui ne peut être comprise et jugée qu'à travers la diversité des forces contradictoires et des jeux de pouvoir qui en ont déterminé la nature.
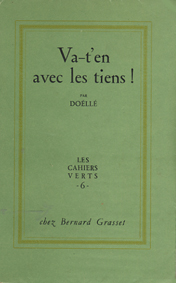 L'apport de plusieurs journalistes indépendantes est aussi
intéressant mais les aspects de la société africaine
qu'elles évoquent dans leurs livres doivent, comme pour les
thèmes évoqués par les missionnaires, être
replacés dans le contexte de projets d'écriture aux origines
souvent assez floues. Le cas de Va-t'en avec les tiens ![39] (publié sous le pseudonyme de Doellé en
1951) n'est qu'un exemple. D'un point de vue purement littéraire, ce
roman de Christine Garnier est excellent. Il aborde la question de la rencontre
des cultures et du métissage dans un système colonial
prônant une ségrégation raciale stricte tout en favorisant
le mélange des races. Toutefois, l'origine du livre, l'histoire de sa
publication et les raisons pour lesquelles Christine Garnier s'intéresse
aux questions de métissage et d'identité – qui seront au centre
des études africaines par la suite – sont moins claires. Au dire de
l'auteur [40] sa décision de partir
pour l'Afrique fut liée à l'invitation d'une amie habitant au
Togo, en 1947. Pour couvrir une partie de ses frais de voyage, Christine
Garnier convainquit « le vieux M. Payot » de signer un contrat pour
un livre sur la sorcellerie et le fétichisme. Une fois sur place,
cependant, c'est l'histoire d'une jeune infirmière métisse qui
retint son attention et elle rentra en France avec un manuscrit racontant
l'histoire de Doellé qu'elle proposa à Bernard Grasset. Ce
dernier, flairant la bonne affaire, modifia le manuscrit avec Christine Garnier
afin de le mettre au goût d'un public métropolitain et il le
publia sous le nom de Doellé, l'héroïne africaine du roman.
Doellé a-t-elle existé ? Christine Garnier prétend que
oui[41], mais cette histoire qui a
été écrite par une journaliste et revue par
l'éditeur sans consulter l'auteur en fait une fausse autobiographie qui
tient davantage de l'usurpation d'identité que du témoignage.
Intéressant d'un point de vue littéraire, ce roman ne l'est pas
moins en tant qu'illustration des magouilles éditoriales qui
déterminaient ce qui était proposé au public et
infléchissait, du même coup, la perception du monde colonial des
lecteurs.
L'apport de plusieurs journalistes indépendantes est aussi
intéressant mais les aspects de la société africaine
qu'elles évoquent dans leurs livres doivent, comme pour les
thèmes évoqués par les missionnaires, être
replacés dans le contexte de projets d'écriture aux origines
souvent assez floues. Le cas de Va-t'en avec les tiens ![39] (publié sous le pseudonyme de Doellé en
1951) n'est qu'un exemple. D'un point de vue purement littéraire, ce
roman de Christine Garnier est excellent. Il aborde la question de la rencontre
des cultures et du métissage dans un système colonial
prônant une ségrégation raciale stricte tout en favorisant
le mélange des races. Toutefois, l'origine du livre, l'histoire de sa
publication et les raisons pour lesquelles Christine Garnier s'intéresse
aux questions de métissage et d'identité – qui seront au centre
des études africaines par la suite – sont moins claires. Au dire de
l'auteur [40] sa décision de partir
pour l'Afrique fut liée à l'invitation d'une amie habitant au
Togo, en 1947. Pour couvrir une partie de ses frais de voyage, Christine
Garnier convainquit « le vieux M. Payot » de signer un contrat pour
un livre sur la sorcellerie et le fétichisme. Une fois sur place,
cependant, c'est l'histoire d'une jeune infirmière métisse qui
retint son attention et elle rentra en France avec un manuscrit racontant
l'histoire de Doellé qu'elle proposa à Bernard Grasset. Ce
dernier, flairant la bonne affaire, modifia le manuscrit avec Christine Garnier
afin de le mettre au goût d'un public métropolitain et il le
publia sous le nom de Doellé, l'héroïne africaine du roman.
Doellé a-t-elle existé ? Christine Garnier prétend que
oui[41], mais cette histoire qui a
été écrite par une journaliste et revue par
l'éditeur sans consulter l'auteur en fait une fausse autobiographie qui
tient davantage de l'usurpation d'identité que du témoignage.
Intéressant d'un point de vue littéraire, ce roman ne l'est pas
moins en tant qu'illustration des magouilles éditoriales qui
déterminaient ce qui était proposé au public et
infléchissait, du même coup, la perception du monde colonial des
lecteurs.
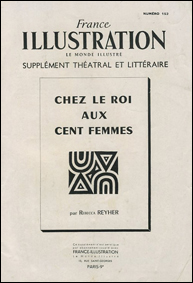 La « croisade » contre la polygamie de la journaliste
américaine Rebecca Reyher qui donna lieu à la publication de
Chez le roi aux cent femmes[42],
à la fin des années 1940, est plus transparente. Suite
à la publication d'un premier ouvrage sur ce thème (sorti en
1948)[43] Rebecca Reyher décida de lui
consacrer un second volume afin, affirmait-elle, de montrer « qu'il ne
s'agissait pas là d'une coutume propre à l'Afrique du Sud
». Comme elle l'expliqua au cours d'une interview beaucoup plus tard:
La « croisade » contre la polygamie de la journaliste
américaine Rebecca Reyher qui donna lieu à la publication de
Chez le roi aux cent femmes[42],
à la fin des années 1940, est plus transparente. Suite
à la publication d'un premier ouvrage sur ce thème (sorti en
1948)[43] Rebecca Reyher décida de lui
consacrer un second volume afin, affirmait-elle, de montrer « qu'il ne
s'agissait pas là d'une coutume propre à l'Afrique du Sud
». Comme elle l'expliqua au cours d'une interview beaucoup plus tard:
L'Alliance féministe St Joan d'Angleterre fit parvenir une requête à l'Organisation des Nations Unies, relevant que les deux Cameroun et quelques autres pays africains avaient été placés sous la juridiction des Nations Unies et que, en tant que colonies sous tutelle, ils étaient, en vertu de la convention des droits de l'homme, obligés d'y vivre dans le respect de ces droits; polygamie et mariages forcés étaient contraire aux droits de l'homme et l'Alliance demandait une enquête immédiate. Les organisations féministes contraignirent les Nations Unies à mettre la question à l'ordre du jour. Lorsque cette question de la polygamie fut discutée en assemblée, j'écoutais une partie du débat. Les hommes appelés à considérer la question la considérèrent comme une grosse plaisanterie. Tout le monde s'esclaffa.
Ces femmes camerounaises me trottaient dans la tête et je n'arrivais pas à les oublier. Je sentais qu'il fallait que j'y aille, que je fasse une nouvelle étude sur la polygamie qui prouverait aux Nations Unies que ces jeunes femmes n'étaient pas consentantes, que des jeunes filles et des femmes s'enfuyaient. Comme l'ONU avait accepté de se rendre au Cameroun afin d'y faire une enquête, je voulais en faire aussi une[44].
Plusieurs années avant son départ pour le Cameroun, Rebecca Reyher avait déjà interviewé un grand nombre d'Africaines – Sita Gandhi, Mrs Paton et d'innombrables Sud-Africaines de toutes les races et couleurs, dit-elle –. Sa solidarité avec les femmes camerounaises ne faisait que prolonger son action antérieure en Afrique du Sud. Elle pensait de son devoir de défendre les victimes d'un sexisme qui limitait non seulement leur liberté au Cameroun mais aussi leur droit d'être entendues sur la scène internationale. Un demi siècle plus tard, les mécanismes ayant permis aux colonisateurs de réduire au silence les colonisés en s'appropriant leur voix ont été dévoilés et les excès d'un discours euro-américain s'exprimant au nom des communautés africaines largement dénoncés. Il est important, toutefois, de ne pas rejeter en bloc tous les ouvrages d'une production qui n'a rien d'homogène; de distinguer les manœuvres visant expressément à réduire la population africaine au silence afin de museler toute opposition, des efforts fournis par un certain nombre d'individus cherchant à restituer aux opprimés leur droit à être entendus. Certes, en dénonçant la polygamie, Rebecca Reyher s'exprime sur un sujet qui ne la touche qu'au second degré mais d'autre part, sa mise en cause d'un système hostile à la libre expression des femmes touchait aussi bien les sociétés traditionnelles que les sociétés européennes. Elle soulignait la coalition tacite des hommes au pouvoir, tant en Afrique qu'en Amérique et partout dans le monde et condamnait la légèreté avec laquelle les revendications des femmes étaient prises en considération, tant au niveau individuel qu'institutionnel. En 1928, la journaliste française Louise Faure-Favier condamnait le sexisme et le racisme de ses contemporains en relevant que le décret des Pères de la critique littéraire qui déclaraient que les Noirs ne pouvaient avoir de génie, était aussi sot que celui des Pères de l'Eglise qui avaient décrété que les femmes n'avaient pas d'âme[45]. Une génération plus tard, Rebecca Reyher montrait que les pères de l'O.N.U. qui considéraient la remise en question de la polygamie comme une grosse plaisanterie n'avaient rien à envier à leurs prédécesseurs et que leur décret ne valait pas plus cher que les leurs. Cela dit, force est aussi de constater que Rebecca Reyher échappa au courroux des autorités en dépit de son ingérence dans l'univers colonial, « à titre privé » pourrait-on dire. Ce n'était pas un effet du hasard, mais bien parce qu'elle maintenait les abus de la société coloniale, sur le terrain, en marge de son champ visuel et que son regard portait avant tout sur certains aspects de la société traditionnelle que les autorités jugeaient anachroniques.
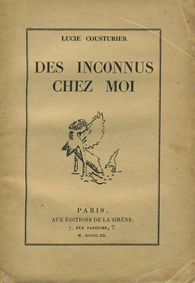 Les autorités coloniales furent beaucoup moins conciliantes avec les
femmes qui se mirent en tête de critiquer ouvertement les méfaits
de la présence de l'Europe en Afrique. Comme au siècle
précédent, les écrivaines qui s'y hasardèrent
furent impitoyablement rejetées vers un oubli d'où, à
très peu d'exceptions près, elles ne sont pas encore sorties. Le
cas de Lucie Cousturier est intéressant à cet égard. Cette
artiste peintre française découvrit la société
coloniale en plusieurs étapes: d'abord au tournant du siècle par
l'intermédiaire de son beau-frère qui était Gouverneur aux
colonies; puis lors de ses rencontres avec plusieurs Tirailleurs
sénégalais pendant la guerre de 14[46], et enfin en Afrique où elle fut envoyée en
mission par le gouvernement français en 1921 et 1922. Curieuse,
intègre et partageant les vues de sa contemporaine Louise Faure-Favier,
Lucie Cousturier raconte sa rencontre avec les Tirailleurs
sénégalais qui sont stationnés à côté
de chez elle de 1916 à 1918 dans un ouvrage intitulé Des
Inconnus chez moi[47] Elle se lie
d'amitié avec des hommes qui, dit-elle, ne correspondent en rien aux
images négatives et stéréotypées qui ont cours en
France et, lorsqu'elle part en mission en Afrique quelques années plus
tard, elle ne peut que constater que l'action française en A.O.F. ne
cadre pas avec « la haute moralité »[48] dont se prévalent les « Pères »
du colonialisme. De plus, elle se rend compte que le dénigrement des
Africains, appuyé par un discours scientifique essentialiste en vogue[49], appartient de fait à une «
logique de l'intérêt »[50]
commune à toutes les sociétés inégalitaires et sans
relation avec la race des individus:
Les autorités coloniales furent beaucoup moins conciliantes avec les
femmes qui se mirent en tête de critiquer ouvertement les méfaits
de la présence de l'Europe en Afrique. Comme au siècle
précédent, les écrivaines qui s'y hasardèrent
furent impitoyablement rejetées vers un oubli d'où, à
très peu d'exceptions près, elles ne sont pas encore sorties. Le
cas de Lucie Cousturier est intéressant à cet égard. Cette
artiste peintre française découvrit la société
coloniale en plusieurs étapes: d'abord au tournant du siècle par
l'intermédiaire de son beau-frère qui était Gouverneur aux
colonies; puis lors de ses rencontres avec plusieurs Tirailleurs
sénégalais pendant la guerre de 14[46], et enfin en Afrique où elle fut envoyée en
mission par le gouvernement français en 1921 et 1922. Curieuse,
intègre et partageant les vues de sa contemporaine Louise Faure-Favier,
Lucie Cousturier raconte sa rencontre avec les Tirailleurs
sénégalais qui sont stationnés à côté
de chez elle de 1916 à 1918 dans un ouvrage intitulé Des
Inconnus chez moi[47] Elle se lie
d'amitié avec des hommes qui, dit-elle, ne correspondent en rien aux
images négatives et stéréotypées qui ont cours en
France et, lorsqu'elle part en mission en Afrique quelques années plus
tard, elle ne peut que constater que l'action française en A.O.F. ne
cadre pas avec « la haute moralité »[48] dont se prévalent les « Pères »
du colonialisme. De plus, elle se rend compte que le dénigrement des
Africains, appuyé par un discours scientifique essentialiste en vogue[49], appartient de fait à une «
logique de l'intérêt »[50]
commune à toutes les sociétés inégalitaires et sans
relation avec la race des individus:
-
Dans les chefs-lieux de cercles, quand on me répétait que les
Noirs sont menteurs, voleurs, paresseux, ingrats, ces mots à mes
oreilles perdaient de leur vertu, parce que je me rappelais trop bien les avoir
entendu prononcer, – les mêmes exactement, – dans ma petite enfance, par
ma vieille tante à propos de ses bonnes, par mon oncle à propos
de ses ouvriers. [...]
Et mon oncle disait de ses ouvriers blancs qu'ils étaient « une sale race » ingrate et arriérée, une race pourrie. Et personne ne s'en étonnait[51].
Son rapport de mission – qui souligne les faiblesses du système, ses abus et les changements de directions nécessaires pour qu'un véritable esprit de collaboration s'installe entre la France et les colonies – n'est pas du goût des commanditaires de l'étude, on s'en doute, et l'on ne s'étonne qu'à moitié d'apprendre que le rapport final semble avoir disparu des archives coloniales d'Aix[52]. Seule « la réaction officielle de la Direction des Affaires Politiques et Administratives du Gouvernement Général de l'A.O.F. » semble avoir été conservée et l'on peut lire dans ce document:
-
Madame Lucie COUSTURIER n'hésite pas à déclarer dans son
rapport que « les Blancs enrichis aux colonies n'y déversent rien,
qu'ils y vivent dans une avarice sordide et emportent les capitaux
amassés pour les dépenser dans leurs métropoles
respectives, que les coloniaux blancs, malgré la meilleure
volonté, malgré eux-mêmes, ne sauraient mettre en pratique
que cette politique d'épuisement.[...]
Le noir accablé sous cette coalition de profiteurs mal intentionnés renonce à tout effort en présence de l'avidité de l'homme blanc dont la rapacité lui ravit tous ses bénéfices » [...][53].
La destination finale du rapport de Lucie Cousturier reste incertaine mais la conclusion du fonctionnaire chargé de son évaluation laisse peu de doutes sur l'usage qui en a probablement été fait:
-
je ne vois dans [l]es conclusions d'ordre politique et économique [de
Mme Lucie Cousturier] que l'expression d'une théorie personnelle qu'il
serait déplorable de répandre dans la métropole et
très dangereux de laisser s'accréditer parmi les indigènes
de nos colonies[54].
Bien que salués par certains critiques influents – René Maran par exemple – les deux ouvrages publiés par Lucie Cousturier quelques années plus tard suivirent le même chemin que son rapport. Comme au siècle précédent, la survie littéraire d'ouvrages dérangeants était moins liée à l'importance de l'œuvre qu'aux manœuvres politico-économiques et administratives qui permettaient à une petite élite de faire perdurer en toute impunité un système d'exploitation intolérable. Que Lucie Cousturier ait été censurée dans les années 1920, on le comprend, mais qu'un auteur de son importance soit aujourd'hui encore relégué au rang de petit auteur n'intéressant que quelques spécialistes est plus difficile à comprendre. On ne peut donc que partager la perplexité du critique Roger Little qui écrivait récemment: « Comment les écrits de Lucie Cousturier, comment la femme elle-même, a-t-elle pu tomber dans un oubli aussi total ? »[55]
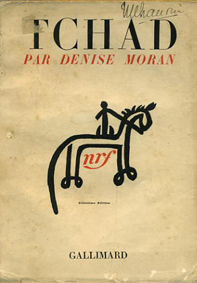 La destinée du rapport de Denise Moran Savineau – qui rappelle celui de
Lucie Cousturier, une génération plus tard – tout comme la mise
en hibernation de son livre Tchad[56]
(1934) s'expliquent elles aussi, à mon avis, par la censure implacable
qui étouffait systématiquement les voix dénonçant
l'omniprésente « logique de l'intérêt » qui
pervertissait les relations interraciales et bafouait les notions de
liberté, d'égalité et de fraternité si
chères à la France. Le réquisitoire impitoyable de Denise
Moran était d'autant plus dévastateur qu'il s'appuyait sur une
connaissance approfondie du terrain. « En trois années, dit-elle,
j'ai habité trois postes de brousse, séjourné deux fois au
chef-lieu, sous deux gouverneurs, dirigé – par intérim – le
bureau des Affaires politiques et économiques, exploré les
archives »[57]. On ne s'attendait sans
doute pas en haut lieu qu'une femme occupant un poste à
responsabilité – par intérim – essayât d'en faire plus que
ce qui était strictement nécessaire pour expédier les
affaires courantes en attendant que le titulaire reprenne les choses en
main; on imaginait encore moins qu'elle allait analyser les rouages de
l'administration qui l'employait et s'en désolidariser. Aussi, comme le
suggère son introduction, tout le monde, y compris ses amis,
s'employèrent à essayer de la dissuader de scier la branche sur
laquelle elle était assise en bonne compagnie:
La destinée du rapport de Denise Moran Savineau – qui rappelle celui de
Lucie Cousturier, une génération plus tard – tout comme la mise
en hibernation de son livre Tchad[56]
(1934) s'expliquent elles aussi, à mon avis, par la censure implacable
qui étouffait systématiquement les voix dénonçant
l'omniprésente « logique de l'intérêt » qui
pervertissait les relations interraciales et bafouait les notions de
liberté, d'égalité et de fraternité si
chères à la France. Le réquisitoire impitoyable de Denise
Moran était d'autant plus dévastateur qu'il s'appuyait sur une
connaissance approfondie du terrain. « En trois années, dit-elle,
j'ai habité trois postes de brousse, séjourné deux fois au
chef-lieu, sous deux gouverneurs, dirigé – par intérim – le
bureau des Affaires politiques et économiques, exploré les
archives »[57]. On ne s'attendait sans
doute pas en haut lieu qu'une femme occupant un poste à
responsabilité – par intérim – essayât d'en faire plus que
ce qui était strictement nécessaire pour expédier les
affaires courantes en attendant que le titulaire reprenne les choses en
main; on imaginait encore moins qu'elle allait analyser les rouages de
l'administration qui l'employait et s'en désolidariser. Aussi, comme le
suggère son introduction, tout le monde, y compris ses amis,
s'employèrent à essayer de la dissuader de scier la branche sur
laquelle elle était assise en bonne compagnie:
– Quoi ! m'a dit un fonctionnaire sérieux, un des rares qui ne nie pas le drame, vous allez tout dire ! Comme ça va « faire du tort » !
– A qui ?
– A l'Administration, à la colonisation, à la France... Voyons, vous êtes Française, solidaire des Français... Enfin, vous êtes Blanche, solidaire des Blancs...
– Contre les Noirs ?
– Mais dans l'intérêt même des Noirs... Songez que, cette colonie, quand vous aurez prouvé que nous la ... négligeons, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, féroces exploitatrices, l'Amérique peut-être, qui lynche les nègres, vont la revendiquer ! [...]
... ne sentez-vous pas ce qu'il y a de délicat... Voyons: des chefs vous ont fait confiance, vous ont appointée...[58].
Alors que la publication de Tchad semblait devoir éloigner Denise Moran de l'univers colonial pour toujours, l'arrivée au pouvoir du Front Populaire en France en 1936 permit à l'auteur de poursuivre son analyse à la demande de Marcel de Coppet, le nouveau Gouverneur Général de l'A.O.F qui, comme le suggère la critique littéraire Claire Griffiths, « était ouvert à une philosophie qui penchait à gauche et épousait l'idée d'un empire colonial florissant construit sur la coopération et la compréhension entre colonisateur et colonisé plutôt que sur la coercition et la répression des populations locales qui avaient été caractéristiques des méthodes utilisées dans beaucoup de projets en Afrique équatoriale pendant les années 1920 et 30 »[59]. Il s'ensuivit plus de 800 pages d'un rapport sur la famille et la condition de la femme en A.O.F. qui fut présenté au Gouverneur de Coppet au terme de sept mois de consultations intensives dans toute l'A.O.F.; mais pas plus que les propositions de Lucie Cousturier, celles de Denise Sauvineau n'influencèrent les attitudes coloniales. Pour cela, il aurait fallu à un bon nombre de coloniaux, pour paraphraser Lucie Cousturier « quelques mois de forte éducation avant qu'ils sachent [...] saluer un Noir les premiers, lui abandonner leur siège, effacer devant lui leurs personnes, leurs appétits, leurs hâtes, par de gracieux « après vous ». »[60]. Ces mois, le Gouvernement du Front Populaire ne les avait plus car un nouveau gouvernement venait d'être élu et il « classa » le rapport de Denise Sauvineau si méticuleusement que ce n'est que très récemment qu'il fut « redécouvert » à Dakar dans les Archives Nationales du Sénégal[61].
Comme toutes les écrivaines mentionnées ci-dessus, Denise Savineau ne mettait pas en doute le bien-fondé de la mission civilisatrice de l'Europe en Afrique mais, comme le suggère justement Claire Griffiths, elle était « férocement opposée à l'exploitation coloniale »[62]. On connaît de nos jours l'inextricable complémentarité de ces deux aspects d'une même oppression, mais dans l'esprit de Lucie Cousturier, de Denise Savineau et de bien d'autres écrivaines de l'époque, ces deux facettes de l'action coloniale semblaient au contraire mutuellement exclusives. L'engagement des femmes d'origine européenne dans l'univers colonial du 20e siècle ne peut être compris qu'en fonction de son contexte et il serait faux, à mon avis, de les juger à l'aune de préoccupations qui n'étaient pas les leurs. Pour la grande majorité d'entre elles, tout engagement se devait d'être conforme aux normes sociales de l'époque. Mais pour d'autres, au contraire, ce fut l'occasion d'ouvrir la voie à de nouvelles manières de se situer par rapport aux autres et à soi-même. C'est dans ce mélange de forces réactionnaires et « d'idées folles » que plongent nos racines et il est important de convoquer tous les témoins de cette époque pas si lointaine, sans égard à leur sexe, si l'on veut comprendre le monde tel que nous l'avons hérité et tel qu'il se présente à nous au moment de le léguer aux Niry et aux Nary du 21e siècle.
Jean-Marie Volet
2007
| L'Afrique écrite au féminin. Que sont les écrivaines de jadis devenues ? |
Notes
[1] Catherine Jacques et Valérie Piette. « L'union des femmes coloniales (1923-1940) » in Anne Hugon, Histoire des femmes en situation coloniale: Afrique et Asie, XXe siècle. Paris, Karthala, 2004, p.101.
[2] Marie-Louise Comeliau. Demain coloniale ! Anvers: Editions Coloniales Zaïre, 1945.
-
« Si l'occasion lui est offerte, [l'Eve moderne] suivra ou rejoindra tout
naturellement en Afrique l'homme qu'elle aime.
Il y a plus.
Habituée maintenant à envahir plus ou moins silencieusement en Europe les carrières masculines, elle se révèle toute disposée à faire de même à la colonie: Eve, même solitaire, rêve de planter sa tente [...] sous les tropiques.
Est-ce possible pour une femme seule ? A cette question l'Etat répond avec toute la grâce administrative qui lui est propre: hors la carrière d'assistante sociale et peut-être celle d'infirmière [...] aucune autre n'est présentement ouverte aux femmes en Afrique où leur présence, en tant que célibataires, n'est pas jugée désirable. » (p.70).
[3] Rosamond Halsey Carr. Le pays aux mille collines. Ma vie au Ruanda. Paris: Editions Payot & Rivage, 2002. Traduit de l'anglais « Land of a thousand hills. My life in Rwanda », 1999, p.53.
[4] Faranirina V. Rajaonah. « Féminin, masculin ? Manuels de lecture d'enseignantes malgaches (1970-2000) » in Anne Hugon, Histoire des femmes en situation coloniale: Afrique et Asie, XXe siècle. Paris, Karthala, 2004, p.218.
[5] Lucie Cousturier. [1925] Mes inconnus chez eux, Vol. 2. Paris: L'Harmattan, Autrement Mêmes, 2003, Présentation de Roger Little, p.219.
[6] Rajaonah. « Féminin, masculin ? », p.229
[*]
En lisant le charmant petit ouvrage pour la jeunesse d'Anne Laflaquière intitulé Fatoumata, ma tante (Paris. L'Harmattan, 1990), on se rend compte du chemin parcouru au cours de ces dernières décennies. Ce livre raconte la rencontre de Shadé et de sa Tante Fatouma, en visite du Mali chez son frère qui habite en région parisienne. Deux extraits:
"- Te voici bonne à marier, ma nièce.
- Merci bien! Je veux d'abord mon diplôme d'aviateur!
- Aviateur! Quelle horreur!... Un bon mari, voilà ce qu'il te faut!
- Ma mère prit ma défense..." (pp.30-31)
et
"Viendras-tu me voir au Mali ?
- Dès que je serai pilote de ligne, Tantie.
Elle grogna:
- Ta, ta, ta !... Je te trouverai un bon mari, petite mule! un gars sérieux, vaillant et pieux, qui te fera oublier tes avions!". (p.54).
[Note ajoutée le 16 juillet 2009]
L'idée que des petites filles peuvent rêver de devenir pilotes continue à faire son chemin en 2010. J'ai sous les yeux le roman de Danèle Merveille Mvoto J'ai atterri chez les ch'tis (Paris: L'Harmattan, 2010) qui mentionne le rêve éphémère de la jeune Eloïse de devenir "pilote de ligne" (p.11). Le dernier roman d'Assamala Amoi Avion par terre (Paris: Editions Anibwé, 2010) lui, montre que le rêve peut devenir réalité lorsqu'il est encouragé: "Le commandant de bord, Ayiza Dos Anjos, une femme d'une trentaine d'années, vint leur souhaiter la bienvenue à bord ...
- Que veux-tu faire plus tard? demanda Ayiza à Alizéta Ba...
- Je veux être pilote comme vous.
Le commandant Dos Anjos posa cérémonieusement sa casquette sur la tête de la petite fille.
- Dans ce cas, bienvenue à bord commandant Ba..." (pp.23-25)
[Note ajoutée le 6 janvier 2011]
Les documents signalant la présence de femmes pilotes un peu partout en Afrique depuis les débuts de l'aviation sont de plus en plus nombreux et la contribution des femmes au développement d'une aviation africaine est de mieux en mieux perceptible. Par exemple un article proposé par L'Humanité, no 13472, 5 novembre 1935, p.1, inclut une photo de "la première aviatrice éthiopienne [qui] s'appête à partir en reconnaissance sur le front du Tigré" lors de l'invasion italienne de l'Ethiopie, montrant par là qu'il y eut des pilotes militaires en Afrique bien avant qu'il y en ait en France. [Note ajoutée le 15 décembre 2012]
[7] Beryl Markham. Vers l'Ouest avec la nuit. [1942]. Paris: Flammarion, 1995. Traduit de l'anglais West with the Night. La vie de Beryl Markham a été portée à l'écran en 1988 dans une mini-série télévisée américaine sous le titre "Shadow on the Sun".
[8] Markham. Vers l'Ouest avec la nuit, p.213.
[9] Markham. Vers l'Ouest avec la nuit, p.220.
[10] « Elizabeth 'Bessie' Coleman (1893-1926) » The Pioneers [consulté le 21 septembre 2007]
[11] Anne Spoerry. On m'appelle Mama Daktari. Paris: Jean-Claude Lattès, 1994.
[12] Spoerry. On m'appelle Mama Daktari, pp.85-86.
[13] Spoerry. On m'appelle Mama Daktari, p.86.
[14] « Je connaissais aussi June Sutherland, qui avait été décorée par la Reine pour son action pendant la guerre du Congo. Avec son avion, elle allait se poser sur des terrains de fortune, en pleine zone de combat, et elle évacuait les femmes et les enfants en détresse vers le Rwanda. Elle en a sauvé beaucoup. C'est elle qui m'a emmené pour la première fois à Loyangalani et au lac Turkana, en 1961. Le vol avait été magnifique, et je crois bien que c'est à ce moment là que j'ai pensé sérieusement à piloter moi-même. » Spoerry. On m'appelle Mama Daktari, p.135.
[15] Spoerry. On m'appelle Mama Daktari, p.127.
[16] Anita Conti. Géants des mers chaudes. [1957]. Paris: Payot, 2002.
[17] Comeliau. Demain coloniale !, p.70.
[18] Karen Blixen. La ferme africaine. [1937]. Paris: Gallimard, 1986. Traduit du danois. Cet ouvrage a été porté à l'écran en 1985 sous le titre « Out of Africa ».
[19] Karen Blixen. Letters from Africa 1914-1931. London: Picador, 1983, p.2. [Ma traduction de la traduction anglaise – original en danois].
[20] Halsey Carr. Le pays aux mille collines, pp.48-49.
[21] Halsey Carr. Le pays aux mille collines, p.52.
[22] Dans son ouvrage Chez les pygmées (Paris : Editions Berger-Levrault, 1933), O. de Labrouhe écrit par exemple dans son introduction : « Mais non, répondit mon guide, sûr de lui. Cette femme vient chez nous que pour regarder comment nous vivons, comment nous mangeons, comment nous dormons; elle n'est ni administrateur, ni médecin, ni « Mon Père », elle n'est rien, c'est une femme qui passe sans rien imposer », pp.5-6.
[23] Vivienne de Watteville. Un thé chez les éléphants. Retour au Kenya. [1935]. Paris: Payot, 1997, et Petite musique de chambre sur le mont Kenya. [1935]. Paris: Payot, 1998. Traduit de l'anglais Speak to the earth. Ces deux ouvrages n'en formaient qu'un dans l'édition anglaise originale.
[24] de Watteville. Un thé chez les éléphants, p.11.
[25] Dian Fossey, Jane Goodall et d'autres allaient poursuivre de manière plus radicale encore ce rapprochement entre les humains et les animaux. De plus, au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les massacres de lions, d'éléphants etc. furent graduellement remplacés par des safaris du genre de celui entrepris par Vivienne de Watteville, c'est-à-dire ayant pour but de tirer des photos et non plus des animaux.
[26] « Ah! Si seulement j'avais quarante ans de moins, j'irais avec toi ! » soupirait sa grand-mère. de Watteville. Un thé chez les éléphants, p.10.
[27] A noter que dans l'optique coloniale, qui est la sienne, « être seule » ne signifie pas n'avoir personne à ses côtés – elle part avec six « boys » – mais se couper de la compagnie des Blancs, de la civilisation.
[28] de Watteville. Un thé chez les éléphants, p.22.
[29] de Watteville. Un thé chez les éléphants, p.194.
[30] J.C. Frœlich. « Préface » in Madeleine Joret. L'Afrique en flânant. De Paris à Tamanrasset. Paris: Nouvelles éditions Debresse, 1966.
[31] Odette du Puigaudeau. Pieds nus à travers la Mauritanie. Paris: Plon, 1936.
[32] du Puigaudeau. Pieds nus à travers la Mauritanie, pp.92-93.
[33] du Puigaudeau. Pieds nus à travers la Mauritanie, pp.99 et 101.
[34] du Puigaudeau. Pieds nus à travers la Mauritanie, pp.vii-viii.
[35] Sœur Elisabeth de la Trinité.
Une femme missionnaire en Afrique. Paris: Editions France-Empire,
1983.
Cet ouvrage n'est qu'un des nombreux livres qui relatent l'effort missionnaire
des Sœurs en Afrique, au 20e siècle. Pour ne donner
qu'un ou deux exemples supplémentaires, les Sœurs missionnaires de
Notre-Dame des Apòtre de Lyon publient De la Côte des esclaves
aux Rives du Nil en 1921 ; les Missions des Sœurs de la Sainte-Famille
de Bordeaux, 11 mois en Afrique du Sud : Journal de voyage en 1939, etc.
[36] Comeliau. Demain coloniale !, p.71.
[37] Phyllis M. Martin. « Celebrating the Ordinary: Church, Empire and Gender in the Life of Mère Marie-Michelle Dédié (Senegal, Congo, 1882-1931) » Gender & History, Vol.16 No.2 August 2004, pp. 295-296.
[38] « S. Maxima is to repair the linen of the Community and the socks of the Fathers. Each week they bring us 7-8 pairs with holes that need repair. Monsignor sends his laundry on Monday and Wednesday afternoons ». Phyllis M. Martin, « Celebrating the Ordinary », p. 296.
[39] Doellé. Va-t'en avec les tiens ! Paris: Bernard Grasset, 1951.
[40] Christine Garnier. Jusqu'où voient mes yeux. Paris: Laffont, 1975, p.65.
[41] Garnier. Jusqu'où voient mes yeux, p.86.
[42] Rebecca Reyher. Chez le roi aux cent femmes. Paris: France Illustration – Le Monde Illustré, supplément théâtral et littéraire, 1954. [Extrait de The Fon and His Hundred Wives].
[43] Rebecca Hourwich Reyher. Zulu Woman: The Life Story of Christina Sibiya. [1948] New York, The Feminist Press, 1999. Written on the basis of interviews conducted in 1934.
[44] « The Fon and His Hundred Wives ». Online Archives of California. [Consulté le 28 septembre 2007].
[45] Lettre de Louise Faure-Favier adressée au rédacteur en chef de la Dépêche Africaine. Louise Faure-Favier. Blanche et Noir. [1928]. Paris: L'Harmattan. Coll. Autrement Mêmes, 2006. Présentation Roger Little et Laurent Freitas, p.xxviii.
[46] Il est intéressant de signaler qu'un ouvrage relatant une expérience similaire pendant la guerre 39-40 a été publié par Hélène de Gobineau sous le titre de Noblesse d'Afrique. Paris: Fasquelle Editeurs, 1946.
[47] Lucie Cousturier. Des Inconnus chez moi. Paris : Editions de la Sirène, 1920.
[48] « Lettre de la direction des affaires politiques et administratives du gouvernement général de l'O.A.F. » reproduite dans Lucie Cousturier. Mes inconnus chez eux Vol. 2. Paris: L'Harmattan, Autrement Mêmes, 2003, p.173.
[49] Suite à un discours de Jules Ferry qui affirmait, en 1885, qu'il était du devoir de la France de « civiliser les races inférieures », un large consensus s'était rapidement développé parmi les intellectuels, les homme de science, l'Eglise, etc... pour justifier l'occupation de l'Afrique. Clemenceau avait certes engagé Jules Ferry à y regarder à deux fois avant d'accuser les autres « d'hommes ou de civilisations inférieures », mais ses mises en garde furent vite oubliées et, au début du 20e siècle, seules de très rares voix mettaient encore en doute « les bienfaits » de la colonisation. Il est à noter qu'un siècle plus tard, la France est encore loin de s'être libérée de ses fantasmes coloniaux. De plus les héritiers de la phrénologie, la craniologie et autres sciences que l'on pensait discréditées cherchent aujourd'hui encore à justifier par les chiffres « l'infériorité congénitale de la race noire ». L'article récent de J. Philippe Rushton et Arthur R. Jensen intitulé « Thirty years of research on race differences in cognitive ability » Psychology, Public Policy, and Law, Vol. 11, No. 2, 2005, pp. 235-294, n'est qu'un exemple parmi d'autres.
[50] Lucie Cousturier. Mes inconnus chez eux. Vol. 2. [1925]. Paris: L'Harmattan, 2003, p.145.
[51] Cousturier. Mes inconnus chez eux. Vol. 2, p.145. Dans le passage qui précède, elle écrit « [ma conviction] j'estime que je la dois simplement à une chance, à la chance de n'avoir pas été gênée dans mes observations par l'envoûtement du réquisitoire contre les observés, que mes émules ont subi pendant leur voyage ». La lecture de ce passage souligne indirectement l'influence perverse de livres tels que ceux de Marie-Louise Comeliau (citée plus haut).
[52] Note de Roger Little in Cousturier. Mes inconnus chez eux. Vol. 1, p.xvii.
[53] « Lettre inédite de la
Direction des Affaires Politiques et Administratives du gouvernement
général de l'A.O.F. adressée à Monsieur le Ministre
des Colonies » [1924] in Cousturier. Mes inconnus chez eux. Vol.
2, p.174.
Lucie Cousturier. [1925]. Mes inconnus chez eux, Vol. 2. Paris:
L'Harmattan, Autrement Mêmes, 2003. Présentation de Roger Little,
p.178.
[54] Extrait de la réaction officielle
à un rapport de Lucie Cousturier par un fonctionnaire colonial en 1924.
A noter que le rapport même de Lucie Cousturier semble avoir disparu des
archives.
Lucie Cousturier. [1925]. Mes inconnus chez eux, Vol. 2. Paris:
L'Harmattan, Autrement Mêmes, 2003. Présentation de Roger Little,
p.178.
[55] Little in Cousturier. Mes inconnus chez eux. Vol. 1, p.vi.
[56] Denise Moran. Tchad. Paris: Gallimard, 1934.
[57] Moran. Tchad, p.10.
[58] Moran. Tchad, p.11.
[59] Claire Griffiths. « Introduction », The Savineau Archive (Ma traduction) [Consulté le 30 septembre 2007]. [Réédition dans la collection Autrement Mêmes. Denise Savineau, La Famille en A.O.F. : condition de la femme. Rapport inédit, Paris: L'Harmattan, 2007. Présentation et étude de Claire Griffiths].
[60] Cousturier. Mes inconnus chez eux. Vol. 1, p.4.
[61] Griffiths. « Introduction », The Savineau Archive.
[62] Griffiths. « Introduction », The Savineau Archive.
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/French
Created: 4 November 2007
Modified: 6 January 2010 / 15 December 2012
https://aflit.arts.uwa.edu.au/colonies_20e_fr.html