
|
. |
Lire les femmes This article in English Femmes à l'époque coloniale |
| L'Afrique écrite au féminin. |
| Que sont les écrivaines de jadis devenues ? |
 L'évolution du système éducatif qui marqua la
première moitié du 20e siècle, en Afrique comme en France,
favorisa le développement d'une classe d'Africaines lettrées et
progressistes qui assuma bon nombre de responsabilités nouvelles. Ces
pionnières issues de « l'école française » ne
semblent pas avoir publié d'ouvrages à caractère
littéraire durant l'ère coloniale et l'on peut se demander la
raison de cette absence.
L'évolution du système éducatif qui marqua la
première moitié du 20e siècle, en Afrique comme en France,
favorisa le développement d'une classe d'Africaines lettrées et
progressistes qui assuma bon nombre de responsabilités nouvelles. Ces
pionnières issues de « l'école française » ne
semblent pas avoir publié d'ouvrages à caractère
littéraire durant l'ère coloniale et l'on peut se demander la
raison de cette absence.
Le discours colonial et les préjudices sexistes qui lui étaient attachés ont certainement joué un rôle important dans cet effacement. « Les archives coloniales, dit l'historienne Marie Rodet, ont essentiellement été produites par des hommes qui, dans leur projet de domination coloniale, ne se sont finalement que peu intéressés aux femmes [...], considérées uniquement en fonction de la famille et de leur fonction reproductive, et non en tant qu'individus »[1]. Quand l'administration s'occupait de « la fille indigène », c'était d'abord, comme le souligne Pape Momar Diop, « pour en faire de bonnes femmes d'intérieur, rompues aux travaux ménagers à l'occidentale »[2]. Mais d'autres facteurs ont aussi contribué à en effacer la trace. Les ethnologues, par exemple, passèrent l'Afrique à la loupe au début du 20e siècle mais comme ils avaient pour mission de décrire « les tribus primitives et authentiquement africaines en voie de disparition », un dialogue avec les femmes progressistes du continent n'entrait pas dans le champ de leurs préoccupations[3]. A l'heure des bilans, on se rend compte qu'en dépit de ses prétentions à l'impartialité, « l'Histoire ment toujours d'une certaine façon, au moins par omission »[4].
La scolarisation des filles qui passa d'un niveau « pratique » et rudimentaire assuré par des congrégations à un enseignement permettant aux premières Africaines d'entrer à l'université au milieu du 20e siècle, témoigne, par exemple, d'un phénomène évolutif encore mal connu. Même si les travaux de Pascale Barthélémy et quelques autres[5] sont susceptibles de « révolutionner notre connaissance du sujet »[6], comme le suggère Catherine Coquery-Vidrovitch, il reste difficile de déterminer l'influence de « l'école française » sur les changements d'attitudes et de comportements. Adame Ba Konaré écrit par exemple dans son Dictionnaire des femmes célèbres du Mali:
- On monte à vélo, avec l'intention de choquer la
société patriarcale [...] on va jusqu'à défier la
chronique coloniale en conduisant, comme c'est le cas de Marguerite Bertrant,
une voiture.
Certaines femmes menèrent la lutte au sein de regroupements et d'associations à caractère syndical et apolitique, préoccupées qu'elles étaient par le progrès social [...]
Quand arrive l'indépendance en 1960, les femmes constituent déjà une force non négligeable même si, sur le plan politique, on continuera à les maintenir dans une situation subordonnée[7].
Quelle importance eurent les livres et l'écriture pour ces femmes ? Quelle importance eurent-ils pour les sages-femmes issues de l'Ecole africaine de médecine et de pharmacie de Dakar créée en 1916 et pour les institutrices de l'Ecole Normale de jeunes filles de Rufisque, ouverte en 1938 ? Il est difficile de le savoir, même si certaines de ces femmes semblent avoir été de grandes lectrices. A preuve ces quelques lignes de l'autobiographie d'Aoua Kéita :
-
Jusqu'à cette époque [1935] je lisais beaucoup, mais surtout des
romans d'amour, des romans policiers et la presse médicale...[8]
Qu'une Africaine pût se déplacer à vélo, en auto ou même en avion – comme la journaliste camerounaise Thérèse Bella Mbida (née en 1932) photographiée aux commandes de son Cessna[9] – n'était pas conforme à la norme. Que cette même Africaine aimât lire et manifestât l'envie d'écrire paraissait tout aussi incongru. C'est sans doute pour cela qu'on ne s'est guère préoccupé d'un phénomène considéré alors comme marginal, et qu'aujourd'hui encore on ne sait quasi rien de ce qui a été écrit en français par des Africaines pendant l'époque coloniale. Rien, mis à part quelques textes épars et jugés sans intérêt « littéraire » au sens où certains définissent la littérature.
 Certes ces documents sont souvent très courts mais ils n'en sont pas
moins des fragments illuminateurs de la société coloniale vue
d'un point de vue féminin et africain. Les lettres écrites par
les adolescentes ayant fréquenté l'école coloniale, par
exemple, témoignent du rôle nouveau des jeunes lettrées
dans les relations familiales. Marie-Claire Matip (née en 1938) le
montre dans l'extrait suivant de son autobiographie :
Certes ces documents sont souvent très courts mais ils n'en sont pas
moins des fragments illuminateurs de la société coloniale vue
d'un point de vue féminin et africain. Les lettres écrites par
les adolescentes ayant fréquenté l'école coloniale, par
exemple, témoignent du rôle nouveau des jeunes lettrées
dans les relations familiales. Marie-Claire Matip (née en 1938) le
montre dans l'extrait suivant de son autobiographie :
L'écriture représente aussi un moyen de communiquer directement des sentiments très personnels à un ami ou à un amoureux. C'est le cas de ce billet adressé par une adolescente zambienne à son fiancé, dans les années 1920 :
La correspondance de Juliette et Fred publiée dans un des premiers numéros de Présence Africaine montre elle aussi la rapidité avec laquelle l'écriture s'adapte pour répondre aux besoins personnels des jeunes femmes qui l'utilisent à leur gré. Dans ces lettres, une élève de l'Ecole primaire supérieure voulant devenir institutrice évoque ses activités au jour le jour et déclare sa flamme à son ami, lui aussi élève instituteur[12] :
-
J'ai pensé toute cette nuit. Dis, Fred, ce n'est pas le métier
que j'aime en toi ; c'est toi-même, toute ta personne, ton cœur que
j'ai toujours chéri. Je t'avais dit d'aller partout où ta
vocation t'appellerait. Tu es entré en Enseignement et cela m'avait
beaucoup réjouie. Maintenant te voilà séparé de moi
pendant quatre ans. je t'aime et t'aimerai toujours tel que tu es ; si tu
changes de métier, tu ne changeras pas de cœur, je crois, cela ne
m'empéchera pas de t'aimer[13].
 Un passage de l'autobiographie d'Aoua Kéita qui se situe en 1932
souligne aussi l'importance des échanges épistolaires pour l'auteure. Son
fiancé Diawara a été envoyé par l'administration
dans une région très éloignée de celle où
elle habite – ce qui, dit d'Aoua Kéita, « était tout
à fait normal pour des fonctionnaires autochtones sous le régime
colonial »[14]. Faute de pouvoir se
voir, ils gardent le contact en s'écrivant, ce qui ne passe pas
inaperçu au village:
Un passage de l'autobiographie d'Aoua Kéita qui se situe en 1932
souligne aussi l'importance des échanges épistolaires pour l'auteure. Son
fiancé Diawara a été envoyé par l'administration
dans une région très éloignée de celle où
elle habite – ce qui, dit d'Aoua Kéita, « était tout
à fait normal pour des fonctionnaires autochtones sous le régime
colonial »[14]. Faute de pouvoir se
voir, ils gardent le contact en s'écrivant, ce qui ne passe pas
inaperçu au village:
-
– Non mon ami, répondit Baba Doucouré, commis des Postes [...]. A chaque courrier il y a une correspondance dans les deux sens. C'est moi-même qui me fais le plaisir d'apporter à mademoiselle les lettres[15].
Combien de lettres écrites par Aoua Kéita et d'autres ont-elles survécu ? Combien de pétitions adressées au Gouverneur des colonies comme celles de la Sénégalaise N'della Sey demandant en 1919 puis en 1920 la libération conditionnelle de son fils condamné à trois ans de prison ?[16] Combien de textes sollicités par des enseignants – missionnaires ou laïques – ont-ils échappé au sort des travaux d'écoliers ?[17] Combien de poèmes ? de récits autobiographiques comme celui d'une Togolaise anonyme, publié dans l'hebdomadaire Dakar-Jeunes en 1942 sous le titre « Je suis une Africaine...J'ai vingt ans »[18] ou aussi celui de la Camerounaise Marie-Claire Matip publié en 1958 ?[19] La réponse est simple : personne ne le sait vraiment[20].
Pour remonter à la source de la littérature noire africaine écrite au féminin, il faut quitter l'univers de l'Empire colonial français et regarder ailleurs.
 La première écrivaine noire africaine à avoir
publié un livre s'appelle Phillis Wheatley.
Née en 1753 en Afrique de l'Ouest, elle fut arrachée à sa terre natale à
l'âge de sept ans ou huit ans, transportée aux Etats-Unis et vendue comme
esclave à John et Susanna Wheatley qui la surnommèrent Phillis,
du nom du bateau sur lequel elle avait été transportée en
Amérique. Dotée d'une intelligence remarquable, Phillis
apprit l'anglais en un temps record. Encouragé par Madame Wheatley et sa fille, la jeune esclave se lança alors dans l'étude des textes canoniques de son époque et commença à écrire
des poèmes.
Agée de vingt ans à peine, elle devint la première femme
noire à publier un ouvrage littéraire[21]. Henry Louis Gates, Jr, un des préfaciers de la
réédition de ses œuvres deux siècles plus tard, rend
compte du caractère unique et tout à fait exceptionnel de
l'événement :
La première écrivaine noire africaine à avoir
publié un livre s'appelle Phillis Wheatley.
Née en 1753 en Afrique de l'Ouest, elle fut arrachée à sa terre natale à
l'âge de sept ans ou huit ans, transportée aux Etats-Unis et vendue comme
esclave à John et Susanna Wheatley qui la surnommèrent Phillis,
du nom du bateau sur lequel elle avait été transportée en
Amérique. Dotée d'une intelligence remarquable, Phillis
apprit l'anglais en un temps record. Encouragé par Madame Wheatley et sa fille, la jeune esclave se lança alors dans l'étude des textes canoniques de son époque et commença à écrire
des poèmes.
Agée de vingt ans à peine, elle devint la première femme
noire à publier un ouvrage littéraire[21]. Henry Louis Gates, Jr, un des préfaciers de la
réédition de ses œuvres deux siècles plus tard, rend
compte du caractère unique et tout à fait exceptionnel de
l'événement :
Influencée par son entourage, Phillis Wheatley partagea tout naturellement les préoccupations culturelles et religieuses de sa famille d'accueil, et elle fut influencée par le néoclassissisme et les philosophes anglais de son époque. Les titres des poèmes de son recueil intitulé Poems on various subjects, religious and moral témoignent de l'étendue des connaissances acquises chez les Wheatley et de son érudition: « To Maecenas », « On Virtue », « To the University of Cambridge, in New-England », « On the Rev. Dr. Sewell », « On the Death of a young Lady of five Years of Age », etc. Cette familiarité avec la culture occidentale ne signifie cependant pas que Phillis Wheatley se désolidarisa du sort de ses compagnons d'infortune - les milliers d'esclaves privés comme elle de leur liberté -. Une partie de sa correspondance et certains de ses poèmes le montrent. Le poème « De la transplantation d`Afrique en Amérique » souligne par exemple l'influence religieuse du milieu de la narratrice sur sa manière de penser, certes, mais il montre aussi que l'auteure ne renie pas ses origines et interpelle ceux de ses coreligionnaires qui professent des théories racistes essentialistes et attribuent aux Noirs des tares rédhibitoires :
-
La chance m'arracha à ma terre païenne,
Et apprit à mon âme jusqu'alors béotienne
Qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Sauveur :
De la rédemption j'ignorais le bonheur.
D'aucuns jugent les Noirs d'un dédaigneux regard :
« Leur couleur est du diable le terrible étendard ».
Souviens toi, Chrétien, qu'un Nègre aussi noir que Caïn
Plus raffiné devient, quand au cortège des anges il se joint[23].
On a peine à comprendre pourquoi l'œuvre de la première écrivaine noire demeure quasiment inconnue, en Afrique comme en France et dans le reste du monde où elle n'a jamais fait l'objet d'une réédition grand public. Pourquoi le bicentenaire de sa naissance – en 1753 – et celui de sa mort – en 1784 – n'ont pas donné lieu à de très officielles cérémonies du souvenir accompagnées d'un florilège d'études sur ses écrits ? Pourquoi, plus de deux siècles après la sortie de presse du premier livre publié par une Sénégalaise en Amérique, cet ouvrage et la correspondance de l'auteure n'ont toujours pas été traduits en français ? L'idéologie négrophobe et le sexisme qui, depuis des siècles, mènent le monde en général et la France en particulier n'y sont peut-être pas étrangers[24].
Absentes du 18e siècle, les écrivaines africaines d'expression française le sont aussi du 19e siècle[25]. Il serait par exemple intéressant d'en savoir plus sur la jeune Sénégalaise Anne Florence qui semble avoir été envoyée en métropole pour parfaire son éducation et mourut en France en 1836. A-t-elle laissé une trace écrite de son séjour en France ?[26] Peut-être, mais pour l'heure, faute de documents, c'est vers d'autres pays et d'autres langues qu'il faut se tourner pour évoquer les auteures d'origine africaine de cette époque. Vers le Brésil, par exemple, où Maria Firmina dos Reis publie Ursula en 1859 (un ouvrage écrit en portugais qui n'a jamais été traduit)[27]. Ou vers les Etats-Unis où Harriet E. Wilson publie la même année un roman intitulé Our Nig; or, Sketches from the Life of a Free Black (un ouvrage écrit en anglais qui n'a pas été traduit non plus)[28].
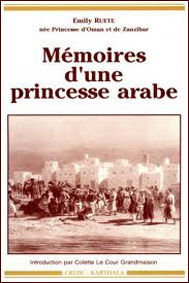 En Allemagne, on trouve l'un des textes les plus intéressants de cette
époque : l'autobiographie de la fille du Sultan de Zanzibar, la
Princesse Emily Ruete-Saïd (née en 1844). Cet ouvrage
intitulé Memoiren einer arabischen Prinzess [Mémoires
d'une Princesse Arabe] fut publié en 1886[29]. L'auteure y raconte sa vie et les
événements qui la conduisirent du palais de son père,
où elle passa son enfance, à Hambourg où elle retrouva
l'homme d'affaires qu'elle avait épousé en 1866 à Aden
avant de prendre le nom d'Emily Ruete-Saïd.
En Allemagne, on trouve l'un des textes les plus intéressants de cette
époque : l'autobiographie de la fille du Sultan de Zanzibar, la
Princesse Emily Ruete-Saïd (née en 1844). Cet ouvrage
intitulé Memoiren einer arabischen Prinzess [Mémoires
d'une Princesse Arabe] fut publié en 1886[29]. L'auteure y raconte sa vie et les
événements qui la conduisirent du palais de son père,
où elle passa son enfance, à Hambourg où elle retrouva
l'homme d'affaires qu'elle avait épousé en 1866 à Aden
avant de prendre le nom d'Emily Ruete-Saïd.
Mémoires d'une Princesse Arabe évoque la jeunesse de l'auteure, l'animation permanente du Palais de Bet il Mtoni, et les moments heureux passés en compagnie de ses parents. L'ouvrage n'omet pas non plus les moments difficiles, les intrigues, le différend de la narratrice avec son frère Bargash à la mort de leur père et l'ingérence de l'Angleterre dans la politique intérieure du pays. Connaissant bien les cultures africaine, arabe et européenne, Emily Ruete-Saïd propose une comparaison inédite des valeurs, de la culture et de la manière de vivre des Africains et des Européens de son entourage, c'est-à-dire des personnes issues de son milieu d'origine et de son milieu d'adoption. Il est fascinant de découvrir le point de vue d'une Africaine « parachutée » au cœur de l'Europe au milieu du 19e siècle car les souvenirs qui jaillissent de sa mémoire donnent lieu à des réflexions critiques et inédites sur la condition de la femme en Allemagne et à Zanzibar. Inutile de dire qu'elle ne partage en rien l'idéologie coloniale qui avait érigé en dogme la supériorité de la culture occidentale et sa « mission civilisatrice ». Un exemple :
-
A l'âge de six ou sept ans, tous mes frères et sœurs, sans
exception, devaient commencer l'école. Pour nous, les filles, seul
l'apprentissage de la lecture était obligatoire alors que les
garçons devaient aussi apprendre à écrire. [...] Les
leçons avaient lieu sur une véranda ouverte à tous les
vents et où les pigeons, les perroquets, les paons et les oiseaux
avaient libre accès [...]. Notre premier devoir était d'apprendre
l'alphabet arabe qui est compliqué, après quoi nous commencions
à pratiquer la lecture du Coran, le seul livre que nous
possédions [...].
En plus de la lecture et de l'écriture, on nous enseignait un peu de calcul [...]. Peu d'attention était accordée à la grammaire et à l'orthographe. Quant à l'histoire, la géographie, la physique et les mathématiques, je ne fis connaissance de ces sujets d'étude qu'en arrivant ici. Reste à savoir si le maigre savoir que j'ai laborieusement acquis ici au terme d'efforts considérables a amélioré mon sort. La question de savoir si ma situation est maintenant préférable à celle de mes amies demeurées en Afrique reste ouverte. Toutefois, je peux affirmer sincèrement que je n'ai jamais été aussi affreusement trompée et inquiétée que depuis que j'ai acquis les plus précieux trésors de la connaissance européenne. Bienheureux, vous qui ne pouvez imaginer ce qui est commis avec l'exaltation au nom de la civilisation[30].
L'absence de textes publiés par des Africaines d'expression française au 19e siècle se poursuit au 20e. Au terme de plus d'un siècle d'occupation et d'« aide au développement » imposés par Paris à ses colonies, on serait en mal de citer un seul ouvrage d'envergure publié par une écrivaine africaine « francophone » pendant l'ère coloniale. Personne approchant la notoriété de la militante féministe sierra-léonaise Casely-Hayford (1868-1960)[31] ou la persistance épistolaire de l'herboriste et guérisseuse sud-africaine Louisa Mvemve qui entretint un volumineux courrier avec le gouvernement au cours des années 1910-20[32]. Personne ! Et les témoignages ultérieurs concernant cette époque n'ont été publiés qu'au compte-gouttes. Un exemple en illustrera cent : seul le premier des neuf ouvrages écrits par la Guinéenne Sirah Baldé de Labé a été publié à ce jour, et encore à compte d'auteur[33]. Pourtant le témoignage de cette pionnière de l'enseignement de la langue française de sexe féminin dans l'ancien royaume peul du Fouta-Djalloo, « alors sous protectorat de la France », est capital.
Seul un tout petit nombre d'ouvrages publiés après 1960 rappelle les activités, les luttes et la manière de voir le monde des Africaines « francophones » qui ont vécu la colonisation pendant la première moitié du 20e siècle. L'autobiographie My Country Africa autobiography of the Black pasionaria[34] publiée en 1983 par Andrée Blouin (née en 1921) est du nombre.
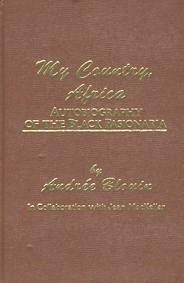 Ce texte d'une Africaine d'expression française, publié
curieusement en anglais – et jamais traduit en français – permet de
relever un certain nombre de partis pris qui vont au cœur de
l'idéologie coloniale française et expliquent en partie la
pauvreté du matériel concernant les femmes relevé plus
haut. Par exemple, ce n'est pas par hasard qu'une Américaine aida la
très « francophone » Andrée Blouin à
écrire l'histoire de sa vie – dans une langue qui n'était pas la
sienne – au début des années 1980. Contrairement à la
France où l'absence des Africaines dans le monde littéraire
n'avait pas encore été remarqué, l'Amérique des
années 1960 et 1970 prenait conscience du fait qu'il était temps
de rendre la parole aux femmes noires d'origine africaine afin qu'elles
puissent raconter leur histoire elles-mêmes. Comme le souligne Mary Helen
Washington :
Ce texte d'une Africaine d'expression française, publié
curieusement en anglais – et jamais traduit en français – permet de
relever un certain nombre de partis pris qui vont au cœur de
l'idéologie coloniale française et expliquent en partie la
pauvreté du matériel concernant les femmes relevé plus
haut. Par exemple, ce n'est pas par hasard qu'une Américaine aida la
très « francophone » Andrée Blouin à
écrire l'histoire de sa vie – dans une langue qui n'était pas la
sienne – au début des années 1980. Contrairement à la
France où l'absence des Africaines dans le monde littéraire
n'avait pas encore été remarqué, l'Amérique des
années 1960 et 1970 prenait conscience du fait qu'il était temps
de rendre la parole aux femmes noires d'origine africaine afin qu'elles
puissent raconter leur histoire elles-mêmes. Comme le souligne Mary Helen
Washington :
Pour l'Amérique, l'heure était arrivée de secouer l'establishment littéraire et de réhabiliter un discours féminin qui avait été ignoré pendant deux siècles. En France, tout au contraire, on restait fermement attaché à l'idée d'une littérature indépendante des contingences, des inégalités, des problèmes de genres et du monde « réel ». La critique des premiers romanciers africains proposée par la Franco-Sénégalaise Catherine N'Diaye (née en 1952) en offre à la fois l'esprit et l'illustration :
-
Nos écrivains croyaient souffrir d'un manque, dit-elle. Ils ont cru
qu'ils avaient le devoir de répondre à un besoin – de boucher un
creux [... mais] l'art ne saurait jamais naître d'un manque trivial[36].
Face au silence étourdissant qui s'élevait d'un univers littéraire qui les avait longtemps ignorées, les intellectuelles noires anglophones changeaient les règles du jeu alors que les francophones essayaient de s'y conformer sans vraiment remettre en cause la « triviale » absence de leurs aïeules à qui l'école coloniale n'avait guère offert l'occasion de disserter sur la suprématie de l'art.
Andrée Blouin, fille d'un commerçant français et de Joséphine Wouassimba d'origine Banziri, n'avait pas sa chance dans l'univers des lettres françaises. Elle s'était engagée dans le Rassemblement Démocratique Africain [RDA] en Guinée puis était devenue une figure de proue du mouvement indépendantiste congolais aux côtés de Lumumba dans les années 1960, mais l'éducation qu'elle avait reçue dans le couvent de Brazzaville où elle fut enfermée par son père à l'âge de trois ans pour n'en ressortir qu'à dix-sept, ne lui permettait certainement pas d'écrire ses mémoires en « converti[ssant] le manque d'être jusqu'à le rendre méconnaissable » pour reprendre une formule de Catherine N'Diaye[37]. Sans les bons offices de Jean MacKellar, personne ne connaîtrait aujourd'hui l'histoire et la destinée exceptionnelles de la petite fille métisse arrachée à sa mère et incarcérée dans un couvent-prison avec le matricule no 22 en 1924[38].
A l'époque où Andrée Blouin est confiée aux « bons » soins des Religieuses, le Congo, la Belgique, l'Oubangui, la France, et le reste du monde colonial vivent au gré des convenances et des dichotomies qui ont dominé la première moitié du vingtième siècle: "Noir - Blanc", "Métropole - Colonie", "évolué - primitif", etc. Les mythes fondateurs de l'idéal colonial en appellent à l'homogénéité des masses, à la supériorité du colonisateur et à la ségrégation des races. Comme le montre Odile Tobner dans son ouvrage Du racisme français, quatre siècles de négrophobie, « le XIXe siècle va voir proliférer les théories racistes à prétentions scientifiques [et] le bêtisier raciste s'ornera alors des plus grandes signatures »[39] : Paul Broca, Andress Retzius, Georges Vacher de Lapouge, Ernest Renan, Jules Ferry, Joseph Arthur de Gobineau - auteur de l'Essai sur l'inégalité des races humaines[40] – tous, et bien d'autres dans leur sillage, s'appliquent à prouver la supériorité de l'Européen sur l'Africain et, au début du 20e siècle, plus personne n'en doute.
La suprématie de la race blanche imposée par les armes et confirmée par la science devient un dogme. Pour le grand public, c'est « un fait incontestable » qui non seulement justifie l'action coloniale mais fait aussi du développement des colonies une nécessité politique et morale. Cette vision a donné naissance à des mythes encore bien vivaces, entre autres les concepts de « Coopération » et de « Francophonie », et elle conforte l'attitude des colons envoyés en Afrique pour y « civiliser » – maintenant on dit « aider » – les Africains. L'attitude du père d'Andrée montre toutefois l'espace qui sépare le discours officiel de sa mise en application au début du 20e siècle. D'abord, la présence de Pierre Gerbillat au Congo n'a rien d'altruiste. Elle s'explique par son intention de « faire fortune dans la jungle encore inexplorée d'Afrique noire »[41]. Ensuite, sa conduite n'a rien d'édifiant. « Epouser » une fille à peine pubère lors de son passage dans un village reculé d'Oubangui-Chari – alors qu'il est déjà fiancé avec une jeune femme belge qui le rejoindra quelques années plus tard – en dit long sur ses principes et sa moralité qui n'ont rien d'exemplaires. Son sens des responsabilités n'est d'ailleurs guère plus développé car il n'hésite pas à arracher la petite Andrée à sa mère pour l'abandonner chez les Sœurs missionnaires chargées de faire payer aux filles nées trop blanches « la faute » de leur père.
L'arrachement d'Andrée Blouin à sa famille maternelle à un très jeune âge, son éducation rigide chez les Sœurs et ses relations intimes avec un certain nombre de colons belges et français sont tout à fait conformes à la logique coloniale. Ce qui ne l'est pas, c'est que Mme Blouin ait fini par échapper à ce parcours tracé d'avance par l'autorité et qu'elle soit devenue une militante aux côtés de Sékou Touré puis de Lumumba. Comme elle le souligne dans son autobiographie :
-
Pendant plusieurs années [...] je fus incapable de participer à
la lutte africaine pour l'autodétermination. Je ne pouvais pas vaincre
la résignation que m'avaient inculquée les Sœurs. Je
m'inclinais, je me taisais, je m'enfermais dans la morne passivité des
autres femmes de ma race.
Ce n'est qu'après avoir été mariée deux fois - ironiquement les deux fois avec un homme blanc – que j'ai trouvé un certain équilibre et le courage de m'impliquer dans une cause aux côtés des miens. Seulement à ce moment là fus-je capable de transcender mon héritage noir et blanc et de devenir plus que l'image stéréotypée de chacun d'eux et d'être simplement une femme, un être humain. Ce fut à ce moment que je décidai de donner ma vie pour la lutte des Noirs[42].
« Donner sa vie » doit être ici interprété au sens littéral car lors du Référendum organisé par la France, les membres du RDA recommandant de voter « Non », furent non seulement la proie « de vexations, de provocations et de tentatives d'intimidation », mais Mme Blouin fut également victime de deux tentatives d'assassinat organisées par des agents français[43]. Elle continua d'ailleurs à être persécutée par la France après la victoire du RDA aux élections législatives et fut contrainte de quitter la Guinée, son mari ayant été démis de son poste et mis en disponibilité suite aux pressions exercées par le Gouverneur Ramadier. Le gouvernement français s'en prenait au mari pour faire taire la femme, comme ce fut le cas de Madame Bonnetain, victime du même procédé un demi-siècle auparavant[44]. On comprend dès lors mieux qu'il n'ait pas été dans l'intérêt de Paris d'encourager la publication d'un témoignage qui aurait permis aux Français de revisiter l'histoire de ses colonies et de reconnaître les excès qu'on y avait commis. Le témoignage de Mme Blouin était d'autant plus accablant que son engagement ultérieur aux côtés de Lumumba se termina lui aussi par un des épisodes les plus infâmants de la colonisation, le meurtre de Lumumba par des agents belges et l'expulsion définitive de la famille Blouin du Congo.
Si Andrée Blouin attribue au charisme de Sékou Touré sa décision de se lancer en politique, quelques moments forts de sa vie l'avaient sensibilisée à l'oppression coloniale bien avant qu'elle ne rencontrât le leader guinéen : d'abord, à l'aube de ses huit ans, elle fut traumatisée, dit-elle, par le spectacle de centaines d'hommes défilant devant les grilles du couvent, enchaînés, sanglants et brutalisés par leurs gardes qui maniaient allégrement la chicotte. Dix ans plus tard, alors qu'elle accompagne son nouvel ami Roger sur les routes du Congo, émerveillée par le confort dont s'est entouré le jeune homme qui a même un petit réfrigérateur pour son cognac et son eau Perrier, elle est ramenée à la dure réalité du monde colonial et aux images qui avaient hanté son enfance. Les interminables files d'hommes à moitié nus chargés du maintien des routes sous la surveillance de Noirs en uniformes, armés de leurs terribles chicottes, offrent un spectacle pour elle insoutenable. Les femmes et les enfants transportant terre et pierraille ajoutent encore au décor misérable qui lui arrache des larmes ; mais, comme dix ans auparavant lorsqu'elle était chez les Sœurs, elle se sent tout à fait démunie et impuissante à faire quoi que ce soit. A cet apprentissage impitoyable de la misère des autres, s'ajoutent les humiliations qu'on lui inflige, à elle, en lui rappelant à tout moment que, bien qu'elle soit blanche de peau, elle reste « une négresse » : on l'expulse du Cinéma Athenakis, certains commerçants refusent de lui vendre des articles réservés aux Blancs, d'autres l'insultent. Rien ne lui permet d'oublier le terrible régime d'apartheid mis en place par l'Europe dans ses colonies africaines. Au cœur de cet univers déshumanisé, l'épisode le plus douloureux, celui qui a peut-être le plus pesé dans sa décision de s'engager dans l'action politique lorsque l'occasion se présenta, fut la mort de son fils, victime d'un accès de malaria qui l'emporta car les autorités refusaient qu'on lui fît les piqûres de quinine qui lui aurait sauvé la vie, sous le prétexte qu'il était « noir ».
L'engagement politique d'Andrée Blouin n'est de loin pas un cas isolé et son origine n'est guère différente de celle des nombreuses militantes africaines de l'époque coloniale qui manifestèrent au nom du droit et de la justice sociale. L'opuscule d'Henriette Diabaté relatant La marche des femmes sur Grand-Bassam (publié en 1975) en témoigne. Cet ouvrage évoque l'un des épisodes les plus spectaculaires de la lutte menée par les femmes contre les abus de l'autorité coloniale. Suite à l'arrestation des responsables du RDA en 1949 et leur détention arbitraire pendant de longs mois sans qu'ils fussent jugés, des milliers de femmes se rendirent d'Abidjan à Grand-Bassam où les prisonniers avaient été incarcérés et avaient entamé une grève de la faim afin d'exiger leur libération[45]. Déjouant les mesures prises par le Gouverneur, les barrages de police et les déploiements militaires mis en place pour les empêcher de manifester, les militantes se retrouvèrent en masse aux portes de la prison mais le Procureur refusa de les rencontrer et finit par envoyer ses gendarmes et ses gardes de cercle pour les disperser. Parmi les rares témoignages légués à la postérité par une femme, celui de Mami Landji N'Dri rend compte de ces journées terribles :
-
Etant donné la tournure que prenaient les événements, et
craignant d'être débordé, le commissaire avait
demandé du renfort à Abidjan, deux pelotons de gardes et les
capitaines de gendarmerie Maillet et Lemoine arrivèrent vers dix heures.
Ils allèrent renforcer, côté prison, la garnison qui
jusqu'à présent n'avait rien fait d'autre que de tenir les femmes
en respect.
« Soudain il y eut un remue-ménage, une ruée de
militaires... Au fond de moi-même je pensais : c'en est fait de nous,
nous allons être fusillées. » [...] Le Blanc nous parla une
fois de plus : « Je vous ai dit de déguerpir. [...] Allez-vous en
! ». Nous ne bougions pas. [...] Après la troisième
sommation il sortit son sifflet et appela des gardes. [...] Le Blanc donna des
ordres et les militaires commencèrent à nous repousser avec la
crosse de leurs fusils. [...] les coups de chicotte pleuvaient et nous
poussions des cris [...]. Nous fûment refoulées jusqu'au pont. Il
était environ midi.
Le service d'ordre après avoir retiré les quarante gendarmes et
les vingt gardes de cercle, lança des grenades lacrymogènes sur
les femmes rassemblées au carrefour d'Impérial. [...] une femme
baoulé nanafoué reçut du gaz dans les yeux : elle devait
devenir aveugle par la suite ; beaucoup de femmes eurent le corps couvert de
cloques[46].
Ce fut donc blessées, déçues et ulcérées que des milliers de femmes s'en retournèrent chez elles sans avoir réussi à obtenir la libération des dirigeants du Rassemblement Démocratique Africain [RDA] qui furent finalement jugés – et certains libérés – au début de 1950. Paris avait gagné mais comme devait le rappeler M. Koffi Gadeau au cours du 5e Congrès du PDCI-RDA, « plus que les hommes dont quelques-uns étaient prêts à tourner casaque, les femmes de Côte d'Ivoire donnèrent le spectacle le plus probant de leur maturité politique et de leur combativité »[47].
 L'autobiographie de la Malienne Aoua Kéita Femme d'Afrique. La vie
d'Aoua Kéita racontée par elle-même (publiée en
1975) témoigne elle aussi de la force de caractère et de la
détermination de la narratrice. Unique dans l'univers
historico-littéraire d'expression française, cet ouvrage souligne
l'engagement d'une Africaine dans la vie sociale et politique de son pays
à l'époque coloniale. Aoua Kéita est née en 1912 au
Mali. Contre l'avis de sa mère, son père décida de
l'envoyer à la première école des filles de Bamako ouverte
par l'administration coloniale. Sa facilité lui permit d'entrer ensuite
à l'Ecole de Médecine de Dakar d'où elle sortit sage-femme
diplômée en 1931[48].
Affectée à Goa, elle ne tarda pas à établir des
liens amicaux avec les femmes qu'elle accouchait et qui venaient la consulter
pour toutes sortes de problèmes gynécologiques. En 1935, elle
épousa M. Diawara. Comme elle le relève dans son ouvrage, c'est
au contact de ce dernier qu'elle commença à s'intéresser
à la politique :
L'autobiographie de la Malienne Aoua Kéita Femme d'Afrique. La vie
d'Aoua Kéita racontée par elle-même (publiée en
1975) témoigne elle aussi de la force de caractère et de la
détermination de la narratrice. Unique dans l'univers
historico-littéraire d'expression française, cet ouvrage souligne
l'engagement d'une Africaine dans la vie sociale et politique de son pays
à l'époque coloniale. Aoua Kéita est née en 1912 au
Mali. Contre l'avis de sa mère, son père décida de
l'envoyer à la première école des filles de Bamako ouverte
par l'administration coloniale. Sa facilité lui permit d'entrer ensuite
à l'Ecole de Médecine de Dakar d'où elle sortit sage-femme
diplômée en 1931[48].
Affectée à Goa, elle ne tarda pas à établir des
liens amicaux avec les femmes qu'elle accouchait et qui venaient la consulter
pour toutes sortes de problèmes gynécologiques. En 1935, elle
épousa M. Diawara. Comme elle le relève dans son ouvrage, c'est
au contact de ce dernier qu'elle commença à s'intéresser
à la politique :
-
Les femmes n'avaient pas encore obtenu le droit de vote. Malgré cela,
Diawara me faisait toujours part de ses prises de position ce qui me permit de
m'intéresser un peu à la politique. Avec lui, j'ai
commencé à suivre d'assez loin le déroulement des
événements qui opposèrent l'Empire d'Ethiopie avec les
Italiens. Avec lui j'appris à connaître et à condamner les
agresseurs[49].
Dix ans plus tard, Aoua Kéita et Diawara s'engagent à fond dans les activités de l'Union Soudanaise du Rassemblement Démocratique Africain [USRDA]. Tous deux refusent les avantages financiers que leur proposait l'administration française et deviennent une menace pour le gouvernement et les Européens confortablement installés dans leurs privilèges:
-
Mes clientes européennes qui étaient devenues mes amies, dit Aoua
Kéita, commencèrent à prendre leurs distances. [...] Un
jour Mme Thomas, épouse du technicien chargé de la petite usine
de fabrique d'huile et de savon me dit :
« Madame Diawara, je pense que vous devriez faire attention. Vous aviez
beaucoup d'amis parmi l'élément européen à cause de
votre compétence et de votre gentillesse. En ce moment votre
popularité diminue ainsi que celle de votre mari [...]. Cela à
cause de vos activités politiques, c'est vraiment dommage. »[50].
Les menaces et les mutations disciplinaires qui s'en suivirent ne diminuèrent en rien les activités de militante d'Aoua Kéita. En 1957, elle créa un mouvement intersyndical féminin qu'elle représenta au Congrès constitutif de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. L'année suivante elle fut nommée membre du comité constitutionnel de la République soudanaise.
Si l'autobiographie d'Aoua Kéita dépeint les abus de l'autorité coloniale, elle souligne aussi la difficulté des Africaines progressistes de sa génération à faire évoluer les attitudes de leurs compatriotes. Un passage évoquant son arrivée dans un petit bureau de vote, le jour des élections du 8 avril 1959, illustre l'animosité de certains face aux nouveaux pouvoirs octroyés aux femmes :
-
Le chef de village, un ancien combattant de l'Armée française me
reçut en hurlant en français, bambara et mianka :
« Sors de mon village, femme audacieuse. Il faut que tu sois non seulement audacieuse mais surtout effrontée pour essayer de te mesurer aux hommes en acceptant une place d'homme. Mais tu n'as rien fait. C'est la faute des fous dirigeants du RDA qui bafouent les hommes de ce pays en faisant de toi leur égale. Hé ! population de Singné, vous voyez ça ? Koutiala, un pays de vaillant guerriers, de grands chasseurs, de courageux anciens combattants de l'Armée française, avoir une petite femme de rien du tout à sa tête ? Non, pas possible...[51].
De plus, un engagement politique ou professionnel était souvent difficile à concilier avec les exigences de la famille, pour laquelle d'autres obligations étaient prioritaires. Par exemple, Aoua Kéita est contrainte de se séparer de son mari après plusieurs années de mariage car elle ne peut pas avoir d'enfants et sa belle-mère harcèle son fils pour qu'il prenne une seconde femme. Sommé de choisir entre sa femme et sa mère qui menace de le maudire « même dans la tombe » s'il ne prend pas une autre épouse capable de lui donner des enfants, Diawara choisit d'obéir à sa mère. Il est intéressant de noter que l'on retrouve une situation très similaire dans le roman Une si longue lettre de la Sénégalaise Mariama Bâ (née en 1929) qui met elle aussi en scène un mari cédant aux injonctions de sa mère, et épousant une seconde femme, ce qui précipite le départ de la première[52]. Une interview d'Annette Mbaye d'Erneville (née en 1926), journaliste puis directrice des programmes à l'office de radiodiffusion du Sénégal laisse également deviner les difficultés familiales qui guettent les intellectuelles de sa génération :
-
Durant mon séjour à Diourbel, j'ai écrit de nombreux
manuscrits qui sont encore inédits. Cette période a
été une époque féconde sur le plan intellectuel. Je
n'étais pas heureuse en ménage. Je me sentais très seule.
[...] J'écrivais pour sortir de mon isolement. Ecrire était une
sorte d'évasion...[53]
On retrouve là, l'écho des propos d'Aoua Kéita :
-
[...] la vie solitaire me fut difficile à supporter. [...] Les heures
non ouvrables et une bonne partie de mes nuits étaient consacrées
à la lecture, au jardinage, au tricotage, à la couture, car il
fallut reprendre toutes mes robes qui étaient devenues trop larges[54].
Au cours de la génération suivante, d'autres femmes poursuivent l'œuvre amorcée pendant la première moitié du 20e siècle et accèdent aux plus hautes fonctions gouvernementales. La Camerounaise Delphine Zanga Tsogo (née en 1935) n'est qu'un exemple parmi d'autres. Tout comme Aoua Kéita, elle est infirmière et doit son ascension politique à son travail de militante dans les associations féminines de son pays. Aussi, dit-elle, son meilleur souvenir est associé à l'immense joie exprimée par les femmes de son entourage le jour de sa nomination comme Ministre, en 1975. Son roman L'oiseau en cage montre que si les mentalités changent, les Indépendances sont loin d'avoir éliminé d'un coup de baguette magique, les difficultés auxquelles avaient dû faire face les femmes de la génération précédente. Officiellement, les colonisateurs ont quitté l'Afrique mais le sexisme n'est pas mort et nombreux sont les Africains qui continuent à y affirmer qu'en voulant être l'égale de l'homme, la femme semble oublier le « dessein de Dieu [qui] dans sa sagesse infinie, n'a pas pensé créer l'homme et la femme égaux »[55]. En dépit des idées progressistes qui s'installent, plus d'un mari continue à affirmer que quels que soient leur niveau d'instruction, leur travail, leur revenu et leur désir d'indépendance, les épouses doivent se souvenir que « la subordination de la femme est une loi antique qui constitue la base de notre édifice social. »[56].
 De Tilène au Plateau. Une enfance Dakaroise, l'autobiographie de
Nafissatou Diallo (née en 1941), est intéressante à cet
égard car elle offre une vision différente de la
société traditionnelle du début du 20e siècle que
dépeignent les auteures précédentes. Elle montre d'abord
que si la famille africaine de l'époque coloniale accordait au
père et au mari un pouvoir exorbitant par rapport à celui
octroyé à sa femme, la société africaine ne
manquait pas de personnalités féminines « traditionnelles
» dotées d'une influence considérable. La mère de
Diawara obligeant son fils à prendre une nouvelle femme en offrait déjà
l'exemple. Mame, la grand-mère de Nafissatou Diallo chargée de
l'éducation de sa petite-fille depuis la mort de sa mère, en
fournit un autre :
De Tilène au Plateau. Une enfance Dakaroise, l'autobiographie de
Nafissatou Diallo (née en 1941), est intéressante à cet
égard car elle offre une vision différente de la
société traditionnelle du début du 20e siècle que
dépeignent les auteures précédentes. Elle montre d'abord
que si la famille africaine de l'époque coloniale accordait au
père et au mari un pouvoir exorbitant par rapport à celui
octroyé à sa femme, la société africaine ne
manquait pas de personnalités féminines « traditionnelles
» dotées d'une influence considérable. La mère de
Diawara obligeant son fils à prendre une nouvelle femme en offrait déjà
l'exemple. Mame, la grand-mère de Nafissatou Diallo chargée de
l'éducation de sa petite-fille depuis la mort de sa mère, en
fournit un autre :
Généreuse d'ailleurs, elle n'avait que trop de « petits fils », orphelins, mendiants, étrangers démunis, à héberger, habiller nourrir à nos dépens. Mon père et mes oncles désapprouvaient ses extravagances, mais devant sa détermination, ils pliaient.[57]
Ensuite, l'autobiographie de Nafissatou Diallo montre que la rencontre de différentes cultures et l'apprentissage de la différence n'est pas forcément source de drames ou de choix cornéliens. La narratrice, qui a perdu sa mère très jeune, vit dans une large famille établie à Dakar depuis plusieurs générations. Très attachée à sa grand-mère et à son père, Nafissatou Diallo décrit son enfance puis son adolescence au sein d'un milieu familial chaleureux. Elle n'a que compliments pour l'éducation dont elle a bénéficié, tant à l'école française qu'à la maison. Soutenue par sa famille, bien intégrée dans la société qui l'entoure et soucieuse d'en respecter les traditions et ses devoirs religieux, elle n'éprouve aucune difficulté à se plier aux exigences de l'école coloniale et à assimiler les coutumes françaises dans la foulée.
Cela ne signifie pas pour autant qu'elle abandonne son identité sénégalaise. Comme Aoua Kéita et Delphine Zanga Tsogo, Nafissatou Diallo devient infirmière, se marie et ses stages terminés, elle commence à travailler comme sage-femme et puéricultrice tout en s'occupant de sa famille et en élevant ses enfants, mais à l'inverse des sages-femmes citées plus haut, elle ne fait pas figure de femme à la destinée exceptionnelle. Elle rentre dans le rang, pourrait-on dire, et illustre à merveille l'Africaine de la seconde moitié du 20e siècle qui a pris en main non seulement sa destinée mais aussi, dans la foulée, celle du continent et qui navigue à vue entre les écueils semés sur son chemin par la modernité aussi bien que par la tradition.
Le roman d'inspiration autobiographique d'Amina Sow Mbaye (née en 1937) intitulée « Mademoiselle » [58] reflète la même approche. L'ouvrage raconte les débuts de la carrière d'enseignante d'Aïda, une jeune Sénégalaise qui vient de finir sa formation d'institutrice. Envoyée dans un gros village au Nord du Sénégal, elle adapte ses méthodes d'enseignement aux besoins des élèves qui lui sont confiés et organise de nouvelles activités pour les jeunes telles que le scoutisme et le basket-ball. Comme Nafissatou Diallo, le personnage semi fictif du roman d'Amina Sow Mbaye se marie vers l'âge de vingt ans, continue sa formation professionnelle et s'intègre sans heurts dans la fonction publique où l'attend « une nouvelle vie très laborieuse [...] partagée entre son rôle de femme, de mère et de chef de service »[59]. Ce qui faisait figure d'exception à la génération précédente est en passe de devenir la norme même si cette évolution échappe une fois de plus au regard figé de la France sur les femmes africaines.
La colonisation a voulu que les plus grandes plumes des lettres françaises de l'ère coloniale se soient égarées dans les eaux troubles du racisme, qu'elles aient achoppé aux mêmes clivages et ressassé les mêmes images stéréotypées de l'Afrique et des Africaines. Il est temps de revisiter les archives et d'en ressortir les documents concernant les femmes qu'une vision étroite de la littérarité « à la française » nous a permis trop longtemps d'ignorer.
Jean-Marie Volet
2008
| Vivre en marge des conventions. La face cachée du monde colonial africain au 20e siècle. |
Notes
[1] Marie Rodet. « Réflexions sur l'utilisation des sources coloniales pour retracer l'histoire du travail des femmes au Soudan français (1919-1946) ». Etudes africaines / état des lieux et des savoirs en France. 1re Rencontre du Réseau des études africaines en France, novembre 2006, Paris.
[https://www.etudes-africaines.cnrs.fr/ficheateliers.php?recordID=46] [Consulté le 16 novembre 2007].
[2] Pape Momar Diop. « L'enseignement de
la fille indigène en AOF, 1903-1958 », in AOF :
réalités et héritage. Sociétés ouest
africaines et ordre colonial 1895-1960. Dakar: Direction des Archives du
Sénégal, 1995, pp.1081-1096.
[https://tekrur-ucad.refer.sn/article.php3?id_article=91]. [Consulté le
15 janvier 2008].
A noter aussi l'article de Pascale Barthélémy
« Instruction ou éducation ? La formation des Africaines à
l'Ecole Normale d'institutrices de l'AOF de 1938 à 1958 ».
Cahiers d'études africaines169-170, 2003.
[https://etudesafricaines.revues.org/document205.html] [Consulté le 16
janvier 2008].
[3] Voir par exemple les premières recherches de l'ethnologue Denise Paulme dont la vie et l'œuvre sont esquissées par Alice Byrne dans La quête d'une femme ethnologue au cœur de l'Afrique Coloniale. Denise Paulme 1909-1998 (n.d.) [https://sites.univ-provence.fr/~wclio-af/numero/6/thematique/chap1Byrne.html] [Consulté le 12 janvier 2008].
[4] Odile Tobner. Du racisme français. Quatre siècles de négrophobie. Paris : Les Arènes, 2007, p.258.
[5] Voir entre autres Pascale Barthélémy. Femmes, africaines et diplômées : une élite auxiliaire à l'époque coloniale. Sages-femmes et institutrices en Afrique occidentale française (1918-1957), thèse de doctorat d'histoire, Université Paris 7-Denis Diderot, 2004, 945 p.
[6] Catherine Coquery-Vidrovitch. « African Studies in France ». H-AFRICA Africa Forum, 27 August 2001. [https://www.h-net.org/~africa/africaforum/Coquery-Vidrovitch.html] [Consulté le 26 janvier 2008].
[7]
Adame Ba Konaré. Dictionnaire des femmes célèbres du
Mali. Bamako : Editions Jamana, 1993, pp.54-55.
Notons que dans son autobiographie, Aoua Kéita écrit par exemple
en regard de l'année 1949 : « Une partie de mes dimanches
après-midi se passait en promenade à bicyclette ... ». Aoua
Kéita. Femme d'Afrique. la vie d'Aoua Kéita racontée
par elle-même. Présence Africaine, 1975, p.79.
[8] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.45.
[9] Rachel-Claire Okani. Hommage à la femme camerounaise.Yaoundé : Editions CIAG, 1995, p.40.
[10] Marie-Claire Matip. Ngonda, Paris : Bibliothèque du jeune Africain, 1958, p.21.
[11] Cité par Marthe Kuntz, missionnaire au Zambèze depuis 1913, dans son ouvrage Terre d'Afrique. Notes et Souvenirs. Paris, Société des Missions Evangéliques, 1932, p.78.
[12] Charles Béart. «
Intimité : lettres de la fiancée ». In Présence
Africaine 8-9, 1950, pp.271-288.
Pascale Barthélémy cite aussi un Procès verbal du conseil
de discipline de l'Ecole Normale du 6 mai 1947 : « Quelques mois plus
tard, le conseil de discipline décide le renvoi d'une Camerounaise de 3e
année qui « entretient avec des jeunes gens des relations
clandestines, utilisant à cet effet des moyens illicites et
inattendus... Une correspondance saisie de façon fortuite par Mme la
directrice a révélé que X a profité d'un
récent service religieux à la mémoire d'un de ses
compatriotes camerounais pour recevoir et échanger des lettres avec des
jeunes gens ». « Instruction ou éducation ? La formation des
Africaines à l'Ecole Normale d'institutrices de l'AOF de 1938 à
1958 ». Cahiers d'études africaines pp.169-170, 2003.
[https://etudesafricaines.revues.org/document205.html] [Consulté le 16
janvier 2008].
[13] Charles Béart. « Intimité... », p.288.
[14] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.45, et d'ajouter : « Parfois le cynisme des colonialistes les poussait jusqu'à diviser des vieux ménages »
[15] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.34.
[16] « Lettre 1 et Lettre 2 » [1919 et 1920] in Esi Sutherland-Addy et Aminata Diaw. Des femmes écrivent l'Afrique : l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Paris : Karthala, 2007, pp.242-243.
[17] A l'instar de « Ma petite patrie », quelques pages de la Sénégalaise Mariama Bâ (née en 1929) écrites par l'auteur en 1943, alors qu'elle venait d'être admise à l'Ecole Normale de Rufisque. Relevons aussi ce passage de Marie-Claire Matip. Ngonda, p.40. : « Qui n'a pas souri d'aise devant un ouvrage sorti de ses mains ou de son esprit ? [...] Cette joie, je l'ai ressentie profondément lorsqu'en sixième je rédigeais des textes personnels dont j'avais moi-même choisi le sujet et poli la forme. Notre professeur, en effet, nous donnait cette liberté dans le choix de nos thèmes. Nous les travaillions en commun sur le tableau noir. Chacun reflétait notre personnalité : aussi notre joie était grande de les voir au tableau, lus par toutes et servant d'exemple. Je relis encore aujourd'hui le petit poème, oh! combien simple et naïf, que j'avais écrit avec le sérieux de mon âge et que j'avais intitulé "Petite Léonce" ».
[18] Anonyme, « Je suis une Africaine...J'ai vingt ans ». Dakar Jeunes no 10, 12 mars 1942, p.11. Cette autobiographie d'une page s'achève par ces mots : « J'aime la vie. J'accepte même à l'avance les jours sombres. J'ai toujours pensé que ce qui meurt doit renaître. « La vie est une mère, dit un proverbe indigène ; si d'une main elle châtie de l'autre elle caresse ». J'aime la nature belle et calme, la fleur et son parfum, le soleil éblouissant et brûlant de mon Afrique, la nuit sombre ou étoilée, même le cri lugubre du hibou le soir et je suis même indulgente aux sceptiques, à ceux qui critiquent notre école Normale, notre « Maison », sans la connaître et qui pensent qu'éternellement, la femme indigène demeurera impersonnelle, sans dignité, la servante résignée qu'un homme peut prendre ou délaisser suivant son caprice. ». Voir le dossier "Je suis une Africaine...j'ai vingt ans". Autobiographie d'une jeune institutrice togolaise.
[19] Marie-Claire Matip. Ngonda, Paris : Bibliothèque du jeune Africain, 1958.
[20] Un email de Pascale Barthélémy adressé à Charles Becker le 24 janvier 2008 permet d'imaginer qu'il y a sans doute plus de textes écrits par des Africaines au début/milieu du 20e siècle qu'on ne le pense généralement, le corollaire étant qu'il faudrait les retrouver et leur accorder plus d'attention : « ... Frida Lawson, sur laquelle j'ai peu de renseignements [...] a beaucoup écrit pendant ses années de scolarité à Rufisque. Elle a un "style" bien à elle que l'on retrouve dans des compte-rendus rédigés pour sa directrice (Germaine Le Goff) dont vous avez sans doute entendu parlé (elle a dirigé Rufisque de 38 à 45, je lui ai consacré un article dans les Hommages à Catherine Coquery). Frida Lawson était chargée de mener (comme responsable) les expéditions que représentaient les voyages de retour dans leurs familles pour les élèves au moment des grandes vacances. J'ai photocopié plusieurs de ses récits de "traversée" de l'AOF et les ai analysés dans ma thèse mais ce sont des documents à "fouiller" encore. ».
[21] « Sans aucune assistance d'un établissement scolaire, et avec le seul avantage de ce qu'on lui enseigna dans la famille, seize mois après son arrivée, elle atteint un niveau d'Anglais – une langue qui lui était parfaitement étrangère auparavant – lui permettant de lire même les passages les plus difficiles des Saintes Ecritures, à la stupéfaction de tous ceux qui l'écoutaient. » John Wheatley (1772). « Letter sent by the author's Master to the Publisher ». Phillis Wheatley. Poems on various subjects, religious and moral. London : A. Bell, 1773, p.vi.
[22] Henry Louis Gates, Jr. « Foreword. In her own write », in John Shields (ed.) The collected works of Phillis Wheatley. New York : Oxford University Press, The Schomburg Library of Nineteenth Century Black Women Writers, 1988, pp.vii-ix.
[23] Phillis WheatleyPoems on various subjects, religious and moral London : A. Bell, 1773, p.18. Traduction libre.
[24] Voir Odile Tobner. Du racisme français. Quatre siècles de négrophobie. Paris : Les Arène, 2007.
[25] Quelques textes d'Africaines ayant écrit dans leur langue maternelle au 19e siècle, sont disponibles en traduction anglaise dans la monumentale anthologie Women writing Africa : The southern Region. Johannesburg : Witwatersrand University Press, 2003, 554p. Un certain nombre d'auteures Afro-américaines telles que Susie King Taylor, Frances Ellen Watkins Harper et bien d'autres sont aussi intéressantes à découvrir.
[26] Mentionnée dans Kelly Duck Bryant. « Black but not African : Francophone Black Diaspora and the Revue des Colonies 1834-1842). International Journal of African Historical Studies vol. 40, no 2 (2007), pp.274-75.
[27] Maria Firmina dos Reis. Ursula, 1859.
[28] Harriet E. Wilson. Our Nig; or, Sketches from the Life of a Free Black. Boston: Geo. C. Rand & Avery, 1859. [Réédition: New York: Vintage Books, 1983. Préface de Henry Louis Gate Jr et commentaire de Barbara A. White].
[29]
Traduction française : Emily Ruete. Mémoires d'une princesse
arabe. Paris, Karthala, 1991.
Traduction anglaise : Emily Ruete (Salamah bint Saïd; Sayyida Salme,
Princess of Zanzibar and Oman) Memoirs of an Arabian Princess Translated
by Lionel Strachey. New York: Doubleday, Page and Co., 1907, n.p.
https://digital.library.upenn.edu/women/ruete/arabian/arabian.html
[Consulté le 19 novembre 2007].
Voir aussi la note biographique de Joachim Duester, Oman Studies, 2001.
https://www.counterpunch.org/pipermail/oman-l/2001-February/001090.html qui
mentionne de plusieurs rééditions de cet ouvrage [Consulté
le 22 novembre 2007]
[30] Ma traduction du texte anglais de 1907, ch.7. (n.p.) (voir note précédente).
[31] Voir https://www.sierra-leone.org/heroes6.html [Consulté le 1er février 2008]
[32] Catherine Burns. « Les lettres de Luisa Mvemve ». In Karin Barber (ed.) Africa's Hidden Histories. Everyday Literacy and Making the Self. Bloomington : Indiana University Press, 2006, pp.78-112.
[33] Sirah Baldé de Labé. D'un Fouta-Djalloo à l'autre. Paris: La Pensée Universelle, 1985. Cela fait 20 ans que je cherche à acquérir cet ouvrage ; j'ai dû aller le lire à la Bibliothèque Nationale, à Paris.
[34] Andrée Blouin, in collaboration with Jean MacKellar, My Country Africa autobiography of the Black pasionaria. New York : Praeger, 1983.
[35] https://www.library.ucsb.edu/subjects/blackfeminism/ah_langlit.html [Consulté le 1er février 2008]. (Mary Helen Washington. Invented Lives: Narratives of Black Women (1860-1960), 1987).
[36] Catherine N'Diaye. Gens de Sable. Paris : POL, 1984, p.159.
[37] Catherine N'Diaye. Gens..., p.160.
[38]
A remarquer aussi la différence entre la démarche de Jean
MacKellar, qui s'efface derrière son sujet pour lui laisser la parole,
et celle du Belge Ludo Martens qui publia sous forme de biographie – et sous
son nom – l'histoire de Léonie Abo, la compagne de Mulele qui
participa à l'insurrection paysanne qui agita le Congo entre 1963 et
1968. Dans une communication personnelle, Mme Abo parle de « son »
livre et il est dommage que Ludo Martens n'ait pas abandonné ses
prétentions de biographe, qu'il n'ait pas offert à Mme Abo la
possibilité de raconter son histoire avec la spontanéité
d'un récit à la première personne.
Ludo Martens. Une femme du Congo. Bruxelles : Editions EPO, 1991.
[39] Odile Tobner. Du racisme français, pp.149-150.
[40] Arthur de Gobineau. Essai sur l'inégalité des races humaines [1853-1855], in Œuvres 3 vols. Paris : Gallimard, 1983-1987.
[41] Andrée Blouin, My Country Africa, p.4.
[42] Andrée Blouin, My Country Africa, p.4.
[43] Andrée Blouin, My Country Africa, p.185.
[44] https://aflit.arts.uwa.edu.au/colonie_19e_dard_fr.html#fn17
[45] Bernard Dadié évoque son emprisonnement dans Carnet de prison. Abidjan, CEDA, 1984.
[46] Henriette Diabaté. La marche des femmes sur Grand-Bassam. Abidjan-Dakar : Nouvelles Editions Africaines, 1975, pp.50-51.
[47] Henriette Diabaté. La marche des femmes..., p.58.
[48] Un article de Pascale Barthélémy intitulé « Sages-femmes africaines diplômées en AOF des années 1920 aux années 1960 » in Anne Hugon, Histoire des femmes en situation coloniale: Afrique et Asie, XXe siècle. Paris, Karthala, 2004, pp.119-144 , propose un survol intéressant des rapports sociaux et des activités des élèves de l'Ecole de médecine de Dakar.
[49] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.46.
[50] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.71.
[51] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.389.
[52] Mariama Bâ. Une si longue lettre. Dakar : Les Nouvelles Editions Sénégalaises, 1979.
[53] Cité par Pierrette Herberger-Fofana dans Littérature féminine francophone noire. Paris :l'Harmattan, 2000, p.375.
[54] Aoua Kéita. Femme d'Afrique..., p.79.
[55] Delphine Zanga Tsogo. L'oiseau en cage, Paris : NEA : Edicef, 1983, p.4.
[56] Delphine Zanga Tsogo. L'oiseau en cage, p.7.
[57] Nafissatou Diallo. De Tilène au Plateau. Une enfance Dakaroise. Dakar : Les Nouvelles Editions Sénégalaises, 1975, p.16.
[58] Amina Sow Mbaye « Mademoiselle » Dakar : NEA-Edicef jeunesse, 1984.
[59] Amina Sow Mbaye « Mademoiselle », p.157.
Editor ([email protected])
The University of Western Australia/French
Created: 8 February 2008
https://aflit.arts.uwa.edu.au/colonies_20e_afr.html